Marion CARREL, Faire participer les habitants ? Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires
Marion Carrel est l’auteure d’une thèse en sociologie portant sur les questions de participation dans la politique de la ville. Elle s’y demande pourquoi la question de la participation des habitants revient sans cesse et essaye de comprendre les difficultés éprouvées en la matière par les professionnels, élus, représentants de l’Etat et des collectivités1.
Elle a accepté de nous parler du livre récemment publié qui en est issu2. Elle y démontre notamment que la participation n’est pas qu’une question de méthode puisque, pour la même méthode observée dans plusieurs endroits, les effets peuvent être très différents (effets dramatiques de récupération de la participation ou, au contraire, effets intéressants dans l’institution, dans le quartier, en termes de mouvement social, d’interpellation). C’est également une question de dynamisme associatif à l’endroit où les choses sont menées, de volonté politique et de clarté des objectifs poursuivis à travers la participation.
Présentation de l’enquête
L’enquête porte sur le fonctionnement de la politique de la ville à Grenoble à différentes échelles : celles d’un quartier, de la ville et de l’agglomération. Trois méthodes participatives ont notamment été observées :
• Les groupes de qualification mutuelle (animation, sur une douzaine de journées, de temps en travail entre habitants des quartiers populaires et agents de terrain dialoguant et produisant un état des lieux des problèmes dans le quartier et dans l’institution) ont pour but de donner à voir les dysfonctionnements de l’institution et donner de la matière aux institutions pour qu’elles puissent améliorer leur intervention.
• Le théâtre-forum (avec la compagnie Naje) utilise le support du théâtre pour partir de récits de vie et pousser à la subjectivation, le but étant de comprendre quelle place on peut jouer dans la société.
• L’auto-médiatisation vient de « moderniser sans exclure » qui utilise le support vidéo pour faire travailler dans les entreprises, les institutions, les services sociaux, sur la parole du bas de la hiérarchie. C’est une production par les « gens d’en bas » d’un croisement de récits entre ce qu’ils vivent et ce qu’en pensent tous les niveaux de hiérarchie. Il s’agit d’une manière de produire un support de discussion sur des conflits, des dysfonctionnements et d’ouvrir le débat sur des questions de justice sociale, etc.
Questions de fond
Un problème se pose, notamment en France, au sujet de la citoyenneté et de la pauvreté. La condition de pauvre a longtemps empêché l’acquisition du statut de citoyen. Même dans la démocratie représentative, il existe un « cens caché » puisque toute une partie de la population n’est pas représentée3. Or, celui-ci ressurgit dans la démocratie participative.
Il y a une auto-exclusion très forte des habitants de quartiers populaires vis-à-vis de la chose publique : les pauvres restent souvent « inouïs » dans l’espace public (Dominique Boulier, 2009). D’une part, ils ne sont pas entendus. D’autre part, leur manière de s’exprimer ne cadre pas avec celle dont la majorité des responsables, des professionnels s’expriment.
Il existe deux analyses distinctes de la participation dans les quartiers populaires, diamétralement opposées. Certains, tels Jean-Pierre Garnier et Denis Goldschmidt, voient dans la participation une comédie, un simulacre4. Selon eux, les inégalités sont telles dans la société que la participation est forcément de la récupération, de la manipulation. Cela joue même contre la démocratie, les mécanismes d’inégalité étant accentués à travers ces dispositifs. En revanche, pour d’autres, la participation est un levier pour l’émancipation des quartiers populaires. Ainsi, Archon Fung et Erik Olin Wright parlent de « contre-pouvoir délibératif » et estiment qu’il peut y avoir émancipation, lutte contre les inégalités, prise de pouvoir (empowerment) dans la mise en place de la participation. Par ailleurs, pour Jacques Rancière, le postulat d’égalité entre les gens encourage l’égalité réelle, la subjectivation et l’émancipation citoyenne.
Pour dépasser le clivage entre ces deux analyses de la participation, il est proposé d’adopter une approche marquée par l’anthropologie de la citoyenneté, à l’instar de Catherine Neveu. Autrement dit, les tâtonnements des administrations pour faire participer les habitants doivent être analysés empiriquement. Cette approche révèle que l’apathie politique des habitants des quartiers populaires n’est qu’apparente : ces derniers ont des temps et des moments où ils mettent en lien ce qu’ils vivent, leurs difficultés et leurs richesses avec des questions d’intérêt général, des politiques publiques. Or, les liens qu’ils font ne sont pas forcément vus, compris ou visibles.
Pour enquêter, l’auteure s’est inspirée de deux grands courants théoriques :
• La délibération et l’inégalité : la délibération (débat, échange public d’arguments) pourrait apporter de l’émancipation. L’idéal délibératif se heurte à la question des inégalités. Les théories de la délibération (notamment celle de Jürgen Habermas) ont été beaucoup critiquées pour être trop éloignées des questions d’inégalité5. Certains rejettent même la délibération au motif qu’elle reproduit les inégalités sociales. D’autres, en revanche, reprennent ces théories délibératives pour les améliorer sur la question des inégalités. Les théoriciens distinguent trois pistes pour lutter contre la reproduction des inégalités dans la délibération :
• L’activisme délibératif : la démocratie délibérative est doublement révolutionnaire6. D’une part, pour avoir une vraie délibération dans la société, il faudrait qu’il y ait une égalité. D’autre part, la délibération suppose une transformation dans les pratiques institutionnelles (moins de hiérarchie, plus de contre-pouvoirs, etc.). Pour Archon Fung, soit on attend de révolutionner la société, soit on fait de l’activisme délibératif, c’est-à-dire distiller dans un monde inégalitaire autant de délibération que possible (ex : désobéissance civile). C’est ce dont s’inspirent les « artisans de la participation » étudiés (professionnels militants de la participation).
• La conception pluraliste de la délibération (Iris Marion Young) : le pluralisme est recherché, ce qui permet aux différences sociales d’être reconnues et de devenir des ressources. La différence (être pauvre, immigré, mal parler français, …) doit être comprise et écoutée, elle peut être utile pour comprendre les dysfonctionnements des institutions.
• L’empowerment (développement du pouvoir d’agir) : M.-H. Bacqué et C. Biewener montrent bien que, dans l’empowerment comme dans la participation, il y a des projets politiques très distincts7. Il y a trois logiques dans l’empowerment : la vision radicale qui vient de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis et pour laquelle il s’agit, par la lutte, de défendre des droits et de s’organiser pour la défense de ses droits, le but étant que les institutions prennent ces questions à bras le corps ; la vision néo-libérale dans laquelle la prise de responsabilité des individus dans une idée de baisse des institutions, des services publics, de retrait de l’institution (c’est à la population de prendre en charge ses propres problèmes) ; la vision sociale-libérale (intermédiaire) qui cherche à transformer les institutions mais est moins marquée par la lutte contre les inégalités. De même, il faut essayer de comprendre ce que l’on recherche à travers la participation : est-ce qu’il s’agit de questionner l’institution ou de donner de l’émancipation aux catégories populaires ? Si l’on se place maintenant du côté des transformations sociales, il existe deux modes bien distincts d’empowerment : le mode traditionnel (celui d’Alinski), à savoir la lutte (par ex., v. le « community organizing ») et la mise en place de contre-pouvoirs délibératifs.
• La publicisation des problèmes sociaux :
Certaines questions posées par les services publics sont non-publiques : elles restent ignorées, non « visibilisées », non comprises (ex : violence aux guichets). Ce qui est intéressant, c’est de se demander comment ces problèmes peuvent devenir publics (ex : un collectif d’habitants s’en empare, un fonctionnaire fait grève)8. John Dewey montre à quel point l’enquête est importante dans le processus de publicisation (ex : noter l’occurrence des faits, essayer de comprendre d’où ça vient, ce qui se passe en termes de DRH). Quand un problème devient public, cela signifie qu’il est controversé : on est passé de la violence au conflit, ce qui est l’enjeu de la démocratie. C’est par là que des personnes en situation d’inégalité peuvent faire entendre leurs problèmes. Ce conflit peut être porté par différents acteurs (médias, mouvements sociaux, administration).
Nina Eliasoph montre, au sujet des associatifs, qu’une même personne peut selon les endroits (situation publique ou privée) être apathique ou, au contraire, être consciente des enjeux politiques, voire très politisée. Il en va de même en ce qui concerne les habitants des quartiers populaires : en situation publique, ils sont très souvent en posture d’autolimitation à des questions personnelles, privées, alors qu’ils ont par ailleurs beaucoup de questions sur l’intérêt général et de sens de la justice et de l’action publique.
Le terrain
• Les réunions publiques qui fonctionnent mal
L’injonction participative a produit des ravages dans les quartiers populaires. Ainsi, la participation, mal conçue9, renforce les stéréotypes. D’une part, elle renforce les stéréotypes des habitants sur les élus et les fonctionnaires : il ne servirait à rien de voter. D’autre part, elle renforce les stéréotypes des institutions et des professionnels sur les habitants : il ne servirait à rien de faire de la participation étant donné que les habitants sont toujours sur le conflit.
• Les méthodes utilisées par les artisans de la participation
Des artisans de la participation mènent des méthodes participatives dans les quartiers populaires plus rassurantes sur la manière dont la parole des habitants de ces quartiers peut être perçue, entendue, écoutée par des professionnels, des élus et être traversée par tout un processus de délibération, de participation produisant certains effets.
Les personnes observées arrivent à faire travailler ensemble des habitants et des professionnels (souvent des agents de terrain) et à leur faire coproduire une enquête sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Cela ne va pas de soi et est source de beaucoup de conflits. Pourtant, par certaines méthodes, des questions de fond sont pointées. Sont ainsi mis en place des artéfacts d’égalité : cela passe par la reconnaissance d’une place égale (les habitants ont des savoirs que les autres n’ont pas et qui peuvent être utiles), l’indemnisation des habitants (à hauteur du SMIC sur toutes ces journées de travail), la sociabilité (une des manières de lutter contre l’inégalité dans la délibération est d’avoir des formes de discussion moins imposantes que des discussions froides sur des dispositifs, en utilisant par exemple le théâtre, la vidéo) ou encore par le fait de donner place au discours privé ou de s’appuyer sur des associations et des groupes.
Les méthodes utilisées par les artisans de la participation révèlent cependant cinq tensions que l’on retrouve dans toute posture participative :
• Education ou émancipation ? L’animation peut être coercitive, tout en étant au service de l’émancipation. Cela peut poser certaines questions en pratique (ex : des habitants qui se plaignent de telle ou telle règle de travail ensemble). Cela entre en tension avec la production que doit rendre le groupe.
• Le repoussoir de l’habitant professionnel (le spectre de la délégation) : les artisans de la participation observés repoussent la figure de l’habitant professionnel. Ils cherchent les « vrais » gens, ceux qui sont en colère, énervés (et qui sont plutôt écartés des dispositifs participatifs d’habitude) car c’est porteur de questions de fond. Mais, cela contourne les associations revendicatives (ex : associations de locataires, partis politiques).
• La démarche collective (le spectre de l’injonction participative) : il s’agit de la crainte des artisans de la participation de rester sur un travail se limitant à quelques habitants isolés. Par ces petits noyaux, des transformations vont se faire. Cependant, une fois que les artisans de la participation ont terminé, l’individu qui était isolé peut à nouveau se retrouver complètement isolé et ne pas pouvoir vivre une suite à ce qu’il a vécu. Les artisans de la participation font donc en sorte d’articuler ce qui se passe dans ces groupes avec des associations, des mouvements sociaux, pour qu’il y ait des liens entre la participation individuelle et des formes collectives de participation.
• La dépendance aux commanditaires (le spectre de la récupération) : il s’agit ici de la question relative à la dépendance des artisans de la participation vis-à-vis des commanditaires (les collectivités locales) et à la lutte contre la récupération, difficile à mettre en place.
La question de la professionnalisation de la participation peut également poser question.
• « Enfermés dans un bocal » ? Échelles et diffusion des expériences : les artisans de la participation travaillent en quelque sorte dans un bocal. La question de la diffusion dans la société de l’expérience qui se passe en petits groupes (mini-publics) se pose. Elle doit notamment être reliée à d’autres causes, d’autres réseaux associatifs ou militants.
Conclusion
« Tout ce qui est fait pour nous sans nous est fait contre nous » (Ghandi, Mandela). Les capacités d’action et de réflexion des habitants ne doivent pas être sous-estimées.
DISCUSSION
La co-construction avec les habitants des futurs contrats de ville
Il est prévu que les habitants les co-écrivent les futurs contrats de ville. Plusieurs questions se posent, concernant la manière de les associer, le degré de concertation. Les retours des habitants vont également conduire à interroger les institutions (Etat, collectivités). Le délai étant très contraint, ces dernières se demandent comment mettre en place la co-construction du contrat de ville avec les habitants. Les habitants qui y participeraient seraient associés à des conseils-citoyens.
Il va falloir créer des pratiques permettant de prendre au sérieux la parole des habitants dès le départ, mettre en place des dispositifs soucieux des questions d’inégalité dans les prises de parole : par exemple, interdire l’utilisation de sigles. Cela demande du temps et de l’argent et une réflexion sur les objectifs poursuivis : est-ce que l’on veut juste répondre à la loi et faire semblant que l’on co-construit le contrat de ville ou bien est-ce que l’on veut réellement qu’il y ait co-construction de celui-ci avec les habitants ? Pour Marion Carrel, il y a cinq préconisations pour que la participation soit réellement utile pour tous (émancipation des gens et améliorations des pouvoirs publics) :
Volontarisme politique et clarification des objectifs : en interne, les collectivités et les services de l’Etat doivent clarifier les objectifs poursuivis (pourquoi, comment).
Coproduction d’une enquête dans la durée : il faut associer dès le départ (ie dès les premières réflexions) les habitants à l’enquête.
Questions de techniques d’animation, de méthodes.
Articulation avec les mouvements sociaux : il ne faut pas évacuer le conflit. Travailler avec la parole conflictuelle est essentiel. Le conflit est porteur de participation, comme l’illustre la rénovation du quartier de l’Alma-Gare à Roubaix dans les années 1970.
Lien avec la décision : tout travail participatif doit avoir un lien avec la décision. S’il n’est pas très fort, il doit au moins être explicité.
La question du temps
La temporalité est une question importante, souvent réduite de la manière suivante : lorsque le projet est amené à la population, il a déjà une temporalité, ce qui est très inégalitaire (l’habitant arrive sur une question qui a déjà été travaillée). Au contraire, les habitants doivent être associés à la concertation dès le départ. Par ailleurs, les questions d’empowerment et d’émancipations se placent dans un temps long. La temporalité est parfois brandie comme un problème : les institutions n’auraient pas la même temporalité que les habitants. Certes, mais il existe des points de discussion pour peu que la concertation soit temporellement intéressante : il ne va pas se passer grand-chose avec une concertation dont on estime qu’elle se réduira par exemple à deux réunions de deux heures.
1 Ces questions sont éminemment d’actualité. A ce propos, il convient notamment de mentionner le rapport rédigé par Marie-Hélène Bacqué et Mohammed Mechmache à la commande du ministre de la ville sur les questions participatives montrant qu’il y a de fortes attentes sur ce que les pouvoirs publics mettront en place en termes d’encouragement au développement du pouvoir d’agir des habitants des quartiers et des associations (Pour une réforme radicale de la politique de la Ville. Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires, Rapport remis à François Lamy, ministre délégué chargé de la Ville, Juill. 2013). Une loi sur la politique de la ville, nourrie par ce rapport (quoique insuffisamment), est d’ailleurs en cours de finalisation. Par ailleurs, suite à ce rapport, une journée nationale pour la création d’une coordination nationale des habitants des quartiers populaires s’est tenue le samedi 8 février 2014, l’objectif étant que les associations de quartiers puissent se coordonner au niveau local et national pour peser sur la gouvernance de la politique de la ville.
2 M. Carrel, Faire participer les habitants ? Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires, ENS Editions, 2013.
3 D. Gaxie, Le cens caché, Éditions du Seuil, Sociologie politique, 1978.
4 J.-P. Garnier et D. Goldschmidt, La comédie urbaine ou La cité sans classes, 1977. Il s’agit de la critique marxiste de ce que le gouvernement mettait en place en matière participative à l’époque des luttes urbaines.
5 Par ex., v. les critiques d’Iris Marion Young, Lynn Sanders et Axel Honneth.
6 A. Fung, « Délibérer avant la révolution », Participations, n° 1, 2011/1, p. 311-334.
7 M.-H. Bacqué et C. Biewener, L’empowerment, une pratique émancipatrice, La Découverte, Politique et sociétés, 2013.
8 J. Dewey, Le public et ses problèmes, 1923. Ses travaux portent sur la capacité de la société à comprendre l’administration.
9 Marion Carrel prend l’exemple d’une réunion de concertation animée par un élu et un professionnel au cours de laquelle la présentation d’un projet de rénovation urbaine est faite, suivie d’un débat où s’exprime une grande colère des habitants.
Audric VITIELLO, L’empowerment : trajectoire et limites d’une perspective sociopolitique
Les tensions inhérentes au fonctionnement-même des pratiques participatives ou même d’empowerment font la richesse, voire le succès, des thématiques de la participation et de l’empowerment. Ces termes sont extrêmement polysémiques.
Ces dispositifs sont habités d’une tension entre deux grandes finalités : une finalité politique (il s’agit d’aboutir à une décision plus démocratique) et une finalité pédagogique au sens fort d’éducation, de rééducation des individus participants, en sorte qu’ils développent leur pouvoir d’agir et deviennent réellement citoyens de leur activité. Or, cette tension est extrêmement profonde et a des effets extrêmement lourds : elle aboutit à ce que les dispositifs mis en place soient animés de deux logiques contradictoires en même temps.
Ainsi, la politique du point de vue démocratique s’inscrit dans une logique autonome d’expression des citoyens en situation égalitaire. Pour la pédagogie, c’est exactement l’inverse : c’est une logique de formation, asymétrique puisque quelqu’un forme et que quelqu’un d’autre est formé. Autrement dit, les dispositifs participatifs et/ou d’empowerment sont animés à la fois d’une logique égalitaire et d’une logique inégalitaire. Cela aboutit à ce que l’on puisse avoir des interprétations différentes des mêmes dispositifs en fonction des acteurs qui les animent, certains voulant faire prévaloir la dimension politique et d’autres la dimension pédagogique. Quoi qu’il en soit, on ne peut jamais véritablement éliminer l’une ou l’autre sans perdre ce qui fait la caractéristique de ces dispositifs. On est donc toujours dans une démocratie en débat (débat dans le dispositif mais aussi sur le dispositif). En d’autres termes, le conflit dans le dispositif et sur le dispositif est quelque chose de normal. Il est logique de ne pas avoir les mêmes opinions sur la manière de débattre.
La tension entre la dimension politique et la dimension pédagogique doit être creusée autour de la question de l’empowerment et, ce, à deux niveaux de tension.
I. Le premier niveau de tension – la portée de l’empowerment : est-ce qu’on en attend exclusivement une transformation des individus ou est-ce qu’on en attend également une transformation des institutions et des structures sociales ?
Marie-Hélène Bacqué et C. Biewener montrent que la notion d’empowerment émerge dans les années 1960 dans le travail social. Elle est ensuite reprise par des mouvements sociaux (mouvements communautaires de libération des droits et mouvements féministes). Dans un cas comme dans l’autre, c’est une logique d’intervention sociale, de transformation en luttant contre l’apathie réelle ou supposée des membres de la société et contre les structures sociales qui produisent cette apathie. L’empowerment articule trois dimensions de transformation : une dimension individuelle (il s’agit de faire en sorte que les individus reprennent confiance en eux, qu’ils acquièrent un minimum de compétences pour comprendre les situations auxquelles ils doivent faire face), une dimension interindividuelle (il s’agit de recréer du lien social, permettre la formation de collectifs dans la société civile où les individus peuvent échanger leurs expériences et servir de base pour une éventuelle mobilisation dans l’espace public) et une dimension de transformation politique au niveau des interventions et des prises de décision dans l’espace public. L’empowerment regroupe ces trois dimensions, auxquelles on peut ajouter une dimension économique dans laquelle les acteurs ont accès à un pouvoir y compris de se procurer leurs ressources par leurs propres moyens.
Une fois que la logique de formation des individus a été introduite, il n’y a qu’un pas entre formation, transformation et conformation : il suffit de réorienter la logique du système pour qu’on puisse faire de l’empowerment non plus un outil de transformation, de changement de l’individu et de la société, mais un outil de conformation de l’individu aux besoins de la société. C’est typiquement ce qui se produit avec la réinterprétation néolibérale (par la banque mondiale) et sociale-libérale (par l’ONU et un ensemble de gouvernements de la troisième voie) du terme dans les années 1990. Dans ce cas, le pôle individuel est en effet accentué (ce qui compte, c’est que l’individu soit transformé), alors que la question de la transformation des structures sociales et politiques est quasiment évacuée.
Finalement, la volonté de transformer les individus, présente dans l’empowerment et dans les dispositifs participatifs, peut être liée à des perspectives sociales et politiques très différentes parce qu’elle est foncièrement ambivalente.
La question se pose de savoir si ce pouvoir producteur d’individualité va produire de la liberté ou pas. Une auteure américaine qui a travaillé sur l’empowerment du point de vue foucallien montre que toute l’histoire de l’empowerment aux Etats-Unis est reliée à l’ambivalence de la volonté d’empowerment, vecteur de transformation ou de conformation. Cela fournit une piste pour essayer distinguer ce qui fait qu’à un moment on se trouve dans la conformation et à autre dans la transformation. On est dans une logique d’empowerment transformateur/émancipateur quand on débouche sur une organisation collective de la société civile relativement durable. L’empowerment ne se réduit donc pas à un moment d’intervention : s’il est efficace, il doit produire des effets sur la durée et transformer les subjectivités. L’empowerment devient émancipateur/transformateur à la condition qu’il serve de point de départ d’une dynamique qui est nécessairement imprévisible. Cependant, cette imprévisibilité est extrêmement difficile à assumer pour les commanditaires et les organisateurs (les artisans de la participation).
II. Le second niveau de tension : quelle inégalité les dispositifs d’empowerment et de démocratie participative entendent-ils combattre ? A quel type de public s’adresse-t-on, autrement dit cherche-t-on à impliquer tous les citoyens ou seulement certaines catégories spécifiques de citoyens ?
Globalement, ce sont les catégories sociales « dominantes » qui participent le plus (« cens caché »). Cet empowerment qui égalise les statuts du citoyen et du dirigeant redouble les inégalités existant entre les citoyens : l’inégalité sociale devient une inégalité politique flagrante.
Mais, l’empowerment peut également s’intéresser à certaines catégories sociales, particulièrement défavorisées, difficiles à attirer spontanément. Ici, l’enjeu n’est pas tellement de développer l’autonomie des citoyens en général, mais de développer l’égalité entre les citoyens.
Ces deux objectifs (égaliser les citoyens et les élus et développer l’égalité entre les citoyens) ne sont pas incompatibles. Idéalement, il faudrait qu’il y ait les deux à la fois. Mais, articuler les deux n’a rien d’évident : dans un cas, le dispositif tend à l’homogénéité (promotion d’un modèle) et, dans l’autre, à l’hétérogénéité (adaptation du modèle aux situations et publics particuliers).
Cette tension peut appeler à clarifier les dispositifs, mais aussi à distinguer les espaces entre ceux dédiés à égaliser citoyens et élus et ceux destinés à égaliser les citoyens entre eux (ex : création d’espaces publics institutionnels où il y ait un certain accès à la décision). L’empowerment au sens strict (volonté d’égaliser les catégories de citoyens entre eux) prendrait la forme de publics intermédiaires.
Le problème de l’accès à la décision se pose : en l’absence d’un tel accès, il y a des effets de démobilisation massive, en particulier dans les publics qui sont a priori les moins disposés à participer. Autrement dit, faire de l’empowerment en public intermédiaire sans accès à la décision risque de ne pas produire grand-chose. Mais, un autre problème se pose, celui de la légitimité pour prendre une décision commune, en cas de public intermédiaire.
Conclusion
L’un des enjeux que pose cette question de l’équilibre et des tensions inhérentes à la participation est celui du statut des animateurs. La question la professionnalisation des animateurs se pose. Souvent, il s’agit d’anciens militants devenus professionnels en recyclant leur capital militant. Ce modèle domine très largement. La question qui va se poser est celle de la relève : les jeunes générations peuvent-elles être formées à la participation uniquement par un système universitaire, sachant qu’il n’y a pas de modèle idéal de la participation ? Un diplôme peut-il garantir que l’on ait un certain regard sur sa propre activité ? La posture historiquement militante qui se traduit habituellement par une certaine réflexibilité sur ses propres pratiques ne peut pas disparaitre.
DISCUSSION
Sur la question de l’éducation, de la formation
S’agissant de l’éduction populaire, est-ce qu’on est plutôt dans la transformation de la société ou est-on au contraire dans la conformation des idées dominantes et des institutions telles qu’elles sont pourtant remises en cause ? Tant que cela demeure du bénévolat, on se trouve du côté de la transformation, mais dès que cela devient professionnalisé, il existe un risque de récupération.
Sur la capacité des professionnels de la participation à s’organiser
Les professionnels sont censés créer du collectif, alors qu’entre eux ils sont incapables d’apporter des éléments sur l’émergence de leur métier. Ceci est logique puisqu’ils sont par ailleurs en concurrence. Les trajectoires sont très différentes entre ceux qui viennent du monde militant, les fonctionnaires et ceux qui sont formés par le système universitaire.
Sur la question des valeurs
Quand on parle de participation, d’empowerment, de démocratie délibérative, etc., que l’on associe étroitement aux logiques de politique de la ville, on a tendance à faire comme si ces notions ne concernent qu’un univers particulier (politique de la ville), des professionnels particuliers (travailleurs sociaux qui ne travailleraient que sur ces territoires), alors que ces notions traversent l’ensemble des politiques urbaines. Elles croisent très fréquemment des situations de mouvements sociaux liés à l’école ou encore à la santé. En ghettoïsant ces notions autour de la politique de la ville, on occulte la dimension d’analyse politique, dont il ne faut pourtant pas se passer. Par exemple, il ne suffit pas de dire que l’on ne sait pas ce que veulent les commanditaires. La discussion doit être remontée au-delà des concepts. Les concepts s’inscrivent dans une réalité sociale.
Roger et Marie-Agnès LEMAN, L’Alma-Gare à Roubaix
Habitant à Roubaix depuis 1962, Roger et Marie-Agnès Leman ont créé un atelier d’urbanisme, l’Atelier Populaire d’Urbanisme, avec les habitants du quartier de l’Alma, où ils ont résidé de leur arrivée dans la ville jusqu’en 2000.
Le point de départ
En 1966, le maire de Roubaix annonce au Conseil municipal la disparition des courées de l’Alma. Les habitants vont alors se mobiliser contre le projet de rénovation urbaine imposé par la municipalité. L’atelier populaire d’urbanisme créé au début des années 1970 et réunissant des habitants et des techniciens élabore un contre-projet. Le schéma directeur du quartier élaboré par les habitants est présenté à la mairie et finalement validé par celle-ci en 1977.
Leur action
A leur arrivée à Roubaix, les mentalités étaient marquées par le patronat, la SFIO et l’idéologie catholique. Il a fallu « réveiller » les habitants et les faire exister. Pendant toute leur action (une quinzaine d’années), trois principes vont guider les habitants de l’Alma-Gare : « on agit, on réfléchit, on construit ». Finalement, ils ont fait beaucoup de choses qui n’ont jamais pu se faire ailleurs.
Dès le départ, ils ont soumis des idées neuves. Par exemple, ils n’ont pas créé une association au sens juridique du terme, mais ont mis en place une permanence tous les mercredis soir où chaque habitant pouvait venir, suivant les problèmes qu’il rencontrait. Ils ont, par ailleurs, créé l’aide technique aux habitants ou encore l’écrivain public (collectif).
Ils ont fait des stages de formation pour le prix des loyers ou encore la surface corrigée. Les premières années, ils ont ainsi mené des actions sur le logement (calcul de la surface corrigée, faire baisser le loyer), actions en justice (ils en ont gagné 200).
Ils ont recréé un centre social, véritable outil de développement dans un quartier. Il existe toujours et c’est même le pivot du quartier. En revanche, il n’existe plus de comité de quartier.
La présence des femmes dans le quartier, qui à cette époque travaillaient peu, était très importante : elles réunissaient les gens, créaient des petits comités d’habitants dans les courées, participaient aux réunions et aux manifestations.
Le fonctionnement de l’Atelier Populaire d’Urbanisme
Tous les mercredis, les habitants du quartier se réunissaient pour discuter des problèmes du quartier. Ils menaient des actions « bon-enfant ».
Des techniciens (architectes notamment) ont été envoyés par l’Etat au service des habitants. Des réunions étaient organisées entre eux et les habitants dans chaque rue et dans chaque maison, le but étant de déterminer si telle ou telle maison devait être rasée ou non. Le schéma directeur du quartier a ainsi été élaboré par les habitants avec l’aide de ces derniers.
Un habitant a été embauché, appelé « permanent habitant » (actuellement, ils sont dix à Roubaix).
Les habitants de l’Alma-Gare ont enfin bénéficié de l’important soutien du maire de Roubaix.
L’Alma-Gare depuis sa rénovation
Après la reconstruction du quartier, les habitants ont tous été relogés dans les logements neufs. La vie sociale y a été maintenue (système de coursives).
Cependant, les HLM n’ont pas su maitriser le peuplement (arrivée de la drogue). Par ailleurs, la mixité sociale, vécue au début, n’a pas perduré avec l’abandon de l’aide à la personne et la mise en place de l’aide personnalisée au logement. Les cadres et les classes moyennes ne sont pas restés : elles avaient plus intérêt à accéder à la propriété que de rester dans ces logements en location.
Marie-Agnès et Roger Leman sont venus nous parler de la rénovation du quartier Alma-Gare à Roubaix dans les années 70, considérée comme un exemple emblématique de planification urbaine participative. Y habitant depuis 1962, ils ont en effet créé un atelier d’urbanisme, « l’Atelier Populaire d’Urbanisme » (APU), avec les habitants du quartier de l’Alma-Gare, où ils ont résidé de leur arrivée à Roubaix jusqu’en 2000.
L’histoire de l’Alma-Gare
En 1966, le maire de Roubaix annonce au Conseil municipal la destruction des courées de l’Alma et leur remplacement par des bâtiments d’architecture moderne. Les habitants vont rapidement se mobiliser contre le projet de rénovation urbaine ainsi imposé par la municipalité.
L’Association Populaire Familiale va notamment organiser une campagne sur les conditions désastreuses d’habitat à Alma-Gare, revendiquer pour les habitants du quartier le droit de participer activement à l’aménagement de celui-ci et, à l’inverse de la municipalité, se prononcer pour le maintien du cadre bâti préexistant et de la population d’origine.
Créé en février 1973 afin de permettre aux habitants de discuter avec les autorités municipales et les techniciens du projet de rénovation, l’APU obtient en 1977 le soutien de l’Etat qui lui assure une assistance technique par l’ABAC (équipe parisienne composée de trois architectes, un sociologue et un juriste).
Au même moment, un groupe de travail est mis en place pour élaborer un nouveau plan d’urbanisme pour Alma-Gare. La collaboration entre les habitants et les architectes de l’ABAC aboutit à l’élaboration d’une carte-affiche exprimant des idées définies par les habitants eux-mêmes pour la transformation de leur quartier. La carte-affiche de l’APU est discutée par l’ensemble des parties du groupe de travail (habitants, techniciens, élus) et sera validée par le conseil municipal pour devenir le document officiel de la rénovation.
Les pratiques habitantes
Pendant toute leur action (une quinzaine d’années), trois principes vont guider les habitants de l’Alma-Gare : « on agit, on réfléchit, on construit ». Leurs initiatives leur ont permis de faire beaucoup de choses qui n’ont jamais pu se faire ailleurs.
Dès le départ, ils ont soumis des idées neuves. Par exemple, ils n’ont pas créé une association au sens juridique du terme, mais ont mis en place une permanence tous les mercredis soir où chaque habitant pouvait venir, suivant les problèmes qu’il rencontrait. Les habitants du quartier se réunissaient ainsi pour discuter des problèmes du quartier. Ils ont, par ailleurs, créé l’aide technique aux habitants ou encore l’écrivain public (collectif). A la suite de stages de formation qu’ils ont fait concernant le prix des loyers ou encore la surface corrigée, ils ont mené des actions sur le logement (calcul de la surface corrigée, baisse des loyers), des actions en justice (ils en ont gagné 200).
Outre les actions « bon-enfant » qu’ils menaient, ils ont recréé un centre social, véritable outil de développement dans un quartier, qui existe toujours.
Des réunions étaient en outre organisées entre les techniciens envoyés par l’Etat au service des habitants et ces derniers dans chaque rue et dans chaque maison, le but étant de déterminer si telle ou telle maison devait être rasée ou non. Un habitant a également été embauché, appelé « permanent habitant » (actuellement, ils sont dix à Roubaix).
Enfin, la présence des femmes dans le quartier, qui à cette époque travaillaient peu, était très importante : elles réunissaient les gens, créaient des petits comités d’habitants dans les courées, participaient aux réunions et aux manifestations.
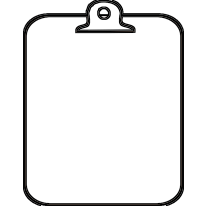
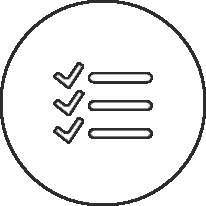
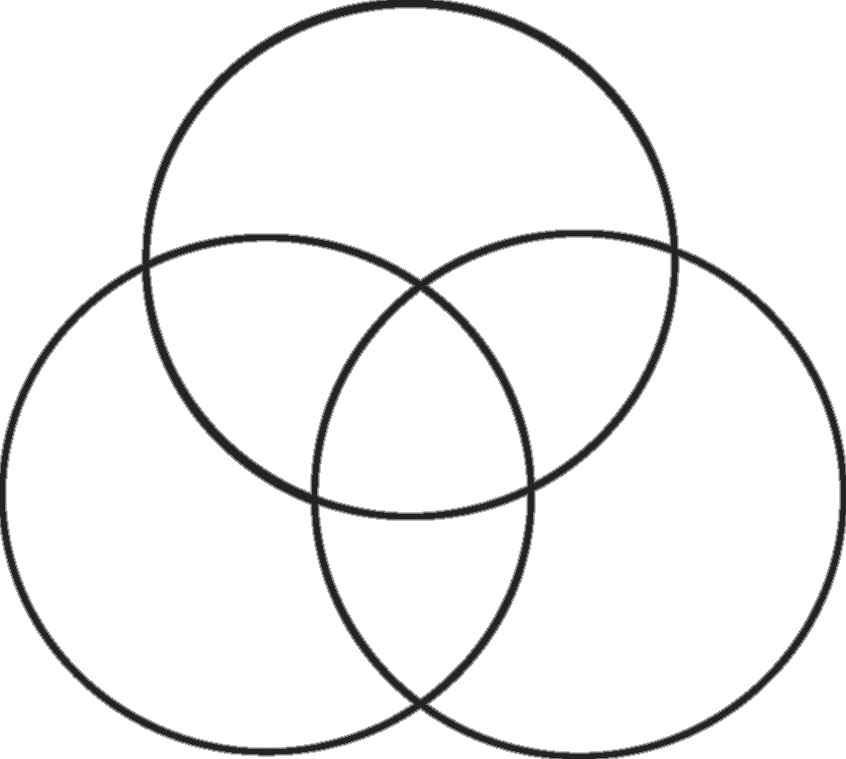
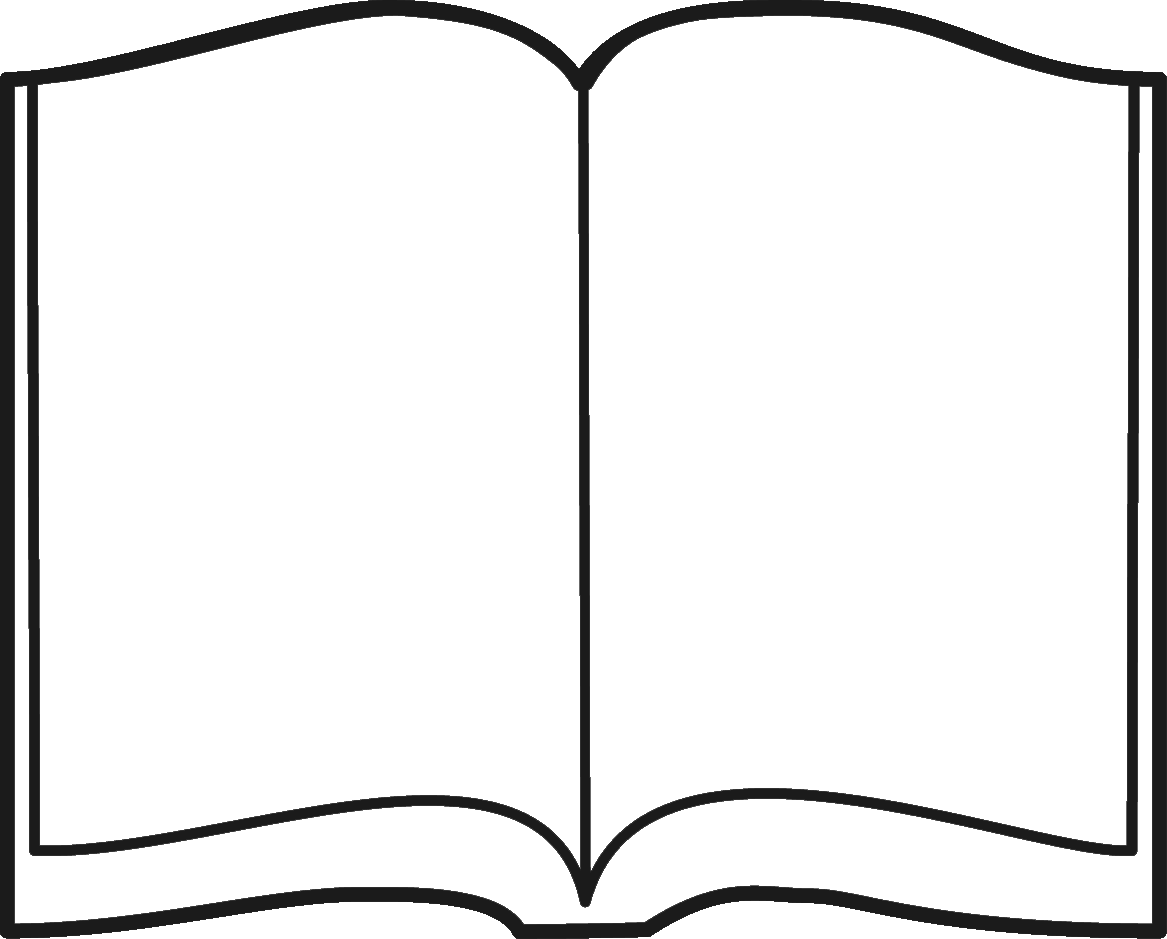
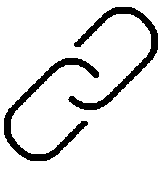


 Marion CARREL
Marion CARREL
 Audric VITIELLO
Audric VITIELLO
 Roger et Marie-Agnès LEMAN
Roger et Marie-Agnès LEMAN
 Séminaire précédent
Séminaire précédent Accueil
Accueil
 Quand les habitants prennent l’initiative
Quand les habitants prennent l’initiative