Maud Le FLOCH et Pascal FERREN – Introduction
Le pôle des Arts Urbains est crée en 2007 par des urbanistes-géographes, sur la base du constat que le travail de certains artistes participe aux questionnements sur les villes et les territoires.
La dynamique de la création artistique participe aujourd’hui à l’outillage de l’opérateur urbain (de l’aménageur, de l’urbaniste mais aussi de l’élu et du technicien de collectivité locale). Il y a une bascule qui se fait en direction des usagers, des riverains, des occupants qui se constate bien au pOlau, au carrefour entre le monde de la création et le langage des aménageurs et des urbanistes. Et la question de la participation citoyenne est une des clés pour faire intervenir des nouvelles compétences, et notamment des compétences artistiques qui n’ont pas froid aux yeux pour intervenir dans l’espace urbain et ont besoin des gens, ont besoin de s’adresser à des publics pour que leurs créations prennent toute leur puissance et accèdent à une caisse de résonance spatiale et sociale. Ce besoin des gens, « même pas peur des gens », est assez spécifique à ce type d’interventions artistiques dans l’espace urbain.
L’année dernière, a été fait un travail de repérage d’initiatives artistiques pouvant interagir avec les questions d’aménagement du territoire. 300 initiatives ont été répertoriées. Il y a bien un secteur en cours d’apparition et l’injonction à la participation citoyenne peut être réelle et sincère autant qu’elle peut être un prétexte politique. Et cette journée peut permettre d’analyser précisément cela.
Un mouvement commun d’intégration du récepteur dans les évolutions de l’art et de l’urbanisme
Ce propos introductif vise, par un bref retour en arrière, à contextualiser les discussions. La participation dans la création artistique n’est pas vraiment une nouveauté. Elle remonte à une cinquantaine d’années, avec les héritiers du mouvement Dada, le situationnisme, le mouvement Fluxus, les élèves de John Cage, Allan Kaprow notamment, perfomer des années 60 considéré souvent comme un des premiers ayant fait des performances interactives, qu’il appelait des happenings, pour désigner à la fois une expérience relativement imprévue et mêlant différents genres artistiques et où le spectateur avait sa part dans la création artistique.
Schématiquement, ce type de mouvement des années 60 et 70 va se prolonger dans les années 80 avec une explosion des formes d’expression artistique, caractérisée par la présence dans l’espace public et une manière forte d’intégrer le spectateur dans l’œuvre, qui débouche sur une espèce d’injonction : « plus de spectacle sans spectateur », où le spectateur doit prendre part au spectacle. Selon Michaux, l’art actuel serait devenu « gazeux », à la fois partout et nulle part, ce qui signifierait non pas la fin de l’art, maintes fois annoncée, mais la fin de sa focalisation sur l’objet, sur l’œuvre, qui s’efface au profit du processus de création. L’art serait ainsi devenu procédural.
Deux idées importantes : d’une part, l’objet final s’est un peu effacé au profit du processus de création en lui-même, et d’autre part, l’intégration du regardeur, du spectateur, de l’auditeur comme un élément fort de la création. En résumé, en un siècle, on a vu l’apparition de la considération par l’artiste de l’expérience esthétique (avec très peu voire pas du tout de considération du spectateur, l’expérience artistique étant entièrement contenue dans l’acte de création), puis l’intégration de cette expérience esthétique du spectateur dans le processus de création puis le remplacement de l’acte artistique lui-même, où c’est finalement presque le spectateur lui-même qui se met à faire l’œuvre.
Parallèlement, il y a un mouvement simultané dans les politiques publiques d’aménagement, notamment dans le cadre de la rénovation urbaine, qui va également vers la participation. La manière de faire de l’urbanisme au XXème siècle, basée sur la planification, sur la prévision et sur l’expertise savante, cette manière de faire s’est essoufflée, et l’urbanisme cherche depuis plusieurs décennies à renouveler ses méthodes. Pierre Hamel, géographe canadien, parle de « postmodernité de l’urbanisme » : « En termes positifs, on peut dire que les critiques postmodernes de la planification ont plaidé en faveur d’une reconnaissance du pluralisme des acteurs et de leurs différences. En favorisant l’expression de la diversité des points de vue et le relativisme des valeurs, les critiques postmodernes nous ont rappelé qu’au sein du paradigme de la planification, tant les représentations que les interventions sont biaisées en faveur des acteurs dominants. Cela a d’abord conduit à dépasser les conceptions abstraites de la citoyenneté et de la démocratie afin de tenir compte d’éléments subjectifs ou existentiels ouverts sur la quotidienneté et l’urbanité. »2 Et c’est cette fin de citation qui va vraiment nous intéresser quant au rôle des artistes.
Si on reconnaît l’expertise de l’urbaniste-aménageur, elle n’est plus la seule source de l’acte d’aménager et il faut prendre en compte, comme le dit Pierre Hamel, la diversité des points de vue, en remarquant que la planification rationnelle excluait les voix dissidentes. C’est un refus du gouvernement des experts. Les évolutions méthodologiques de l’urbanisme vont vers la prise en compte premièrement, d’une plus grande diversité d’acteurs, la distribution de l’expertise, et deuxièmement, une plus grande diversité des modes de connaissance mobilisés par ces acteurs, une pluralité de l’expertise. Une des conséquences majeures de ces évolutions des pratiques d’aménagement, c’est la prise en compte des usagers de la ville dans la conception de la ville.
Dans l’histoire de l’art comme dans l’histoire de l’urbanisme, on vit un mouvement analogue d’intégration du récepteur -l’habitant pour l’urbanisme, le spectateur, l’auditeur, le lecteur dans l’art- dans la conception même de la ville ou de l’œuvre d’art. Et ce double mouvement se rencontre dans un certain nombre de pratiques artistiques qui croisent les deux dimensions, qui sont à la fois participatives et qui participent aussi à la manière dont les gens peuvent s’approprier leur territoire.
Pour l’aménageur, qui est manifestement en quête d’outils pour intégrer les usagers dans la fabrique de la ville, les savoir-faire des créateurs sont un vivier assez intéressant : la capacité des artistes à aller sur le terrain, à ne pas avoir peur du réel et à s’y confronter, à créer des dispositifs d’échanges, d’ouvertures, à faire émerger des paroles, des récits, des souhaits, des désirs, des désaccords… Toutes ces qualités de l’artiste sont intéressantes dans des processus d‘aménagement.
Encore plus récemment, ces créations artistiques participatives de territoire se sont mêmes institutionnalisées, ou du moins ont commencé à ouvrir un marché, avec des structures d’accompagnement, des appels d’offres… Par exemple, cet appel d’offre de la ville de Niort qui demande une « commande d’intervention artistique qui implique les habitants dans le cadre de l’aménagement d’espaces publics dans un quartier type ancien bourg de village » avec : pour destinataires de l’appel d’offre des « équipes professionnels des arts vivants (arts de la rue ou plasticiens) » ; période d’intervention « 6 mois » ; objectifs de la démarche engagée : « 1. définir des usages pour les différents espaces du cœur de quartier tant pour ceux qui y vivent que ceux qui y sont connectés, 2. Définir les aménagements envisageables à terme pour redynamiser le cœur de l’ancien bourg et les espaces connectés, 3. aider les habitants à se réinventer leur histoire sur la ville. » On a donc là une commande artistique qui demande des prestations d’aménageurs-urbanistes.
Quelques opérations artistiques illustratives
Projection d’un film sur une création « Superflux »3 de la compagnie Ici-même Paris de 2009.
L’intérêt de ce dispositif où est installée une chronolocation sur une avenue à Paris, c’est cette capacité à aller sur le terrain, à prendre la parole et faire ressortir des choses, des problèmes, des frustrations. Et on voit apparaître une analyse de la question du logement à Paris, avec toutes les problématiques de voisinage, de manque d’espace, d’odeurs… Et pour l’anecdote, la chronolocation a été réellement mise en place récemment par une société américaine. La présence de cette installation pendant quinze jours à Paris, sans que les habitants soient prévenus, a créée du conflit, des réactions et à l’issue de cette installation, le maire du 9ème arrondissement a saisi cette occasion pour faire un grand débat public avec les propriétaires, avec les riverains, avec les habitants sur la question de vivre à Paris au XXIème siècle.
Autre exemple : un collectif d’architectes (Sébastien Renaud, Nicolas Turon, Laurent Boijeot) qui font notamment des installations temporaires sur des places, en créant un mobilier (chaises, tables, lits, matelas, couettes…). Cette équipe se positionne hors des logiques d’appel à projet, sur un art volontairement critique, sur de l’auto-saisie, avec une vraie volonté de déranger l’espace établi, mais en faisant participer les gens à leurs constructions, à l’activation de leurs lieux.
Autre exemple plus classique : Julie Desprairies avec la compagnie des prairies4, compagnie de danse dont la spécialité est de danser les lieux et de faire danser les gens dans leurs lieux. L’idée est toujours de mettre en mouvement les gens dans leurs propres bâtiments. C’est un des exemples assez fort de la manière dont on peut faire participer les gens en gardant une création artistique contemporaine, de la danse contemporaine, en s’appuyant sur la question du bâti, de l’espace, de l’architecture, de la forme urbaine.
Autre groupe révélateur de dynamiques existantes : des plasticiens marseillais, les Pas Perdus5. Dans le cadre d’une rénovation urbaine à Bordeaux, ils ont installé une cabane avec l’idée de poser un objet et d’y rester pendant plusieurs semaines pour s’en servir comme un lieu de concertation, un lieu de discussion, d’échanges, où les gens viennent amener et prendre des idées, autour du projet urbain de rénovation du centre-ville de Bordeaux. Ils appellent cela les « zones d’anniversaire concertées ».
L’équipe du collectif Random qui se retrouve plus du côté urbaniste que du côté artistique. C’est une compagnie de théâtre plus classique qui décide, à partir de 2007, de sortir dans la rue en créant de petits laboratoires. Ils créent des dispositifs qui perturbent la circulation dans l’espace public et questionnent les gens sur cette perturbation. A partir de cette forme de base, ils ont fait plusieurs interventions pour des bailleurs sociaux ou des collectivités territoriales notamment, où ils font des créations artistiques sur les opérations de rénovation urbaine. Un de leur leitmotiv est de dire « on fait de la participation car on va dans la rue. On passe dans les commerces, on va boire un café avec les gens. On parle arabe. » Ils ont une parole sur la participation et des méthodes assez simples.
La Compagnie X/tnt6, à l’origine de Montreuil et qui vient du théâtre très classique, qui propose le « google street review » : c’est une visite du quartier à la manière d’un google street view mais avec une mise en scène des habitants dans leur quartier, dans leur environnement.
Trans3057 et le collectif d’architectes Yapluka illustrent une autre dimension intéressante de la création artistique participative de territoire : ils font de la participation avec des outils que l’on peut qualifier d’artistiques : résidence, création participative, vidéo… Site à Ivry, le Trans305 est un lieu encore en activité avec la particularité d’être actif pendant un temps assez long et pendant un chantier urbain (pendant le chantier d’un ZAC de 2007 à 2018) avec des expositions, des workshops, des ateliers avec les gens et les ouvriers etc.
La compagnie de théâtre de rue « Les souffleurs commando poétique » qui propose un dispositif pour créer de la poésie dans l’espace public, avec notamment des grandes cornes avec des gens qui soufflent des poèmes à l’oreille, ou encore des opérations « rues silencieuses » où le moteur des voitures est arrêté à l’entrée de la rue et les voitures sont poussées. Autre opération, « la folle tentative d’Aubervilliers » avec notamment des « conseils municipaux extraordinaires sur le rêve » où l’idée est de faire un conseil municipal en faisant surgir des idées utopiques sur la ville pour en mettre en place quelques-unes (parmi les 300 recensées, 4 votées : la création du premier trésor poétique mondial municipal, l’extension et la municipalisation de rues silencieuses, l’inscription d’un projet dit impossible à l’ordre du jour d’un conseil municipal extraordinaire annuel, la création d’un système de mesure de la tendresse collective).
Une création artistique à Lyon, intéressante dans son transfert : au départ, en 2006/2007, c’est une commande classique à un artiste plasticien jardinier d’une œuvre, une serre avec un jardin fermé. Et par la suite, plusieurs programmes s’en sont saisis, la politique de la ville, puis la direction du développement urbain, puis le Grand Lyon Lyon et cela s’est étendue au fur et à mesure, un premier jardin, puis un autre puis un bar, le « court-circuit », puis une terrasse et c’est finalement tout l’îlot qui a été recrée, l’îlot Mazagran. Et c’est vraiment devenue une opération urbaine alors que l’artiste est parti depuis deux ans. Cela a été repris par un collectif d’habitants qui s’occupe du jardin, par de l’activité économique avec un bar qui s’est créé. Et les acteurs urbains qui avaient prévu de faire un parking à cet emplacement-là ont révisé leurs projets. C’est une belle illustration de la manière dont une opération artistique peut influer sur un projet urbain.
Pour finir, « Sanitas en objets », un artiste plasticien, Nicolas Simarik, accueilli au pOlau pendant 5 ans, s’est installé au quartier du Sanitas avec des ateliers hebdomadaires réguliers. Il a créé avec des habitants des « objets de ville » (cabas, tasse, parapluie, etc.) à l’image du quartier. Puis il a par la suite participé à la réhabilitation d’un jardin sur le quartier, avec une commande du service « Parcs et jardins » de la Ville de Tours qui lui demande de travailler sur l’intégration d’objets faits par les habitants dans ce jardin et il a créé avec les habitants des assises, un nid, des silhouettes d’oiseaux, etc. avec un financement de la politique de la ville. Tous ces objets ont été intégrés à la programmation urbaine du jardin.
Cette revue illustre diverses formes d’intervention artistique, de celles s’inscrivant dans des cadres assez marqués de la politique de la ville, mais aussi des interventions plus informelles, des interventions qui jouent plus sur du décalage ou du décadrage (comme Superflux et la chronolocation par exemple), ou des projets carrément inscrits dans des projets urbains (comme Random ou les Pas Perdus).
Zmorda CHKIMI – Retours d’expériences
C’est le témoignage d’une metteur en scène, qui travaille au sein d’une compagnie et en collaboration avec une auteur qui est également historienne. Cette compagnie travaille depuis 11 ans en Essonne, majoritairement sur des quartiers dans le cadre de la politique de la ville, avec des financements publics et privés (Acsé, Drac, CAF, Conseil Général, bailleurs sociaux, Caisse des Dépôts, fondation des aéroports de Paris…). Ces travaux s’inscrivent dans la durée, en général deux ou trois ans.
Le choix est de présenter un projet emblématique de leur activité, mis en place à Grigny, à la Grande Borne. Ce projet était spontané et ne résultait pas d’une volonté ou d’un appel d’offre de la ville. Suite à un premier travail sur la commune de Viry-Châtillon, sur laquelle la cité de la Grande Borne est à cheval, la ville de Grigny est apparue intéressante car elle rassemble de nombreux paradoxe : 40 ans de communisme, une usine Coca-cola qui fait vivre la ville, une ville utopique construite par Emile Aillaud dans la lignée de Le Corbusier, tout en labyrinthe avec très peu de bâtiments en hauteur, avec des œuvres d’art partout, de nombreuses mosaïques… Une ville que l’on voulait belle, que l’on souhaitait mixte et investie par ses habitants. Cela n’a pas été le cas : cette ville a été suréquipée, puis placée sous la tutelle de l’Etat en 2009 car en déficit (inédit depuis 1976). Il y a eu la volonté de travailler là car cela représentait un microcosme de société et tout ce qui ne fonctionnait pas. Ce travail a duré 3 ans. Au départ, la volonté était de travailler sur la thématique de l’emploi, en interrogeant les salariés de l’usine Coca-Cola, mais ils étaient en plan de restructuration sociale et ne voulaient pas retourner dans l’usine. En se promenant dans la ville, un grand plan de rénovation urbaine était en place sur la cité de la Grande Borne, avec toutes ces grandes places publiques inoccupées, alors que c’est une ville du département avec le plus de jeunes, sans lycée, sans pôle emploi, sans Caf, donc une ville complètement laissée à l’abandon. On s’est dit : « Qu’est-ce qui pourrait fédérer ? Comment accompagner cette rénovation pour laquelle on n’a pas vraiment sollicité les habitants ? » et est venue l’idée de construire un manège qui serait actionné par 5 vélos (dix places assises, les enfants au centre et les adultes pédalent). C’était l’occasion de croiser les générations. Un chantier d’insertion a été mobilisé pour travailler sur les mosaïques bien spécifiques de la ville et sur les figures qu’on retrouvait dans toute la cité (Rimbaud, Kafka…). Une difficulté était que l’installation ne pouvait pas être fixe à cause des risques de vandalisme. Le manège a donc été construit en bois et en mosaïque pour être montable et démontable en une heure.
On est resté pendant 3 ans. La durée permet de faire un vrai travail de partenariat avec les structures sociales et en même temps, pouvoir orienter les gens. Car de plus en plus, on nous demande d’être un outil culturel ou un opérateur culturel et de moins en moins un artiste. Cette exigence rencontre des limites et il est nécessaire de s’entourer de toutes les structures pour pouvoir orienter les gens quand ce n’est pas notre champ de compétences.
Suite à la construction de ce manège, il y a eu une inauguration où on a demandé aux gens de participer en accrochant 160 éoliennes sur chaque fenêtre de leur immeuble pour accompagner le mouvement de rotation du manège et de dire bonjour en même temps, ce qui faisait 160 spectateurs et acteurs le jour J. Il y a avait également 13 structures présentes pour cette inauguration.
Cela s’est bien passé avec les habitants, un peu moins avec la mairie. C’est une ville complètement renfermée sur elle-même. Sur la place où on a joué, cela faisait 7 ans qu’il n’y avait plus eu aucun projet mis en place. On a été accusé de faire partie de l’UMP, du PS… Le jour où a été inauguré le manège, un ministre en charge du logement nous avait invité pour inaugurer sa prise de fonction lors de sa première visite à Grigny. Et ce jour-là, le maire de Grigny a explosé en disant que nous n’avions rien à faire ici, alors que cela faisait deux ans que l’on travaillait sur le territoire et que cela se passait bien. Ce manège avait été approprié par plein d’association (les sièges se démontent et il peut devenir un plateau tournant). Une association voulait en faire une médiathèque ambulante en suivant toutes les places de la Grande Borne, un chantier d’insertion en couture voulait l’utiliser pour faire des défilés. On a été obligé de signer une convention avec la mairie avec obligation de gratuité pour la mise à disposition aux associations.
Le lendemain de l’inauguration, il y avait la fête de la ville à Grigny, le manège a été stocké au CVS et il n’en est plus jamais ressorti. Et le lendemain, un manège à 10 000 euros a été loué pour la fête de la ville. Voilà, on est dans des écarts complètement surréalistes. C’est un exemple d’un des projets mis en place sur Grigny.
Et une des limites en tant qu’opérateur culturel, c’est d’être à cheval entre le fait de continuer à faire des projets et le fait d’être manipulés et manipulables et par les municipalités et même par les financements privés, qui orientent de plus en plus les projets.
En général, on travaille sur un maillage territorial, sur une restitution avec une vraie écriture dramaturgique, avec une volonté de réécrire pour transcender la réalité et toujours sur un objet du commun (un manège, un livret/CD pour les violences faites aux femmes, une BD…). Par exemple, on a fait un projet sur Sainte Geneviève sur les discriminations et les violences faites aux femmes, qui s’appelle « chemins de femmes ». Et on a des retours comme : « est-ce que vous croyez que les gens vont comprendre ? ». Alors que ce spectacle a été joué à la cité de l’immigration en soutien aux sans-papiers, qui étaient 500 et qui n’ont pas eu de problèmes de compréhension. Finalement, ce sont les décideurs souvent qui ont l’impression que les gens ne comprennent pas. Du coup, de plus en plus, on nous demande de tirer vers le bas l’art et ce qu’on défend au niveau des propos.
Et au niveau du conseil général, à la mission aux droits des femmes, sur ce projet « Chemin de femmes », on avait majoritairement des femmes voilées, qu’on a vu d’ailleurs se voiler en un an. Comme on est chargé de faire le relais, on a alerté sur le fait de la présence d’une mosquée gérée par un intégriste et qu’il y a peut-être un problème avec cette mosquée, située entre deux établissements scolaires. Et on a refusé que sur un espace de représentation publique, il y ait une femme voilée. Et il a fallu défendre ce choix-là au conseil général, à la mission aux droits des femmes. « Pourquoi ne pas présenter une femme voilée ? » Alors que nous pensions que c’était le dernier endroit où nous aurions à nous justifier de cela. C’est un espace public, donc si on défend la laïcité, on ne peut pas être vecteur de cette représentation-là de la femme. Il y a donc une déconnexion parfois entre ceux qui financent et la réalité qui est complètement autre.
Discussion avec la salle
Une demande de complément sur le contexte municipal à Grigny, les financements.
Il n’y avait pas de volonté de la ville au départ de faire intervenir la compagnie. L’intervention s’est faite dans le cadre d’un appel à projet type CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale), mais la municipalité a refusé de rencontrer la compagnie pendant les 6 premiers mois. Malgré cela, le travail a continué dans le cadre de l’accompagnement de la rénovation urbaine (financé par l’Acsé, le conseil général, l’Etat, la Drac, le principal bailleur). De toute façon, la ville était sous tutelle et ne pouvait financer. Comme le projet était de faire un manège pour offrir aux habitants par la suite, on ne voyait pas pourquoi il y avait des réticences. Il y a aussi une volonté dans cette ville de ne pas faire venir d’autres artistes à part ceux liés à la ville et au parti communiste.
Une question sur les effets de ce travail dans l’accompagnement de la rénovation urbaine et sur les décisions prises.
En fait, à chaque moment où il y avait un pan de rénovation, on a accompagné et on a discuté avec les habitants car ce travail n’avait pas été fait en amont. Donc on a accompagné plus ou moins les nuisances que la rénovation pouvait apporter. On a été l’outil de cela quelque part auprès du bailleur. L’accompagnement de la rénovation était un moyen de mieux la faire passer auprès des habitants, mais ce n’était pas un moyen de faire remonter les attentes des habitants. Ces interventions se retrouvent finalement contraintes par les décideurs et cela pose la question de l’instrumentalisation, le projet urbain étant déjà écrit et en partie réalisé, sans que les habitants n’aient été consultés.
Ida TESLA – Retours d’expériences
Par rapport à l’idée évoquée précédemment de la spontanéité des projets, on entend de plus en plus que pour les artistes, ce serait un nouveau marché qui s’ouvre. Ce qui ne correspond pas du tout à l’expérience vécue : en fait, on arrache de l’argent au CUCS pour la culture. La culture est financièrement ridicule dans les CUCS. Et ce mot « culture » a disparu des CUCS, donc on devait cocher « éducation » ou « citoyenneté ». Et aujourd’hui, il est réintégré. Cette idée doit donc être battue en brèche.
Si on a pu, pendant 7 ans, être en résidence au quartier des Rives du Cher, c’est totalement à notre initiative, puisque c’est une habitante des Rives du Cher, qui était étudiante à la fac de théâtre et qui nous a, dans le cadre de son stage, invité dans son quartier dans lequel elle trouvait justement que culturellement il ne se passait plus rien. Et il pourrait très bien ne pas y avoir d’opérateur culturel et uniquement des artistes qui font des prestations. On a eu les compliments d’un acteur social qui a dit « ça fait plaisir de voir des artistes se comporter en opérateur culturel et qui mouillent la chemise et qui ne viennent pas faire une prestation bien délimitée « ça va vous coûter tant, ça va être 3 heures de théâtre forum sur tel thème, vous m’amenez le public et emballé, c’est pesé ! » ».
Il faut donc bien comprendre ce contexte : on a travaillé 7 ans aux Rives du Cher mais chaque année était la dernière. A chaque fois, on se quittait en juin en disant « c’est merveilleux ce que vous avez fait ! » et quand on revenait en septembre, on nous disait « Ah, non ! Je suis désolé mais cette année, cela ne va pas être possible ! ». Donc, ce n’était plus possible CUCS-Mairie, on passait alors à un financement GUP (Gestion Urbaine de Proximité), après peut-être que Tours(+) pouvait prendre le relais, etc. On avait donc des alliés, des gens que ça intéressait mais à l’intérieur d’un système dont on sent bien qu’il n’est pas du tout fait pour ça, pour les micro-structures se retrouvant entre opérateurs, artistes, individus et collectifs. Comme disait Zmorda : « On travaille sur ce qui se passe » et pendant que ça se passe. Et ça, c’est très important. Et même un centre social très bien ancré ne le fait pas, et encore moins un centre dramatique, une structure culturelle qui n’est pas de proximité -et c’et normal car ils ont un autre travail de démocratisation culturelle à faire. Ces micro-entités que nous sommes sont celles qui sont le plus réactives. Et on n’est pas du tout sur un marché car cela demande des compétences très différentes de celles qu’on met en œuvre quand on est dans un théâtre avec des comédiens professionnels. Par exemple, pour construire le manège à Grigny (cf. exposé ci-dessus). Aux Rives du Cher, cela a été pareil, le travail a commencé par des entretiens, des promenades à deux en proposant aux gens de faire la même ballade que celle que vous faîtes tous les jours en discutant ensemble de cette promenade. Donc, sans panel sociologique, plusieurs promenades ont été faites avec des gens différents, et donc des itinéraires, des appropriations spatiales et des représentations très contrastées de ce même quartier.
Par la suite, on a commencé à faire des installations pour rendre compte de ce travail aux gens et on a commencé à devenir un petit peu les artistes du quartier, un peu à la façon d’un service public artistique : « Vous avez un besoin artistique, venez nous voir. » Mais si on donne rendez-vous à une heure fixe, dans un lieu fixe, les gens ne viendront pas. On est dans des politiques publiques où on nous explique que les gens n’ont plus que des besoins économiques, que c’est leur seul souci, alors que les gens ont également besoin de s’exprimer, d’imaginaire, de poésie, de rencontres, de dialogue, etc. Et si on ménage des espaces, par exemple des occupations éphémères de halls d’immeuble, les gens viennent et expriment des envies et des besoins artistiques. Et là où on a été un peu piégé, ce qui est intéressant quand on joue vraiment le jeu, on a fait beaucoup de concertation et on a dit : « On a le droit d’occuper de façon éphémère vos halls d’immeuble -ce qui n’était pas vrai mais ne portait pas à conséquence, il s’agit simplement de s’autoriser tout ce qui n’est pas explicitement impossible dans la ville, et là, il y a beaucoup à faire-, qu’est-ce que vous voudriez y faire ? ». Et là, les gens n’ont pas dit « on veut faire du théâtre ». Ils ont dit « des plantes vertes, avant il y en avait, il n’y en a plus, on en met et on nous les enlève, des plantes, des plantes » donc des jardins, transformer ces halls d’immeuble en jardins. Et il s’est trouvé que la chargée de mission des territoires à la mairie de Tours en charge du quartier avait rencontré une jeune paysagiste en train d’achever son diplôme, qui était tourangelle et cherchait un terrain d’étude. Ces compétences étaient tout à fait complémentaires de celles des artistes et permettaient de répondre à la demande des habitants. La rencontre avec cette personne a donc débouché sur une collaboration. Et tout un travail de transformation de leurs halls d’immeuble en jardin a été commencé. Et par ailleurs, un hall est devenu un théâtre, avec des répétitions et des spectacles. Il y a aussi eu « le hall qui parle », un projet mené avec les éducateurs de prévention, qui sont des gens avec lesquels on a beaucoup travaillé et dont on s’est rendu compte qu’on avait des liens très forts dans nos méthodes de travail, dans l’appréhension de la rue… Le projet artistique est venu d’eux : « il faudrait raconter une journée dans un hall, parce que la personne qui se lève à 6 heure du matin voit les déchets laissés par les jeunes qui ont fumé des joints toute la nuit, mais il ne sait pas, ils ne se voient pas, ils ne se parlent pas, il n’y a pas de compréhension ». Donc on a créé une installation sonore qui s’appelait « le hall qui parle » et on a interviewé les gens sur tous les créneaux horaires possibles, sur ce qu’ils font dans le hall, sur ce qui s’y passe. On a ensuite retranscrit les propos et on a créé un personnage, le hall, qui parlait et qui racontait sa journée de hall d‘immeuble en donnant la parole à tous ces gens et cela a donné une installation sonore d’un quart d’heure où tout le monde pouvait entendre les raisons et la manière d’appréhender et de partager ce lieu des autres. Il y a aussi un hall transformé en lieu où on dessine.
C’était intéressant car nous n’avions jamais travaillé dans l’espace public et nous n’avions pas de culture des arts de la rue. Le hall a donc constitué une première étape. Ce lieu, mi-privé mi-public, nous intéressait bien car il appartient à tous le monde mais est très approprié également. Ensuite, on est vraiment parti dans l’espace public, avec la chance de voir un pont se construire dans ce quartier, en travaillant dessus (un roman en est sorti, au titre recyclé d’un autre roman « naissance d’un pont » : nous nous sommes inspirés d’un roman mais pour un travail théâtral et photographique). Il y a eu aussi l’arrivée du tramway…
En fait, on fait des micro-politiques culturelle de territoire à notre initiative et contrairement à ce qu’on essaye de dire, qu’on trouverait de l’argent pour faire nos création sur le dos des populations, c’est plutôt que l’on remplace parfois l’absence de politique publique cohérente. Et pour le montage de projet, c’est la méthode des poupées russes : le financement global provient à la fois de la culture et la politique de la ville, et à l’intérieur, par exemple, on va créer un atelier spécifiquement dans l’école (éligible à d’autres financements, comme par exemple la Fondation de France), mais dans le même thème et sur la même dynamique, et idem au collège, en sachant que les enfants vont vous voir à l’école et dans la rue, et ce sont les mêmes enfants, donc que ce ne soit pas la même ligne budgétaire n’a aucune importance, pour les habitants comme pour les intervenants. On construit comme cela des petites poupées qui s’imbriquent les unes dans les autres et qui vont aboutir à un financement global pour une activité globale.
Ce travail a également donné lieu à un plan de quartier, avec la paysagiste et grâce à un travail avec les habitants sur la représentation d’un quartier, et à une chasse au trésor grandeur nature qui rassemblait un certain nombre d’activités, pour certaines déjà engagées depuis un moment. Et cela a été la première fois que le bailleur social, Tours Habitat, s’est intéressé à notre travail, en sachant qu’on était dans le quartier depuis plusieurs années. Ils sont venus voir ce que l’on faisait parce que la chargée de mission les a incités. Le lien de Pih Poh avec Tours Habitat était les gardiens d’immeuble car toutes ces occupations éphémères n’ont été possibles qu’avec la complicité des gardiens. Et on s’est rendus compte que c’était des gens très importants dans un quartier d’habita social, qui pouvaient jouer un rôle très riche pour la qualité de la vie sociale, qui après allait rebondir sur la propreté des lieux, sur le bien-être des gens, à un sens très large. Et ils ont été très complices de ces aventures-là qui leur créaient en fait plutôt du travail supplémentaire. Ils pouvaient donner accès à l’électricité, à des locaux de stockage, etc. Après, les gens des bureaux se sont intéressés au travail dans un deuxième temps et cela a créé autre chose, car ce n’est pas la même dynamique. Ils sont venus voir ce que l’on a fait. Et on a aussi eu la chance de pouvoir travailler en coproduction avec Rayon frais [festival de théâtre urbain à Tours], ce qui a permis de donner une vision complémentaire : avant on était très intra-quartier, on travaillait avec les gens du quartier pour les gens du quartier ; et là, cela a donné l’occasion à des gens du centre-ville de venir dans ce quartier et de le voir sous un autre angle –notamment les vues panoramiques sur la ville et la vallée que l’on a des tours d’habitation. Donc cet événement, c’était une chasse au trésor dans le quartier, organisée avec l’aide de la Maison des Jeux de Touraine. Il y avait également un musée associé à cette chasse, qui était installé dans un appartement vide prêté par le bailleur et où était exposé tout ce qui avait pu être fait avec les habitants. On a donc commencé à travailler avec Tours Habitat et on est alors passé d’un A4 en noir et blanc à cette jolie plaquette couleur de 16 pages, ce qui est très satisfaisant pour les intervenants comme pour les participants.
Le quartier est divisé en différentes zones, des tours de propriétaires et des tours HLM, ces dernières étant encore à distinguer selon les bailleurs, avec un bailleur plus chic où les occupants ont droit au front sud sur le Cher alors que l’autre n’a que les tours en retrait. Il y a une finesse sociale que l’on acquière par l’expérience et que les gens racontent. Et cela fait comprendre aussi que les gens savent très bien où ils sont, où on les place et comment la société les considère. Il y a une grande expertise d’usage sociologique des habitants des quartiers populaires. Cela polarise spatialement des problèmes que la société française a : dans la partie copropriétaires, il y a plutôt des gens très âgés, qui sont là depuis 30 ou 40 ans, alors que dans la partie HLM « chic », il y a des familles plutôt jeunes et dans l’autre partie HLM, il y a davantage de familles « étrangères » ou considérées comme « étrangères ». Et là, on retombe sur des questions très fortes de représentations, sur lesquelles on travaille : qui a le droit de cité ? Qui a le droit à la parole ? Qu’est-ce que la citoyenneté ? etc. L’idée était que, par ce parcours, les copropriétaires aillent dans la partie HLM et les gens des HLM aillent dans la partie copropriétaires. Et il y avait un tramway à venir et un espace naturel sauvage. C’est donc toute une recherche sur ce quartier.
Avec « Au pied des Tours », on a travaillé sur la dimension historique du quartier. On a appris que Le Corbusier est venu au Rives du Cher et on l’a fait revenir. On a dit aux habitants : « -Vous savez que le Corbusier est venu aux Rives du Cher ? -Ah bon ? -Et d’ailleurs il va bientôt revenir… -Ah ? Je croyais qu’il était mort… » Et donc, il est revenu. Et il a été interviewé par Gérard Royer, le directeur du journal de la ville de Tours et fils de Jean Royer, le maire de la ville !
« En pleine nature sauvage » : Dès que le pont a été construit, on l’a fait habiter par un vagabond, ce qui a beaucoup plu. Il avait construit sa cabane en récupérant des plantes sur les bords du Cher et il vivait là. Il a commencé à faire sa petite vie, la police est passée, une dame lui a amené à manger…
« Terrain à bâtir » : il y a eu toute une concertation sur le seul espace en friche du quartier, un terrain à bâtir. On invitait les gens à faire de l’arpentage, le mesurer etc. pour faire des projets. Et quand on se retrouvait au musée à la fin de tout cela, on rediscutait ensemble sur la taille de la parcelle et les possibles. Mais cette concertation, portée par un service de la mairie, a été doublée par le projet d’un autre service de la mairie. Et cette concertation n’a mené à rien, bonne leçon pour nous car quand on entraîne les habitants dans une participation, maintenant, on s’assure que ce qu’ils vont dire ou faire sera entendue car sinon on se sent un peu pris entre l’arbre et l’écorce, ce qui est très désagréable.
« Où est passé Madame Durand », c’était dans la partie copropriétaire. Il y avait une projection d’un film d’archive sur la construction des quartiers sud de la ville, ce qui était à l’époque le plus grand chantier d’Europe. Les papys et mamys, installés là depuis 40 ans, descendaient en pantoufles pour regarder le film et il y avait aussi des nouveaux arrivants.
« Murmures murs », c’était l’installation du « Hall qui parle ». Et on pouvait ensuite se retrouver au musée des rives du Cher avec une exposition de photos et de dessins de Meryl Septier et c’est là où on discutait, on faisait de la concertation sur ce qu’on pourrait faire et les ressentis généraux autour du quartier.
A la suite de cela, Tours Habitat nous a dit : « c’est fantastique ce que vous avez fait mais on va s’arrêter là. » Et on a compris que pour le directeur, on était censé faire de l’événementiel et qu’il n’en avait pas eu pour son argent. Ce qui fait que pendant deux ans, on n’a plus travaillé avec eux mais quelque chose s’était mis en route et on est resté en bons termes pour occuper les halls d’immeuble, et ils ont toujours été d’accord puisque l’année d’après, on a décidé d’aller travailler sur un autre quartier aux Fontaines.
Quand on est arrivé aux Fontaines, ils nous ont demandé « Mais pourquoi vous voulez travailler toujours dans le même hall et ne pas changer de hall ». Et ils nous ramenaient à ce que l’on peut appeler de l’animation et il a fallu réexpliquer que l’on est ni dans l’événementiel ni dans l’animation. Et pourquoi il faut de la récurrence, pourquoi il faut être au même endroit de façon récurrente et que c’est comme ça que les gens peuvent participer à un moment et que ce n’est pas faire une animation ponctuelle qui peut apporter une réelle participation.
Discussion avec la salle
Une question sur l’implication locale
Il y a une nécessité à bien connaître le territoire, à être présent auparavant. Y-a-t-il une implication personnelle avant sur ces territoires pour pouvoir avoir cette qualité et cette proximité dans les quartiers ?
Ida Tesla se considère arriver en étrangère sur le quartier. Et d’un point de vue théâtral, le comédien ne ment jamais et il n’y a pas de cloison étanche entre le réel et l’imaginaire. Ce que l’on vit aujourd’hui était impensable il n’y a même pas 100 ans. On arrive dans une dynamique où on ne sait pas à l’avance, et où il est nécessaire d’apprendre et pour cela d’avoir du temps, pour une implication hebdomadaire, voire quotidienne, ce qui nécessite aussi de travailler à proximité de son lieu de vie.
Est-ce que ces territoires-là ont été choisis et est-ce qu’il y a une part d’implication personnelle ? Zmorda Chkimi revendique un théâtre politique, sur LE politique. On a le besoin de s’interroger sur la population, sur ce qui se passe sur un territoire et sur un thème précis -parce qu’on ne peut pas s’interroger sur tout-, sur l’emploi, sur les femmes. Ensuite, pourquoi l’Essonne ? C’est un peu un hasard, suite à un projet -un spectacle de poésie- acheté par pleins de bibliothèques en Essonne, mais cela aurait pu être sur un autre territoire, en périphérie de Paris, puisqu’il y avait un intérêt sur la périphérie, et humaine et géographique.
Une question sur les partenariats institutionnels mobilisés à Tours
On a travaillé avec toutes les associations présentes à l’espace multi-accueil Toulouse Lautrec, le VERC (« Vivre ensemble au Rives du cher ») qui est un espace de vie social et le centre socioculturel Léo Lagrange, qui est structure sociale qui fait du périscolaire. Il y avait donc deux pôles : un très professionnel à la limite de la bureaucratie (Léo Lagrange) et un trop peu professionnelle (VERC), à la limite des « grands frères ». Il y a eu également le service de prévention spécialisée, partenaire très proche notamment sur le travail du « hall qui parle », il y a eu une évidence sur la façon d’envisager la personne et le territoire dans sa globalité, dans ses interactions.
Question sur l’implication politique. Il faut une posture d’artiste particulière pour faire ce travail d’intervention artistique engagée, pour faire ce travail dans le temps long, avec un échange très prégnant avec la population ?
C’est une posture militante, même avec les précautions pour employer ce terme. Ce terme militant revient, notamment par la participation aux activités d’une nouvelle association, « Pas sans nous » (coordination nationale des associations des quartiers populaires) : « cela ne se fera plus sans nous, pour une réforme radicale de la politique de la ville », qui défend la co-construction de la politique de la ville, avec les habitants et les associations.
Là où le rôle de l’artiste peut être intéressant, ce ne serait pas tant dans la critique que dans le « faire », qui porte la critique en creux. On ne peut plus dire qu’il n’y a plus de citoyens engagés, que les gens n’ont plus le temps, n’ont plus envie, ne sont pas intéressés, ne comprennent pas, etc. » Car ces interventions artistiques créent ces espaces, il n’y a plus besoin d’aller dire que ça existe, puisque cela existe. Il y a une démarche collective, avec un vidéaste, une paysagiste, pour créer une dynamique. Si on veut créer une dynamique collective dans un quartier, il faut soi-même être un collectif. C’est la création des choses qui fait que les gens ne pourront plus mentir ou être dans le déni puisque les choses sont là et se font. Et elles se feront sans eux, la démocratie participative est en train de s’inventer. Même si parfois, quand on voit les réticences, on peut être désabusé. Et c’est une école de citoyenneté.
Une question sur le passage de groupe, du collectif à un commun : comment le micro peut devenir du collectif ? Et comment le commun peut perdurer ?
Il y a l’idée que l’intime, c’est le plus universel. Marcel Proust parle à tout le monde quand il parle de sa peine face à la mort de sa grand-mère. Quand on est dans le micro, on est déjà dans l’universel. Quand on recueille des paroles (par exemple, des interviews d’adolescents et d’adultes), on retrouve une parole complètement au-delà de leurs situations particulières (en fonction de leur âge, leur origine, leur quartier…). Ce que ces personnes disent, sur leur micro-expérience à eux, peut intéresser tout le monde, en tant que mère, père, fils, etc.
Malgré l’insistance à montrer surtout ce qui nous divise, le commun existe. Quand on passe du temps avec des gens, le commun est vraiment là, comme une évidence. C’est vraiment ce qui nous fédère et nous unit, même si ce n’est pas le discours général que l’on a. En se rencontrant simplement, en faisant des liens et en étant ensemble, le commun est là, de fait. Et l’enjeu de la participation est là, de faire émerger du commun.
Une façon de faire perdurer le commun peut être en construisant un objet du commun. C’est une solution pragmatique, d’où un manège, un livret CD, une association de femmes qui content sur les discriminations.
Une question sur la place et le rôle des acteurs de la médiation culturelle
Selon les propos exposé, il y aurait une certaine hostilité, si ce n’est pas des décideurs, du moins du système vis-à-vis d’interventions qui relèvent de l’incertitude, incertitude toujours délicate à appréhender pour les décideurs publics. Les réponses avancées sont soit de prendre le droit quand on ne l’a pas, soit d’aller chercher des alliés, sur le terrain ou au sein même des institutions. Mais on ne voit pas les acteurs de la médiation culturelle (services culturelles des collectivités…), qui apparaissent absents des exposés.
A Tours, il y a eu le travail pendant deux ans en coproduction avec Rayon Frais, qui est un festival sur « les arts et la ville », organisé par un service culturel. La difficulté est qu’il y a tout un financement accordé aux institutions culturelles (musées, centres dramatiques…), et celles-ci auraient sans doute intérêt à se repositionner en tant que pôle de ressource pour les acteurs locaux. Il y a un mouvement (notamment une charte des politiques culturelles publiques adoptée par des directeurs des affaires culturelles lors d’un congrès à Rennes) qui met en avant l’idée qu’en situation de pénurie, il faut que les institutions deviennent pôle de ressource pour les acteurs locaux, les micro-acteurs. Et d’une manière générale, l’Etat s’efface en termes de financements et il faut aller chercher du côté des agglomérations, des villes et dans le privé.
Du côté de la formation, on constate que les acteurs sociaux du territoire sont formés à la médiation culturelle, et souvent le chemin est fait par le travailleur social vers l’équipement culturel et rarement l’inverse. Malgré les rapports sur l’utilité du travailleur social au sein de l’équipement culturel, malgré les financements directs de la DRAC, on se retrouve finalement avec des formes d’actions culturelles souvent standardisées, c’est-à-dire beaucoup à destination des écoles et des collèges, et il y a tout un vide qui existe pour ces microstructures sociales. Dans les réunions CUCS ou contrat de ville, l’expression « partenaire culturel » apparaît comme un élément de langage qui n’est pas connu, pas saisi. Pour l’instant, on est souvent dans un rapport passif-actif, avec le travailleur social qui est questionneur, « qu’est-ce qu’on peut venir faire chez vous ? », alors qu’à l’inverse, l’acteur culturel vient rarement questionner le champ social. Et on aura du mal à avancer sur ces questions-là tant que ce rapport n’aura pas changé.
Mais à propos de la participation pour les équipements culturels, il y a des choses aussi très positives. Il y a des cadres d’action qui se généralisent et on peut aujourd’hui évoquer le CUCS avec un certain nombre de partenaires culturels qui aujourd’hui se saisissent de cela. Donc, on a l’impression que ça avance. Par exemple le petit Faucheux (salle de Jazz et de musique improvisée sur Tours), qui a décidé de dédier une enveloppe d’action culturelle à des projets sociaux, avec les habitants et les usagers et de sortir des formats un peu standardisés, scolaires etc. Une douzaine de salon de musique improvisée ont ainsi été créés dans des structures sociales, dans des pensions de famille… Et là, les préjugés tombent, comme quoi la musique improvisée serait un peu compliquée pour les gens, et au contraire, les gens sont très intéressés.
Il y a 10 ou 15 ans à propos de la participation des habitants, on disait que le grand méchant, c’était le technicien, l’ingénieur, l’urbaniste qui n’avait pas envie de partager son savoir. Cela semble de moins en moins vrai. Aujourd’hui, ce sont les acteurs culturels qui ont un peu l’impression d’être dépossédés. Ils acceptent d’être sollicités mais ils ne sont pas tellement dans la démarche inverse d’aller faire des propositions et d’aller monter des projets. Finalement, l’acteur culturel fait assez peu de médiation culturelle, même si cela existe parfois.
Il y a également les logiques de travail très sectorisées au sein des collectivités. C’est très rare que l’urbanisme, le social, le tourisme, la culture se disent « tiens, on a la même problématique, est-ce qu’on ne pourrait pas travailler ensemble sur une même action ? » Et souvent, cela vient d’opérateur extérieur avec des techniciens et des agents qui n’attendent que ça dans les collectivités, d’avoir un prétexte pour travailler de manière transversale.
Ces remarques font écho avec d’autres éléments expérimentés dans le programme ECLIPS. L’un des aspects observés, c’est que la participation trouve ces limites dans le cloisonnement de tous les intervenants sociaux ou les acteurs de la ville. En écoutant les expériences de chacun, on voit des acteurs à la croisée de pleins de compétences (médiateurs, sociologues, animateurs, postures engagées et politiques, gestionnaires administratives…). Comment aller à l’encontre de ces cloisonnements ? A écouter les pratiques de ballades ou d’interview, cela renvoie beaucoup à des pratiques de chercheurs, et notamment de sociologues. N’y-t-il pas des liens ou des ponts à faire avec d’autres compétences, notamment la recherche ?
L’association « Pas sans nous » s’est dotée d’un conseil scientifique et technique au niveau national. Et la possibilité d’avoir un conseil scientifique et technique au niveau local est envisagée, bien que cela semble lourd à organiser. Il y a aussi l’observatoire des inégalités avec des possibilités de partenariats.
Complément : l’association Bouche à Oreille et l’expérience « Ensemble Cour du Languedoc »
Un autre collectif avait été invité à cette journée, l’association « Bouche à Oreille », qui est intervenu à Metz dans le quartier de Borny, un des plus grands quartiers d’habitat social de l’Est de la France : 15 000 habitants, 5000 logements, des grandes tours et des grandes barres, l’urbanisme fonctionnaliste des années 60 aujourd’hui en crise. Et dans ce quartier, il y a une énorme cour formées par 4 barres d’immeubles, qui s’est beaucoup paupérisée, avec des difficultés sociales, le trafic de drogue, un bailleur peu présent. Et un jour, cette association « Bouche à oreille », fascinée par ce lieu, arrive avec un projet plutôt événementiel, de faire un son et lumière avec les habitants dans la Cour du Languedoc. Et cela fait 3 ans qu’ils sont là et qu’ils sont restés, qu’ils ont refait des spectacles, qu’ils accueillent les jeunes, des migrants, etc. Ils accompagnent désormais complètement la collectivité et le bailleur autour de la rénovation de ce quartier. Et ce qui est intéressant dans leur expérience, c’est qu’ils étaient vraiment dans une démarche événementielle au départ et qu’ils sont restés, avec beaucoup de questionnements évidemment.
Une vidéo est projetée sur cette expérience : « Ensemble Cour du Languedoc »1.
Elsa VIVANT – Les collaborations entre artistes et urbanistes : de nouvelles formes de médiation et de participation des habitants
Il s’agit d’une présentation d’une recherche tout juste achevée qui relie les questions de production de la ville, d’intervention artistique et de participation citoyenne. C’est donc une première tentative de formalisation d’un des aspects de cette recherche conduite avec le soutien de la Région Île-de-France1. Elle visait à étudier des expérimentations où des artistes et des urbanistes sont amenés à travailler ensemble par rapport à un problème que se pose l’urbaniste et concernant, d’une manière ou d’une autre, la prise en compte des usages et des usagers. L’hypothèse de départ était que ces collaborations étaient propices à l’innovation urbaine, en particulier des innovations de process ou de méthodes.
Les formes de collaborations étudiées sont très diverses, les rôles que peuvent jouer les différents intervenants peuvent être très variés (qu’il s’agisse de l’artiste, de l’urbaniste ou de l’usager). Aujourd’hui, l’exposé ne portera que sur les rôles qui étaient fait jouer aux usagers. Et ce qui est intéressant sur cette question des rôles que joue chaque type d’intervenant dans les dispositifs, c’est que le rôle ne préjuge pas des modes de participation : ce n’est pas parce que, par exemple, un usager ne rencontre pas physiquement l’urbaniste que sa parole, sa position, ses intérêts ne sont pas énoncés et prise en compte.
Les cas étudiés
Cinq expérimentations très différentes ont été étudiées. Celles-ci sont anonymisées. Il s’agit :
– de la création d’un spectacle sur le thème de l’inondation ;
– des professionnels de l’urbanisme qui essayent de réinventer leur propre méthode de travail en mettant en place des ateliers où ils mobilisent d’autres types de professionnels, dont des artistes ;
– d’un dispositif de formation qui vise à associer des artistes et des chercheurs par rapport à des problèmes réels, au sein duquel a été étudié un projet monté dans une ville de région parisienne qui est l’objet d’un gros programme de rénovation urbaine et où les professionnels de la ville se posent la question de l’appropriation des espaces publics ;
– d’une expérimentation de recherche-action montée par l’équipe de recherche, où ce sont des artistes sonores qui sont intervenus pour concevoir une cartographie sonore d’un territoire en projet, en lien avec les problèmes que se pose l’urbaniste pour la définition de son projet par rapport aux usages de cet espace ;
– d’un collectif de jeunes architectes, paysagistes et urbanistes qui veulent exercer leur travail différemment et qui répondent à un appel à projet pour créer un lieu temporaire de communication sur un projet urbain dans un quartier ANRU. Leur proposition va être de concevoir avec des habitants un jardin, leur objectif étant non pas de créer un jardin mais de développer les capacités des habitants à savoir comprendre les enjeux de transformation du territoire, à prendre une position et à la défendre. Et dans ce cadre-là, ils vont faire intervenir un artiste en amont, un comédien qui joue un rôle dans cette histoire pour enrôler les habitants à l’expérience.
On identifie globalement 3 rôles que jouent les usagers dans ces expérimentations (un usager pouvant jouer plusieurs rôles) :
Le rôle de l’usager qui a des connaissances sur le territoire, pour lesquels il va falloir trouver un moyen de les recueillir et les transmettre ;
Le rôle de l’usager qui participe à l’expérimentation et qui va faire les choses qu’on lui demande de faire ;
L’usager qui va participer à la production, à la conception de quelque chose et qui va progressivement essayer d’avoir une influence sur la décision.
Ces différents rôles vont être illustrés chacun par des exemples :
1- L’usager ressource
Il y a tout d’abord le rôle de l’usager qui est une ressource pour avoir des connaissances sur le quartier. On peut l’illustrer avec l’expérimentation montée par des étudiantes dans le dispositif de formation : pour comprendre les modes d’appropriation des espaces publics, elles ont décidés d’aller chez les gens et de les interviewer à leur fenêtre en leur demandant de décrire le paysage, de décrire ce qu’ils voient. Ce travail de description va amener les personnes à parler de leurs préoccupations quotidiennes, sans pour autant que ce soit la question explicitement posée. On a là un premier dispositif de recueil de paroles qui vise non pas à demander un avis, un jugement mais seulement à raconter une perception. De par cette modalité de recueil de paroles vont surgir des informations qui, aux dires des professionnels, destinataires de l’ensemble de l’expérimentation, sont nouvelles. De ces paroles, les artistes-élèves ont transcrit tous les entretiens et en ont retenus quelques extraits sur lesquels elles se sont appuyées pour écrire un récit, un dialogue, qu’elles ont lu aux professionnels de l’urbanisme. Pour faire cette lecture, elles ont reperfomé le dispositif de recueil puisque les professionnels étaient assis face à des fenêtres et les lectrices étaient derrière eux et leur lisaient, dans leur dos, les extraits. Ce dispositif de scénographie rendait beaucoup plus efficace l’écoute par les personnes des propos qui leur étaient tenus. Les évaluations qui sont faites du dispositif par les professionnels concernés étaient assez fortes : déjà, ils ont entendus des choses qu’ils n’avaient jamais entendues et, surtout, ils se sont rendu compte que, par rapport aux dispositifs habituels de concertation, il pouvait y avoir d’autres formes de médiation de la parole habitante qui permettaient de sortir d’une logique de confrontation dans laquelle ils ont l’impression de toujours se trouver lorsqu’ils sont dans des réunions de concertation, pour faire émerger d’autres informations, d’autres ressentis sur le territoire. Il y a là un premier apprentissage qui est que l’usager a des choses à dire mais que, pour que ces informations ou ces sentiments par rapport à l’espace puissent être compris et appropriés par le professionnel, il y a besoin d’une médiation, et là ce sont des artistes qui font cette médiation.
Un autre exemple du même ordre : c’est le collectif de jeunes architectes-urbanistes qui décident de créer, avec les habitants, un guide touristique. Pour cela, ils vont demander aux habitants un certain nombre d’informations sur leurs quartiers, en particulier tous les petits secrets que l’on a sur son quartier -le meilleur boulanger, les raccourcis pour aller à l’école…- pour donner à voir toutes les petites choses positives du quartier. Pour le collectif, c’était une manière de faire prendre conscience aux habitants que, dans ce quartier, il y avait aussi des qualités, des espaces plus agréables que d’autres et qu’on pouvait renseigner un visiteur sur les lieux agréables de son quartier. Cela a aboutit à la production par le collectif du guide touristique, puisqu’à la fin, c’est le collectif qui a transformé cette parole en un format manipulable. Pour le coup, ici, l’artiste a disparu et celui qui fait la médiation de l’information, c’est le professionnel.
2- L’usager participant dans le dispositif qu’on lui propose
En restant sur ce même exemple, ce collectif de jeunes architectes-urbanistes doivent convaincre les habitants à venir participer à leurs ateliers de jardinage. Ils vont alors créer un personnage fictif qui va être joué par un comédien, qui est là un interprète d’un rôle qu’il n’a pas écrit lui-même. Ce comédien joue le rôle d’un voyageur à la découverte du quartier, qui est aussi un jardinier et qui va chercher à enrôler les habitants, en leur proposant à boire, en créant un petit dispositif de terrasse ambulante, pour inciter les gens à s’arrêter devant cette chose un petit peu inhabituelle et à commencer à dialoguer. Il va revenir plusieurs fois sur le quartier et quand il revient, les gens qui l’ont déjà vu une fois reviennent le voir, prennent de ces nouvelles et progressivement, ce personnage s’inscrit dans l’histoire du site, dans la vie du quartier. Et alors même que le comédien va disparaître au fur et à mesure de l’avancée du projet, il va rester dans la mémoire et les habitants vont continuer à demander de ses nouvelles. C’est un personnage fictif, personne n’est dupe, mais il va permettre de construire un récit autour de l’intervention de ce collectif et va permettre l’enrôlement des participants. Un petit groupe de 10 à 15 habitants, plus des enfants, vont participer plus ou moins régulièrement aux activités que propose ce collectif, aux cours desquels, au début, ils suivent les consignes du collectif. Ils vont par exemple participer à un atelier de création de mobilier urbain mais vont être plutôt des exécutants que des concepteurs des ateliers de bricolage ou de jardinage.
3- L’usager coproducteur
Mais progressivement, ils vont prendre un autre rôle, ce qui devient intéressant par rapport aux questions de participation citoyenne. D’une manière un peu surprenante, ces usagers de la jardinière vont progressivement déployer un troisième rôle délicat à qualifier, « co-concepteur », « co-producteur »… ces termes ne conviennent pas tout à fait, mais en tout cas, ils changent de rôle, parce qu’ils vont prendre à bras le corps ce projet de la jardinière et vont le faire leur. Le collectif de jeunes architectes-urbanistes s’implique de moins en moins dans le projet, pour diverses raisons, et ce petit jardin, créé de manière temporaire, est détruit mais les habitants vont négocier le fait qu’un nouveau jardin soit créé. C’est eux qui vont choisir le meilleur emplacement en se servant de toutes les savoirs qu’ils ont appris grâce à l’intervention du collectif qui a fait avec eux non seulement des ateliers de jardinage et de bricolage, mais aussi des ateliers de lecture de carte, de compréhension d’un certain nombre de savoirs un peu plus techniques. On a là une nouvelle figure de l’habitant qui est l’habitant qui commence à devenir un acteur de la transformation de son quartier, et qui va revendiquer quelque chose, grâce à l’intermédiaire d’un travailleur social du centre social qui s’est beaucoup investi dans le projet et a servi de médiation entre le collectif et les habitants et qui va porter la voix des habitants auprès de la collectivité locale. Donc là, on a un autre acteur qui rentre dans la boucle, qui est l’agent du centre social qui va rendre possible l’expression du sentiment du point de vue des habitants.
Donc, on retrouve ces trois rôles et on pourrait faire la même typologie pour éclairer les rôles que peuvent jouer les artistes et les professionnels de l’urbanisme dans ces dispositifs et on se rendrait compte que les artistes ou les urbanistes pouvaient eux aussi être amenés à jouer des rôles assez proches des trois qui viennent d’être décrits, à savoir « ressources pour l’action », « participant-exécutant de tâches » ou « acteurs qui prend position et défend un point de vue sur la transformation ». Ces positions sont peut être exagérées et demandent encore à être validées et consolidées.
Questions en suspens
Il reste quelques questions en suspens : par rapport aux objectifs que s’étaient fixés les initiateurs de ces différentes expérimentations, les ont-ils atteints ? Plus ou moins en fait : dans le cadre de la jardinière, ce projet d’émancipation citoyenne arrive à un certain résultat, mais dans d’autres cas, les attentes formulées au départ n’ont pas toujours été rencontrées.
La deuxième question qui se pose est celle de la représentativité, question permanente dans ces enjeux de participation citoyenne. Dans le cadre de la jardinière, cela concerne un tout petit groupe d’habitants, 10 à 15 habitants. N’est-ce pas assez ou déjà beaucoup ? Pourrait-on en avoir plus ? Difficile à dire mais il faut quand même souligner que ce n’est pas des dispositifs qui peuvent s’adresser à un grand nombre de personnes. De la même manière, pour les entretiens à la fenêtre, cette activité a été faite avec 7 personnes. En quoi cela est représentatif ? C’est avec leur subjectivité que les artistes construisent un récit, mais la question de la représentativité de la parole reste complètement posée.
La dernière question soulevée par ces expérimentations observées est la question de la place de l’art. On s’est rendu que, quand bien même des artistes sont présents dans les dispositifs, tous ne sont pas là pour créer quelque chose et quand bien même on a l’impression de l’extérieur qu’ils créent une œuvre, qu’ils créent quelque chose, en fait, pour eux, ce n’est pas si simple que cela. Par exemple, dans le cas de la performance sur les lectures d’extraits à la fenêtre, tous les gens interrogés sont persuadés que le moment où il y a œuvre d’art, c’est le moment où il y a cette performance, des textes sont lus et mis en scène, il y a une scénographie et pour toutes les personnes qui participent, ils sont persuadés que c’est à ce moment-là qu’il se passe quelque chose d’artistique. Pour l’artiste qui a monté le dispositif, ce n’est pas du tout à ce moment-là qu’il y a de la création artistique, elle n’est pas satisfaite d’avoir fait cela, elle le fait car elle est dans le cadre d’une commande et qu’il y a une attente mais, pour elle, le moment où il se passe quelque chose d’artistique, où il y a une expérience esthétique, c’est quand elle est à la fenêtre avec les habitants et qu’elle discute.
C’est un travail en cours et les interprétations de tous ces éléments ne sont pas encore finalisées.
Discussion avec la salle
Question sur la place des élus et du personnel politique dans ces expérimentations
On parle beaucoup de co-construction, co-conception, coproduction mais derrière, le modèle très hiérarchique demeure prégnant : l’habitant en bout de chaîne, le service technique qui a la charge de l’expertise et l’élu qui orchestre les choses.
En fait, cet aspect se révèle être très différent suivant les cas. Elsa Vivant propose de revenir sur un des exemples, le cas du dispositif de formation, qui illustre bien cette question de la place de l’élu. En fait, les artistes vont travailler avec les urbanistes de la ville, mais les élus ne le savent pas. Tout se fait sans convention ni financement, et puisqu’on est dans un dispositif de formation, on s’autorise des libertés qu’on ne s’autorise pas d’habitude. C’est seulement à la fin, lorsque l’on a aboutit à quelque chose, ce qui n’était pas du tout sûr au départ, qu’ils vont informer les élus. Et cela ne se passe pas bien du tout, car lorsque les artistes présentent leur travail à l’élu, il ne comprend rien car il n’a pas participé à toute la démarche. Ce qu’expliquent les professionnels de cette ville, c’est qu’ils n’auraient jamais pu le faire s’ils avaient informé leurs élus en amont, parce qu’il aurait fallu rendre des comptes aux élus. Et là, ils ont pris beaucoup de liberté et de temps car ils n’avaient pas à rendre de compte à des élus (et parce que le DGS est là depuis 20 ans et a la confiance de l’élu). Et ils ne demandent pas aux élus car ils ne sont pas capables d’expliquer ce qui est en train de se passer (travail de collaboration très forte avec les artistes) et ils ne savent pas quoi en attendre. C’est peut-être la situation qui permet le mieux d’éclairer de façon un peu extrême la place des élus : dans certain cas, il n’y a pas d’élu. Ce cas éclaire bien cette ambiguïté et le fait que ce n’est pas facile non plus pour les techniciens de prendre des libertés par rapport à leurs obligations de travail. Dans d’autres cas, les élus sont au contraire très présents dans la mise en place du dispositif et vont être très demandeurs
C’est un peu une démonstration par l’acte, qui renvoie à l’idée de prendre la liberté. Cela renvoie aussi à un précédent séminaire du programme ECLIPS (décembre 2014) où il était question pour les techniciens « pour pouvoir avancer, d’être obligé de marcher dans l’ombre du monstre ». Si on reste dans un système décisionnel hiérarchique avec validation des élus, plus on met de points de validation, et moins on avance. Et là, ils peuvent se le permettre car il n’y a pas d’argent en jeu, pas de convention.
Par contre, il y a des comptes à rendre vis-à-vis de l’école, qui fait office de tiers dans cette expérience-là. Et souvent dans les expérimentations observées, il y a un tiers. Et le rôle de ce tiers est variable : tiers de mise en relation des parties-prenants ; tiers qui construit un cadre de pensée, un cadre d’action très formel ; tiers qui joue le jeu de commanditaire. Ici, le dispositif de formation en lui-même va aller chercher la commande auprès de la ville, construit le cadre de pensée et d’intervention. L’opérateur d’intermédiation, ce sont les enseignants de cette formation.
Question sur l’intérêt de la figure du voyageur comme amorce pour intervenir dans le quartier.
Le parti-pris était de dire que personne ne vient jamais dans ce quartier et la figure du voyageur qui arrive peut être une manière de faire changer le regard des habitants sur leur quartier, puisque quelqu’un s’y intéresse. Il s’agit de construire un récit où le quartier peut avoir un intérêt pour quelqu’un qui vient de l’extérieur, a des secrets, des choses positives et l’enjeu, c’est de réussir à les montrer à ce voyageur. On mesure les traces de cette figure du voyageur au cours des entretiens ex post. Les habitants s’en souviennent, en parlent, des habitants demandent des nouvelles… Personne n’est dupe, sauf les enfants, un peu à la manière du père noël… D’autres éléments vont permettre de conserver cette mémoire du voyageur : en conservant les mêmes codes visuels dans la manière de décorer l’espace lors d’interventions, en créant un guide touristique, en faisant des cartes postales, la rhétorique du voyage reste tout au long du projet.
Question sur le rôle des artistes dans ces projets, qui ne sont pas des projets d’artistes, mais des projets où il y a des interventions artistiques à des moments.
Dans les cas étudiés, les artistes ne sont jamais à l’origine des projets. Mais en même temps, trouver des situations où il y a vraiment une relation qui se monte entre l’artiste et le professionnel au regard d’un problème que se pose le professionnel n’est pas évident.
Du coup, il est possible d’analyser à quel moment est convoquée la figure de l’artiste dans ces projets. On retrouve les mêmes catégories qu’avec les habitants-usagers. En gros, il y a l’artiste qui est médiateur de la parole de l’habitant, qui par ses moyens artistiques de représentation traduit la parole habitante en quelque chose de différent qui est une représentation de cette parole ; l’artistes qui est le créateur, le concepteur de tout le dispositif ; et puis l’artiste qui est plus un exécutant, un interprète comme un instrumentiste ou un comédien. Il y aura peut-être ces 3 figures-là à l’issue de l’analyse. Et de la même manière, le professionnel joue différents rôles : il peut être juste une ressource pour la création, car il a des savoirs et qui va alimenter la réflexion de l’artiste ; il peut être aussi un participant comme un autre qui ne fait qu’exécuter des choses qu’on lui demande de faire ; et il peut être le concepteur même de l’expérimentation.
Par rapport aux discussions de la matinée et pour revenir à la notion de commun, ce qui est appelé artiste dans la médiation de la parole habitante, c’est aussi un artiste qui recrée ou retransmet du commun à partir de paroles individuelles mais qui vont être écoutées par tous, via l’œuvre alors qu’individuellement, elles ne s’écoutent pas les unes les autres. Mettre en commun, c’est faire écouter aux uns et aux autres ce qu’ils n’entendent pas.
Dans cette expérimentation avec la formation, on a vu dans l’exposé les rôles de l’usager, mais il y a aussi beaucoup de médiation de la parole des professionnels eux-mêmes vis-à-vis de leurs collègues et sur leurs propres préjugés, leurs pratiques, leurs représentations du territoire, etc. Il y a toute une médiation qui est faite par les artistes de cette parole qui est recueillie auprès des professionnels pour la médier vis-à-vis de l’ensemble du groupe des professionnels. C’est encore une trajectoire de médiation assez inattendue, du professionnel à lui-même, où l’artiste est vraiment un moteur de la réflexivité du professionnel sur sa pratique. Et comme on pose la question de la représentativité des usagers, on peut là-aussi poser la question de la représentativité des artistes : quels artistes s’engagent dans ces dispositifs ? Etc.
Question sur ce qui est explicitement demandé dans la commande, notamment la réalisation ou non d’une œuvre.
Par exemple, dans le cadre de la description à la fenêtre, la question se posait de savoir à quel moment il y avait œuvre ou pas œuvre. Mais dans la commande passée à l’artiste, est-ce que c’était un projet d’accompagnement ou est-ce qu’il y avait derrière, la réalisation d’une œuvre ? Dans ce cas-là, ce n’était pas du tout prévu. Une question était posée aux artistes : « On ne comprend pas, on vient de refaire les espaces publics et il n’y a personne. Expliquez-nous pour quoi les gens ne s’approprient pas les espaces publics… » Il n’était donc pas demandé de faire une œuvre. Et les artistes n’ont pas proposé a priori de faire une œuvre. Ce n’est qu’après 5 ou 6 mois de travail que l’idée a germé. Donc, il n’y avait pas l’intention de faire œuvre. Par contre, dans d’autres cas, oui, il y a un projet de créer une œuvre. La aussi, cela dépend des situations.
Marie-Kenza BOUHADDOU – Limites de la participation dans les pratiques artistiques dans les quartiers d’habitat social
On est dans un contexte d’injonction participative qui se traduit dans les projets urbains par des dispositifs institués. Et on peut se demander comment cette participation est censée se passer dans le cadre des projets artistiques. On voit par exemple, avec les propos de Joel Zask1, que participer existe bien sûr en politique et est illusoire en politique, mais que cela existe aussi dans d’autres formes renouvelées, alternatives, et notamment dans le champ artistique.
Les questions qui viennent ensuite sont les suivantes : la participation, dans le cadre de ces projets artistiques, est-elle de même nature que dans le cadre du champ politique ? Revêt-elle les mêmes formes et répond-elle aux mêmes mécanismes que la participation dans le cadre de projets urbains ? Est-ce à dire que participer en art revient à la même chose que participer en politique ? Pourquoi l’art ferait participer? Qui ferait-il participer et à quoi ? Quelles sont les limites de cette participation ? Existe-t-il des formes de récupération (politique, sociale ou autre) ou même d’institutionnalisation ? Quelles formes cette récupération, voire cette institutionnalisation prennent-elles ? Participer, pour qui et par qui ?
Le terme de « participation » étant très galvaudé, Joëlle Zask propose de faire une distinction entre « participer » et « participation ». Selon elle, il y a quelque chose de stérile dans la participation, parce qu’on convoque des gens dans des dispositifs qui ne sont pas de leur fait, et dans lesquels ils n’ont pas participé à leur constitution. De fait, ces gens sont appelés à jouer un rôle pour faire fonctionner une machine démocratique qui en légitime l’existence. Pour elle, il y a nécessité à revenir sur le sens de ce terme de « participation ». Elle propose donc un modèle de « démocratie contributive ».
Participer, c’est un « faire », un ensemble d’actions ou d’activités, par essence ordinaire (autour de l’intime ou du quotidien comme cela a pu être évoqué durant la matinée) et informel la plupart du temps. Pour elle, cette participation peut se décliner en trois moments : le « prendre part », le « contribuer » dans lequel on apporte une part et enfin, le « bénéficier d’une part» dans le sens de recevoir une part. Ces trois moments sont corrélés les uns aux autres.
On verra comment s’opèrent les modalités de cette participation spécifique en art, quels sont ses acteurs, ses projets et ses finalités pour comprendre où se trouvent les limites de cette participation et de quelle façon elle est récupérée, voire institutionnalisée.
Une participation spécifique
Participer en art est assez spécifique. Pour les acteurs artistiques, il y a deux types d’artistes, ceux pour qui participer relève de leur propre processus artistique et ceux à qui l’on demande de participer.
Les artistes à qui les commanditaires de l’œuvre demandent la participation sont assez peu capables de l’intégrer à leur processus artistique. Marie-Kenza Bouhaddou a étudié pendant deux ans un projet qui s’appelle le 8e Art, dans le 8e arrondissement à Lyon, qui une commande publique artistique menée par le bailleur social Grand Lyon Habitat entre 2007 et 2014. Durant cette commande, il a été demandé à une dizaine d’artistes de placer la question de la participation des habitants au cœur de leur proposition. Sur les dix propositions retenues, une seule répondait à cette attente et encore, elle bornait la question de la participation à une simple concertation d’un très petit nombre d’habitants, faite via une interprète, puisque l’artiste n’était pas francophone.
Au contraire, pour les artistes pratiquant l’art relationnel, contextuel ou participatif, la participation s’inscrit au cœur de leur processus artistique et cela en est même une condition de réalisation et d’existence2. C’est le cas d’un artiste comme Thierry Boutonnier, qui a initié un projet dans le 8e arrondissement de Lyon, qui s’appelle « Prenez Racines ! », mené depuis 2009 dans le quartier Mermoz. Cet artiste utilise non seulement le contexte et le public pour faire exister son œuvre, mais il recherche très activement une coopération et une co-fabrication de l’œuvre avec les habitants, mais aussi avec les autres acteurs.
Ces acteurs artistiques participent au « faire » et ils contribuent à faire rayonner le projet à l’extérieur. Ils participent par ce rayonnement à sa légitimation soit auprès d’autres artistes, du public, des experts ou d’institutions artistiques. Les acteurs sociaux sont les destinataires, les faiseurs et les contributeurs des projets artistiques. Ils interrogent le rôle, les pratiques et les expertises des autres acteurs.
Les projets dans lesquels la participation est une donnée importante s’adressent souvent à des publics dits « prioritaires », « spécifiques » dans des quartiers dits « d’habitat social », « sensibles », ZUP, etc. Ainsi, on fait participer un public d’invisibles, un public de gens que l’on n’entend pas et surtout des gens qui ne participent pas à la vie locale, qu’elle soit sociale ou politique. Cela repose sur un postulat non démontré que participer en art serait un substitut ou un tremplin vers une participation politique, alors que participer en art met en évidence une autre forme de participation qui se retrouve dans le « faire », le « faire communauté », le « travail d’une communauté ou du commun », comme l’analyse Pascal Nicolas Le Strat. Ce mode de participation, s’il est social et politique, n’est pas politicien.
Dans le cas du projet Prenez Racines !, un groupe d’habitants est à l’initiative d’un jardin potager partagé depuis 2010. Il s’agit d’un espace autogéré qui ne faisait pas partie de la proposition artistique initiale et qui a été négocié par la suite. Il fonctionne tellement bien qu’il a été transplanté en même temps que la pépinière proposée par l’artiste l’a été, dans le nouveau projet de rénovation urbaine.
Dans ce même projet, l’artiste a proposé que les parrains et marraines des arbres signent des bancs positionnés derrière leur arbre transplanté, comme le feraient des artistes. Pour l’artiste, cela signifiait qu’il s’agissait vraiment d’une œuvre d’art et qu’il partageait complètement son expertise artistique avec eux. Lorsque cette proposition à été faite lors d’un comité technique, l’un des responsables de la mission territoriale s’est écrié que les habitants avaient déjà « bien assez participé ! » Finalement, ne figureront sur les plaques des bancs que les prénoms et initiales du nom de famille des parrains, précédés de la mention « avec ».
On voit un peu un décalage entre ce qui a été partagé par les gens et l’artiste et ce qui est finalement réalisé. Ces acteurs sont compris dans un « faire participer » qui met parfois à mal le « faire en commun » ou le « faire commun ».
Les acteurs techniques, eux, participent soit à la réalisation de l’œuvre quelque fois, et surtout, ils contribuent à assurer les conditions de sa mise en œuvre. Ils sont donc soit dans le « faire », soit dans une contribution à faire l’œuvre.
Les acteurs du politique sont à différencier des acteurs de la politique (politicienne – élus par exemple). Ces derniers participent à faire rayonner les projets dans un but de légitimer leur propre action publique, donc dans un but qui sert leur exercice politique. C’est pourquoi ils recherchent le plus souvent la quantité et la représentativité, avec tout ce que l’on sait de délicat dans une telle recherche. Et cette recherche de représentativité est d’autant plus présente qu’il s’agit de publics comme des jeunes, des publics fragiles ou des populations qu’on dit muettes, invisibles, etc. Cela justifie d’autant plus leurs « implications », qui se limite très souvent à être là dans les moments forts, à découper le ruban ou serrer des mains.
Les acteurs du politique, par contre, peuvent être les artistes eux-mêmes (souvent), les habitants (parfois) ainsi que certains acteurs techniques ou (assez sporadiquement) des acteurs de la recherche. Ceux-ci participent soit au « faire en commun », « faire commun » soit à penser le « faire en commun » ou le « faire commun », dans l’objectif de le « travailler » au sens où l’entend Pascal Nicolas Le Strat, c’est-à-dire à visée de développer l’empowerment ou la capacitation des gens, qui ne soit pas seulement un « agir-en-contre » au sens où Michel Foucault l’entend, mais bien qu’il se prolonge de façon positive dans une épreuve des possibles à explorer3.
Les acteurs de la recherche suivant leur posture (plus ou moins impliquée ou au contraire distanciée) participent à « faire » l’œuvre, à son rayonnement ou encore à sa légitimation vis-à-vis à la fois des acteurs de la (ou du) politique et des autres chercheurs. Ils peuvent être des observateurs extérieurs, ou relativement impliqués comme Marie-Kenza Bouhaddou a pu l’être dans le cadre des deux projets mentionnés, 8e Art ou Prenez Racines !
Dans le cadre de ce dernier projet (Prenez Racines !), Marie-Kenza Bouhaddou a pu proposer une forme de « recherche-création » lui permettant d’avoir une posture assez hybride, à cheval entre recherche et création, sans forcément avoir de visée créative. Cette posture était également à cheval entre les acteurs de la recherche et les acteurs artistiques. Cela a permis de comprendre, de l’intérieur, ce que signifiait cette forme d’engagement spécifique pour un chercheur, en termes de légitimité, de posture et même de compétences.
Marie-Kenza Bouhaddou a ainsi pu rapprocher la participation en art d’une réflexion sur l’engagement. Celui-ci était à la fois un engagement physique, dans le sens d’être présent sur le lieu, au quotidien, de prendre part en engageant son corps dans l’espace du projet, mais aussi un engagement éthique. Cet engagement cultive d’étroites relations avec la participation, qui se manifestent très souvent par l’attachement –une chose dont on parle assez peu.
Il existe une différence entre « être engagé » et « s’engager ». Cette analyse est le fruit d’une observation participante, longue et située. Celle-ci a permis d’observer dans la durée et de s’imprégner de la complexité des projets autant que des détails qui les constituent.
La difficulté ici réside vraiment alors dans l’objectivation du point de vue du chercheur, qui est non seulement acteur, mais aussi créateur de situation4, car comme le souligne Latour5, le chercheur est alors lui aussi pris dans cette situation.
A quoi participe-t-on vraiment quand on dit « participer en art » ?
Il se trouve que plusieurs des projets étudiés touchaient à l’environnement, notamment ceux présentés aujourd’hui. On peut alors se demander s’il y a un lien, et pourquoi cette dimension environnementale était sollicitée, dans ces quartiers d’habitat social, pour faire participer un type de population bien précis ? En quoi finalement la figure du « jardin » devenait-elle une sorte de prémisse de l’espace public qui aurait disparu de ces territoires ?
En reprenant les propos de Cynthia Fleury6 selon lesquels l’entrée en développement durable est corrélée à celle d’une entrée en démocratie, cela pourrait être une première piste pour comprendre. Après, la lourdeur des opérations de rénovation urbaine et l’importance des transformations pourraient également être « adoucies » par des interventions artistiques environnementales. En plus, cela « noie un peu le poisson », car faire de l’art en passant par le jardinage, c’est un peu moins brutal que proposer quelque chose de l’ordre de l’art contemporain, qui serait peut-être vécu, du moins on le pense, de façon arrogante.
Cette figure de l’arbre porte un certain nombre de symboles politiques et est assez paradoxale. C’est selon Guattari et Deleuze une figure bien distincte de celle du rhizome. Pour eux, l’arbre matérialise la fixité, le recentrement, le symbole de l’Un, de l’origine, mais dans le projet étudié Prenez Racines !, cet arbre est transplanté, décentré, transversal, et du coup, il devient rhizomique puisqu’il est mobile. L’arbre est tout autant vertical, qu’oblique et horizontal. C’est ce que l’on voit à l’œuvre dans Prenez Racines !
L’arbre est aussi un des symboles de la révolution française, puisque l’arbre de la liberté représente la vie, la continuité, la force et la puissance mais surtout à travers sa croissance, il symbolisait la vitalité des institutions nouvelles. Donc, l’arbre dans ce projet Prenez Racines ! est pris non seulement comme un symbole révolutionnaire, mais aussi comme un symbole presque spirituel d’origination, parce qu’il parle à des habitants qui sont, pour très grande partie, issus de l’immigration.
Cet arbre est une sorte de clé de lecture du monde. Il est vraiment vu par les gens et par l’artiste comme un « être collectif », qui est à la fois un être unique et pluriel, et qui est de nature coloniale7. Planter des arbres pour parler de dépeuplement d’un territoire qui est touché par le relogement, etc. ou parler de la dimension racinaire à un public de « déracinés » peut relever d’un paternalisme assez discutable. Cela rejoint en partie ce qui se fait dans les quartiers dits « politique de la ville » en termes de culture et d’art, à savoir des interventions artistiques qui vont viser à apporter un « supplément d’âme » dans une démarche de démocratisation culturelle, comme si les gens qui habitent ces quartiers n’avaient pas de culture.
Ensuite, à côté de cette figure de l’arbre, on a la figure du jardin. Le jardin est vraiment un lieu du « faire ». Ce jardin peut être vu comme une antichambre de l’espace public, un lieu où l’on s’entraîne au faire en commun, au faire commun. On passe d’un lieu de subsistance domestique à un lieu de fête collective. Et ce passage apparaît un peu délicat à comprendre. Comment s’opère le passage de l’art du jardin à un art de la rue comme on peut le voir avec le collectif Coloco par exemple, jusqu’à avoir un espace public qui est artialisé. Jardins Barges, du programme Opener à Dunkerque est un projet qui utilise complètement le vocabulaire du spectacle, des arts de la rue pour faire vraiment sortir le jardin de son site (vernissage dans le bus, forum populaire ou encore promenade en fanfare).
Cela nous fait vraiment passer d’un jardin qui est une affaire de propriétaires individuelles à un jardin que l’on partage collectivement. Comment passe-t-on d’un lieu enclos immobile à un espace public mobile comme c’est le cas pour Prenez Racines ! lors des fêtes appelées Tree Party? Comment le jardinier et l’artiste jardinier se mettent-ils en scène ? Le jardin comme lieu de fête est-il une réponse suffisante dans un contexte de disparition de l’espace public (ou tout au moins de crise de sens de l’espace public) ? Est-ce que la fête et l’événement participent de la fabrication de l’espace public et de sa pérennisation surtout ?
Dans Prenez Racines !, on a un jardin qui est une espèce de lieu de mise au point des pratiques en faisant, chemin faisant, dans lequel on va expérimenter, on va rechercher et surtout on va mettre en œuvre. C’est un tryptique à la fois pratique et réflexif, cela se fait dans un va et vient entre les champs du savoir et les champs de la pratique, et c’est là que ce « faire » trouve sa place. Ce « faire » est trans (de l’autre côté), il est un chemin de traverse entre différents champs et disciplines, entre la transmission et la mise en œuvre. Il s’agit d’une action à la fois individuelle et collective, dans l’optique de construire un « commun ».
Les finalités des projets : faire du lien, faire récit et faire participer les habitants
Il y a plusieurs finalités qui vont cohabiter. Dans le cas de Prenez Racines ! le site du projet est au cœur d’un quartier en rénovation urbaine, donc il y a plein d’enjeux autour de la création d’un vivre ensemble et du renforcement du lien social. La question qui se pose est alors de savoir pourquoi et comment des projets artistiques sont supposés favoriser le vivre ensemble et la création d’un lien social brisé, alors même que les actions publiques concernant le volet social ont par ailleurs en partie échoué.
Pourquoi l’art serait-il en mesure de résoudre des maux que les travailleurs sociaux ou socioculturels ne peuvent solutionner ? Les artistes sont-ils en mesure de porter une telle responsabilité -et en ont-ils envie ? Comment des pratiques artistiques pourtant marginales peuvent-elles inclure des populations elles aussi marginalisées, dans ce va-et-vient entre inclusion et exclusion ?
Ce projet, Prenez Racines !, explore vraiement la relation entre intérieur et extérieur, la mobilité, l’immobilité -voire immobilisme-, et ce projet est au bord, en marge. D’ailleurs, il se développe sur un interstice urbain, à la fois spatial (entre deux chantiers) et temporel (au cœur de plusieurs phases de transformation urbaine), et il enjambe et traverse ces temps et ces espaces.
Si ce projet donne du sens à un morceau de ville et porte un sens pour les personnes qui y participent, il n’est pas évident de montrer la relation qui pourrait exister entre le lien social et le vivre ensemble. Car ce sont des choses extrêmement ténues à observer. Et si l’on observe ce qui est à l’œuvre depuis 2009 entre les parrains des arbres, on voit que s’est constitué depuis cette période et autour d’autres choses qui ne concernent plus ce projet un groupe relativement homogène et soudé. On peut donc sans doute parler de création de lien social, puisqu’il y a entraide, puisqu’il y a organisation, puisqu’il y a solidarité, puisqu’il y a trouver des solutions en commun, qui existe à travers le projet et au-delà du projet aussi.
Pour un projet comme Jardins Barges à Dunkerque, la finalité est assez différente, puisque c’est avant tout un projet où on cherche plutôt à faire récit et à représenter la ville. On le voit par exemple lors de la journée bilan du programme, où les artistes ont proposé une cartographie à très grande échelle, réalisée au sol, avec une matérialisation des canaux de la ville pour montrer la relation qui pouvait exister entre les différents projets de Jardins Barges et l’eau. Lors du dévoilement de cette carte, un des élus à l’urbanisme s’est alors écrié qu’il s’agissait là d’un outil formidable de monstration et de pédagogie pour les habitants, afin qu’ils se « représentent » bien le lien de la ville avec ses canaux. La dimension artistique des projets était alors absente de son discours.
Alors même que ce programme était voulu comme un moyen pour que les habitants puissent « se réapproprier leur désir d’une ville partagée » : on a là deux notions qui coexistent, celle de l’appropriation (dimension sociale) et celle de la ville partagée, autrement dit de l’espace public (dimension politique), partant du postulat que des interventions permettraient via une appropriation des lieux par des habitants, de conforter ou de créer un espace public. Cela sous-entend un investissement sur un temps très long, ce qui n’est pas le cas pour un projet comme jardins barges où c’est un ensemble de petits projets qui ont été réalisés très rapidement. Cela n’a pas permis forcément de créer toutes les conditions pour en faire un espace public.
Dans Prenez Racines !, avec le jardin partagé, les habitants, les parrains, ont pu vraiment développer du pouvoir d’agir et une certaine forme de capacitation, même si c’est parfois assez ténu, qui s’est traduite par une montée en compétences (formation en taille d’arbre, formation en compostage et en construction de composteurs, en construction de cabanes, en construction de mobilier de jardin, aujourd’hui toujours sur le site de la pépinière).
Les limites de la participation
Elles concernent les différentes formes de récupérations voire d’institutionnalisations. Elles se heurtent tout d’abord à des difficultés à mobiliser les gens sur des temporalités longues, à instaurer une confiance ou encore à accepter le bricolage et l’ajustement comme des données vraiment constituantes du projet.
Tout d’abord, la récupération par les artistes. Pour certains, ils profitent un peu de cette injonction participative, pour s’emparer des projets et pour les faire rayonner, soit pour servir leur propre image, soit pour les mettre au service de réseau(x) qui sont un peu différent des réseaux qui existent dans les mondes de l’art.
Dans Prenez Racines ! par exemple, le projet a été l’occasion pour l’artiste, Thierry Boutonnier, de tisser des liens avec d’autres artistes, comme par exemple Monte Laster, un plasticien texan installé à la Courneuve. Ce dernier avait été invité à venir discuter de son projet lors des Rencontres Prenez Racines qui se sont déroulées en mars 2013, et Thierry Boutonnier, a lui aussi été à son tour invité lors de l’exposition Banlieue is beautiful montée par l’artiste américain au Pavillon de Tokyo à Paris. Cette exposition a été une occasion assez inespérée pour l’artiste lyonnais de se confronter à d’autres artistes (comme Thomas Hirschhorn) et à d’autres acteurs médiatiques comme des architectes (comme Lacaton, Vassal ou encore Paul Chemetov présents lors de cette manifestation).
Cet artiste en particulier développe le réseau de façon assez subtil en laissant croire qu’il échappe au monde de l’art contemporain alors qu’il en est aussi, d’une certaine façon, un pur produit (formé aux Beaux-arts, a exposé dans des Biennales renommées en Suisse et en France et dans des galeries prestigieuses). Mais du fait qu’il a aussi un certain nombre de compétences transversales (spécialiste de la pollution et de l’environnement, fils d’agriculteur, paysagiste, formation en sciences politiques), il étend en fait des réseaux vers d’autres mondes que ceux des mondes de l’art, et notamment vers les mondes de la recherche. Cette extension vers les mondes de la recherche s’est par exemple manifestée par une collaboration avec Marie-Kenza Bouhaddou, soit dans des temps de réflexion et d’entretien long, soit au travers de collaboration (écriture d’une fiction, rédaction d’un article).
Les artistes ne sont pas les seuls à récupérer les projets, les habitants aussi les récupèrent. Par exemple, quand le jardin potager s’est installé dans le projet Prenez Racines ! sur la pépinière, il y a eu une certaine forme de récupération par les habitants, et cette récupération a interrogé les autres acteurs du projet, notamment les acteurs techniques, qui voyaient poindre de nouveaux interlocuteurs à intégrer et avec qui il faudrait négocier. Du coup, a été faite plusieurs fois et de façon insistante la proposition à ces gens de se « monter en association », de façon à ce qu’on puisse les repérer. Car ce groupe, ce collectif un peu autogéré, informel, était difficile à intégrer pour les autres acteurs. Et le groupe a résisté jusque-là et ne s’est toujours pas monté en association. On voit vraiment qu’il y a une tension entre les tentatives de récupération par les uns et les autres et des habitants qui essayent de garder les commandes.
Les acteurs techniques, eux non plus, n’échappent pas à la règle. Par exemple, lors des Rencontres Prenez Racines, il y a les différentes présentations qui sont faites par chacun des chargés de mission de coopération culturelle ou de la mission territoriale, etc. et chacun, avec son vocabulaire propre, essaye de s’accaparer le projet, comme s’ils en étaient les commanditaires uniques.
Enfin, les acteurs politiques s’ils sont les derniers chronologiquement à récupérer les projets, ils le font souvent de façon très ostentatoire. On les voit de façon très forte lors des temps forts du projet (comme les Rencontres Prenez Racines !, les fêtes et les inaugurations) alors que pendant le temps de réalisation du projet, ils sont, sauf rares exceptions, complètement absents.
Conclusion
Ces projets sont en partie récupérés par l’ensemble des acteurs. Finalement, même cette mise en tension arrive à s’équilibrer.
On peut tout de même observer que les principaux pré-requis ou les « nécessaires de ces projets » comme le bricolage, la lenteur, l’intégration de la complexité des compétences et des temporalités, la confiance, la sérendipité, l’aléa sont finalement des choses très difficiles à mobiliser et une fois cela fait, ces éléments sont encore plus difficile à préserver.
On voit que le mode et la culture projet prennent très souvent le dessus sur la chronologie naturelle des projets, qu’il s’agisse de plantations ou d’êtres humains. La temporalité des projets est une temporalité inflexible qui va broyer tout autre type de temporalité. Cette dimension du quotidien est difficilement quantifiable et synthétisable sur un frise chronologique, qui pourra être découpée à souhait au gré des financements ou des mandats politiques.
Le bricolage, le réemploi, l’astuce et la ruse, malgré tout l’intérêt éprouvé, et notamment par les travaux de Michel de Certeau sur les « arts de faire »8, sont très peu mis en avant, alors même que l’économie de ces projets est très précaire et appelle à trouver des solutions avec peu de moyens. C’est pourtant des solutions assez efficaces pour valoriser des compétences qui peuvent exister chez les participants, et les amener alors à participer plus activement, de façon valorisée. Malgré cela, les acteurs techniques ne sortent que très peu de leurs plates bandes pour prendre la peine d’expérimenter sur le terrain des solutions contextualisées.
La confiance est aussi une donnée directement liée à une temporalité lente, qui est assez peu compatible avec celle de la rénovation urbaine ou du mandat politique. Sur le programme Opener, l’éloignement géographique n’a pas permis à Marie-Kenza Bouhaddou de mettre en œuvre ce rapprochement quotidien, et de ce fait, la faiblesse des liens tissés soit avec les participants, soit avec l’équipe montre que pour le « faire », il y avait vraiment besoin d’être présent au quotidien. Le « faire » n’est possible qu’au quotidien et dans une certaine lenteur comme pourrait le suggérer Pierre Sansot.
Ces lignes bien que souvent très rigides ont pu être bougées par moments dans le projet Prenez Racines ! Par exemple, à un moment, l’artiste a proposé a l’ANRU d’intégrer la temporalité de l’arbre comme temporalité dominante du projet. Et du coup, au lieu que le projet soit annualisé –puisqu’on ne sait pas au bout d’un an si l’arbre pousse ou végète-, l’ANRU a finalement accepté d’avoir un financement pluriannuel, ce qui représente vraiement une petite révolution !
Discussion avec la salle
Questions sur les effets de ces projets sur la rénovation urbaine et la planification ?
Finalement, les expériences présentées portent sur quelque chose autour du « vivre ensemble », de la « cohésion sociale », de l’intermédiation etc. mais elles n’ont somme toute pas tant d’effets que cela sur la production de la ville, sur la rénovation urbaine en elle-même, au niveau de l’aménagement urbain, de la planification spatiale ?
Le projet Prenez Racines ! était sur un interstice de démolition, où une première pépinière a été faite à cet emplacement. Ensuite, s’est implanté le potager, ensuite les arbres ont été transplantés sur le mail du projet rénovés. Et le projet ANRU a décidé d’intégrer la pépinière en lui allouant un espace de 750 m² de façon stabilisé (avec construction d’une cabane, connexion à l’eau courante…). Donc quelques lignes on bougé même si cela n’a pas révolutionné le projet ANRU. Mais depuis 2009, les arbres et le groupe sont encore là aujourd’hui et il y a quelque chose qui s’appelle la pépinière qui a été dessiné avec l’artiste et la paysagiste de la maîtrise d’œuvre, donc on peut commencer à parler de quelque chose qui dure un peu dans le temps.
De façon plus générale, il y a effectivement beaucoup d’usages temporaires ou événementiels de l’espace avec la collaboration d’artistes, sans aucun effet sur le long terme. L’enjeu de temporalité est donc extrêmement important pour qu’il se fasse quelque chose à moyen terme. Le constat est donc que ces projets ne débouchent sur rien de stupéfiant en termes de production urbaine, matérielle, mais par contre, dans certaines situations, il s’observe des évolutions de la part des techniciens de la ville sur leurs propres pratiques, une certaine prise de conscience que les choses pourraient être envisagées autrement en utilisant un autre vocabulaire, et donc une certaine remise en cause de leurs pratiques professionnelles. C’est pour cela que l’on parle d’une innovation de process ou une innovation méthodologique mais finalement, en termes de production matérielle, il n’y a pas de transformation des productions matérielles de l’espace. Mais déjà, des prises de conscience sur des enjeux de définitions, de méthodes, une remise en cause des pratiques professionnelles, c’est peut-être ça qui était le plus difficile à atteindre.
Ce serait alors plutôt les effets induits qui seraient recherchés, les traces qui vont être laissées du coté des techniciens et des habitants eux-mêmes, que l’on ne maîtrise pas mais qui peuvent faire émerger des choses.
Mais cela pose alors la question de la reproductibilité et de la montée en généralité de ces pratiques ? Car si les résultats sont de cette nature, beaucoup se disent « tout ça pour ça ! ». C’est beaucoup de temps, beaucoup d’engagement et d’attachement personnel pour être bousculé et finalement ne pas savoir comment se servir de tout ce qui s’est passé…
Et faire la ville, c’est peut-être d’abord cela : questionner ce qu’est une ville, ce qu’est un espace public. Il faut donc aussi accepter qu’il y ait du non-évaluable et du non-quantifiable et que tout cela à sa place dans la production de la ville. On est confronté à des acteurs urbains et des scientifiques parfois, qui renvoient à des questions d’évaluation de ces projets, alors qu’il faut accepter qu’ils ne sont pas évaluables, pas quantifiables.
Ce n’est pas parce que les choses sont très petites et tenues qu’elles n’existent pas et qu’elles n’ont pas un impact. En ce moment, Marie-Kenza réalise une cartographie avec l’artiste Thierry Boutonnier, qui reprend tous les micromouvements qui ont été faits de la pépinière vers le lieu de transplantation. Et ce n’est qu’en faisant cela que l’ont voit qu’il y a eu plein de mouvements et de choses, des transformations assez importantes. Mais si on prend le premier mouvement et le dernier mouvement, on ne peut pas voir toute la linéarité qui existe entre eux. Or, actuellement, il y a une forte demande de représentations visuelles, mais celles-ci dissimulent d’autres éléments notamment autour du process. Or les enjeux ici ne sont pas tant dans la forme ni dans le beau, mais dans le process.
Question sur la place du chercheur
Cette place est délicate, entre proximité et distanciation, tous deux nécessaires. Mais au final, on ne peut pas se détacher de l’attachement au terrain et aux gens. Pour comprendre des projets sensibles, il faut être dedans, avec les gens, en leur tenant la main, et en faisant des choses que ne fait pas un chercheur.
Question sur les conditions de reproductibilité de ces expériences
On observe qu’un dispositif qui a marché ne va pas fonctionner lorsqu’on tente de le refaire ailleurs, même en l’adaptant. Certains dispositifs étudiés se sont conçus au cours du temps, sans avoir toujours été pensé en amont. C’est donc une temporalité de projet et de partenariat tout à fait inhabituelle. Se lancer dans quelque chose dont on ne sait pas où ça va, c’est très anxiogène. Et il faut que les parties-prenantes acceptent cette incertitude. Et c’est aussi vrai pour les habitants.
Il y a un enjeu dans ces dispositifs qui prennent beaucoup de temps, il faut arriver à s’inscrire et tenir dans la durée. Et c’est peut-être le plus difficile et ce qui rend ces expérimentations très délicates à reproduire, car très peu d’acteurs arrivent à dégager le temps nécessaire. Il faut donc des acteurs, des artistes qui sachent résister à cela, qui ne vont pas proposer une forme tout de suite, qui vont imposer le temps de l’étude ou de la négociation. Ce sont des compétences qui sont nécessaires, mais qui sont difficile à sélectionner au départ du projet.
Question sur les manières de faire qui peuvent être reproduits
Cet aspect a suscité un débat. Certains pensent que ces manières de faire relèvent de l’ordre de la méthode : il y a des manières de faire projet, des étapes et un enchainement d’étape toujours reproduit de la même manière. Il peut y avoir des bonnes méthodologies, des points de réussite : quelque soit le médium utilisé et le territoire, la synergie des partenaires et des acteurs de ce territoire est une condition à la bonne mise en œuvre. Travailler en coconcertation avec les personnes et n’oublier personne, c’est une bonne méthode transposable.
Pour d’autres, c’est plutôt de l’ordre de la compétence (comme l’adaptabilité ou la plasticité au contexte), voire même de la sensibilité. Il n’y a pas de méthodologie et la transposition d’un territoire à l’autre reste une histoire de personne.
Savoir s’adapter et repérer avec qui on peut travailler, c’est une compétence. Mettre les gens en confiance c’est une compétence et ça s’acquière. Et il faut faire attention à ne pas naturaliser la compétence. Le défaut d’utiliser le terme méthode serait d’être dans la formalisation des process. Et c’est là qu’il y a un risque car ce n’est pas des process qui sont formalisés. Il y a des artistes n’ont pas de process. Et il y a des gens qui ont des routines qui reproduisent et qui fonctionnent mais ce n’est pas sûr que l’on puisse les formaliser. Il y a des opérateurs avec des process très formalisés, mais dès qu’on passe à un niveau de complexité supérieur, on se rend compte que leur process ne passe pas et qu’ils ne savent pas l’adapter. Ils ont donc une méthode mais qu’ils ne savent pas adapter et qui ne sert donc pas à grand-chose. Ou alors ces process formalisés ne sont pas reproductibles par quelqu’un d’autre.
Entre méthode et compétence, une autre proposition est de parler de l’intuition. Ne pas faire confiance à son intuition est une base de notre culture. Les artistes apprennent à faire confiance à l’intuition. Et si on n’a pas de pression financière ou de pression du projet, et si la rencontre est là, elle est là, si elle n’est pas là, on ne pourra pas la faire venir et il faudra revenir. Dans le cinéma, on parle de dispositifs pour « attraper le hasard ». La méthode, c’est peut-être cela. Avec l’expérience, on comprend mieux et on peut se choisir des dispositifs qui servent juste à « attraper le hasard ». Comment on navigue dans cette insécurité-là et comment on arrive à la transmettre de façon totalement invisible et non verbale, tout à coup, on sera dans un processus artistique, on sera dans une chose qu’on ne peut pas nommer, ni prouver, on sait juste qu’à un moment, ça va arriver.
Il y a aussi la question de subjectivité également identifiée. Dans le cas de la formation, ce qui a été très perturbants pour les professionnels de l’urbaniste, c’est qu’ils ont été confrontés à des subjectivités, là où ils sont toujours dans un effort d’objectivation. Ce rapport entre objectivation et subjectivité a été pour eux très déstabilisant. Un des apprentissages est celui-ci : les artistes n’ont pas cherché la représentativité, elles ont juste choisi les extraits lus à la fenêtre, en suivant leurs intuitions, pour sélectionner des expressions et des sensations qu’elles ont gardé telles quelles. Les professionnels se sont donc retrouvés confrontés à des subjectivités. Mais ils se sont aussi retrouvés confrontés à leurs propres subjectivités, à travers d’autres activités comme par exemple des ballades les yeux fermés (on leur fait ouvrir les yeux à des endroits donnés, les personnes ayant vécu l’expérience racontent tous un dépaysement et des expériences différentes pour chacun des participants). Ils se sont alors rendu compte que chacun vivaient un espace de manière différente, ce qui peut sembler naïf. Mais lorsqu’on est un professionnel qui doit rédiger un cahier des charges de maîtrise d’œuvre de conception d’un espace public, comment traduire cette diversité de vécu et de besoins, comment faire cet espace public qui répondent à tous le monde ? C’est une contradiction intenable et ils avaient complètement oublié cette diversité des subjectivités de l’espace. Car dans leur métier, ils ne pouvaient pas l’appréhender. Cet exemple-là en particulier a révélé l’importance qu’ont donné les artistes au fait qu’il y a des subjectivités et que ce n’est pas un problème. Ce sont des mediums de ces subjectivités.
Question sur les motivations qui conduisent les professionnels de la ville à faire appel à un artiste
Généralement, quand on fait appel à un artiste, c’est qu’on cherche un biais. Si on ne veut pas identifier le sujet de façon restrictive, en prenant le biais de l’art, on s’autorise plus de possibilités que si on contacte des cabinets spécialisés Et en prenant le biais de l’art, les gens vont peut-être aller sur des sujets de débat plus en profondeur, un peu plus sensible, car il y a une façon différente de le dire (comme le rire avec les arts de la rue par exemple).
Et il y a le plaisir, le plaisir du public, mais aussi le plaisir de celui qui commandite, de l’élu ou de l’agent… Et cette notion de plaisir n’est pas si simple à faire passer (car elle ne se quantifie pas et ne se valorise pas) dans ces dispositifs institués. C’est très important : des habitants qui passent un très bon moment en dehors de leurs habitudes. Mais convaincre les élus ou les agents sur ce point-là n’est pas évident (se faire plaisir alors qu’on est au travail…). Pourtant, c’est un facteur de réussite évident : cela fonctionne car ils se sont fait plaisir. Mais il faut aussi déconstruire ce qu’il y a derrière ce plaisir (un temps en dehors du quotidien, l’effacement de la hiérarchie entre collègues grâce à des dispositifs de prise de parole, de la bonne nourriture…), et on voit que ce sont des choses qui n’ont pas grand-chose d’artistiques mais qui font que les gens ont apprécié et ont donc accepté d’y consacrer du temps.
Une autre raison est de toucher un autre public : on reproche souvent de ne toucher toujours qu’un même public, or l’intervention dans l’espace public permet de toucher un autre public, notamment les enfants, et par ce biais, les parents voire les grands parents…
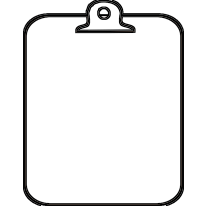
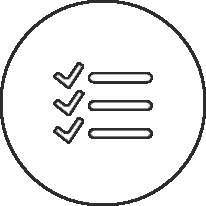
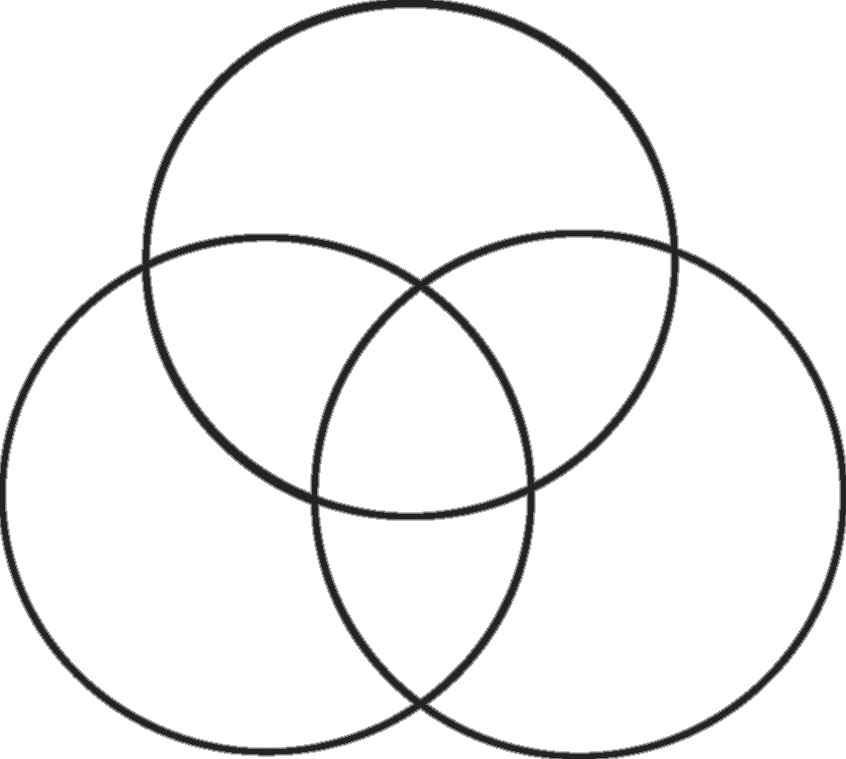
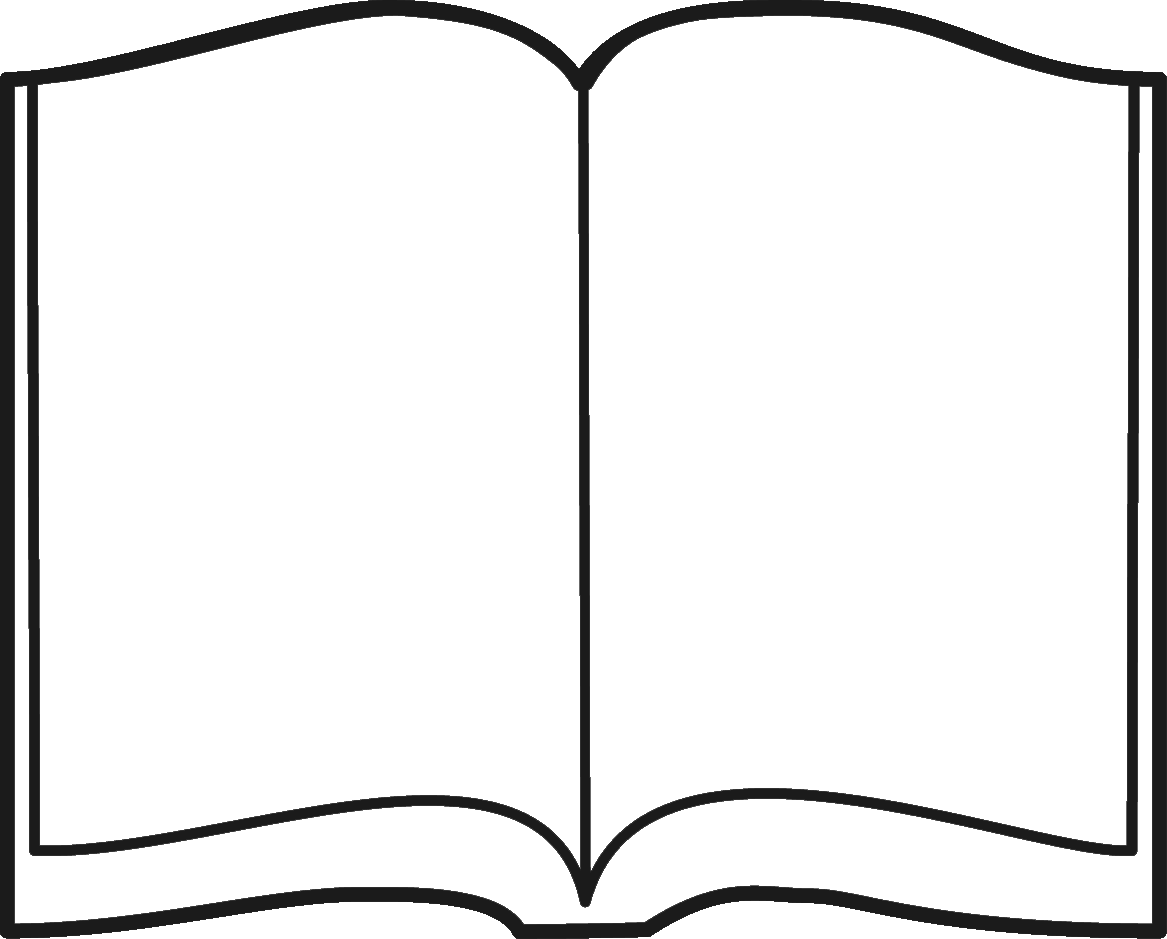



 Maud Le FLOCH
Maud Le FLOCH
 Pascal FERREN
Pascal FERREN
 Ida TESLA
Ida TESLA
 Elsa VIVANT
Elsa VIVANT
 Marie-Kenza BOUHADDOU
Marie-Kenza BOUHADDOU
 Séminaire précédent
Séminaire précédent Accueil
Accueil