Jérôme GUILLET – Retours d’expériences – Entreprise Matières Prises
Les origines
Jérôme Guillet revient tout d’abord sur les origines de son activité : la volonté au départ de dépasser le caractère fermé et l’entre-soi des débats politiques entre militants d’extrême gauche, en allant physiquement au contact de l’altérité, de « gens qui ne me ressemblent pas », dans la rue et en expérimentant différents dispositifs favorisant l’interaction avec les passants. De ces expériences, un dispositif s’est popularisé, par lequel Jérôme Guillet est entré dans l’univers professionnel de la participation. Il s’agit du « porteur de parole » : une ou des questions sont posées et affichées dans l’espace publique et les paroles et réactions des passants sont recueillies et également affichées, comme une sorte de « forum internet, mais dans la rue » ! Il a reçu beaucoup de sollicitations pour diffuser cette pratique, qui bénéficiera d’un véritable effet de mode.
Retour sur une expérience
Pour cette intervention, le choix est de partir d’une expérience vécue où ce dispositif est employé, pour questionner le flou persistant qui caractérise les compétences en jeu dans les nouveaux métiers de la participation. L’expérience est la suivante : en 2008, la ville de Vendôme le sollicite pour intervenir dans un quartier au Sud de la ville (un petit quartier mixte d’habitat individuel social et privé, de type pavillonnaire, accueillant 500 personnes) pour mesurer si les tensions identifiées par les services sont effectives et connaître plus précisément leurs natures.
Le principe et la forme de son intervention ne sont pas encore arrêtés lorsqu’une visite du quartier est organisée, rassemblant les habitants « pas contents », les élus, des agents de la ville mais aussi d’autres habitants. En participant à cette ballade, il voit une habitante pester en queue de cortège, déplorant la tournure de la ballade. Il l’aborde et lui propose de conduire une enquête en commun sur le quartier. Cette habitante, Marie-Thérèse, accepte la proposition et amorce un travail d’enquête avec ses voisins sur la base de la question suivante, dont la formulation s’avère importante : « Qu’est-ce qui est important pour vous dans ce quartier ? ». Une dynamique de « contagion positive » s’amorce, qui permet la récolte d’un pré-matériau riche. Et ces premières réponses sont affichées dans l’espace public durant deux séances, où les réactions des habitants sont à nouveau collectées. L’implication dans cette expérience d’interaction a eu pour conséquence d’interpeller Marie-Thérèse qui, voyant « derrière les murs ce qui se passait », est touchée par les formes d’isolement vécues par certains habitants. Au cours de cette expérience, la décision sera prise de créer une association de vie de quartier, encore active aujourd’hui.
L’expérience relaté, basée sur une commande un peu inédite, ne s’est jamais reproduite et demeure à ce jour la plus réussie, selon Jérôme Guillet. Et la réussite de cette initiative repose en premier lieu sur les habitants qui s’y sont investis, et non sur l’intervenant extérieur, qui au-delà du travail d’enquête, de classement et d’interprétation, n’est qu’un « prétexte », un révélateur de possible.
De l’expérience unique à la généralisation
Suite à cette expérience réussie, la ville a souhaité multiplié ce dispositif de « porteur de parole » et des agents de la ville, des animateurs socioculturels, se sont retrouvés à faire cet exercice, seuls, rapidement formés, jusqu’à l’écœurement. Ce dispositif a par la suite complètement échappé à son initiateur, les premiers rapidement formés en formant d’autres et proposant des prestations de « porteur de parole ».
Cela amène au questionnement suivant : quelle compétence à l’œuvre a permis cette expérience réussie ? C’est très certainement lors de cette promenade, dans une forme d’écoute flottante, à la recherche d’opportunités, en allant vers cette femme « en éprouvant quelque chose qui nous liait ». Il y aurait bien là une compétence à l’œuvre mais celle-ci demeure très délicate à nommer. Le temps aidant, un regard plus distancié sur ces pratiques permet de prendre conscience qu’il n’y a pas, en soi, de dispositifs magiques et que ces derniers cachent d’autres choses, masquent certains phénomènes discrets.
Quelles compétences à l’œuvre pour des expériences réussies ?
Jérôme Guillet s’appuie alors sur les travaux du sociologue Pascal Nicolas-Le Strat lorsqu’il évoque les différents enjeux inhérents à une méthode politique du travail en commun1 : pour qu’il y de l’empowerment, du pouvoir d’agir, il est nécessaire d’articuler correctement trois temps politiques, des dispositifs, des dispositions et des disponibilités. Jérôme Guillet propose son interprétation de ces trois notions :
Les dispositions que l’on prend, le sens donné aux choses et en quoi ce sens commun contraint à user de certaines règles, à respecter une éthique de la pratique, à avoir une visée politique.
Ces dispositions s’articulent à des disponibilités (ce qui pourrait être interprété comme ce moment de disponibilité pour entendre et écouter Marie-Thérèse au cours de la ballade, par exemple). Cette compétence s’apparenterait alors davantage à des compétences individuelles. « En quoi sommes-nous disponibles en termes d’imaginaire, en termes d’adaptation, en termes d’ajustement ? Et c’est une espèce de continent de la compétence, assez flou, des capacités relationnelles, des capacités à sentir les choses. »
Et, enfin, des dispositifs qui peuvent donner la pleine puissance, la pleine mesure ou au contraire jouer contre les deux premiers éléments.
« Les dispositifs semblent masquer le fait que dans la participation, il s’agit quand même et encore d’une forme de travail social qui est en jeu. Et de la part la plus obscure de ce qui est commun dans tout travail social, les compétences et l’habileté relationnelle, souvent désignées de manière assez pauvre par le terme de savoir-être. Le champ de la participation, en ce constituant progressivement comme champ professionnel, s’associe à l’émergence de dispositifs institutionnels nouveaux qu’il s’agit de faire vivre, et redouble la dimension technique et méthodologique, comme s’il fallait animer des dispositifs à l’aide d’autres dispositifs, trouver des petites machines pour faire fonctionner de plus grosses machines. Là, les méthodologies, les techniques et les méthodes servent beaucoup à camoufler, d’une part l’absence de courage politique, et de cela on en parle beaucoup, mais aussi la faible compétence des animateurs ou des intervenants en tant que stratège de la relation. Faible compétences en actes, certes, mais aussi une difficulté à nommer de quoi il s’agit. Et là, on s’agrège à des difficultés que l’on retrouve dans le travail social en général. »
Cette partie du travail des acteurs de la participation relative à l’animation semble centrale et problématique, car l’animation n’est pas un métier, c’est une sorte de métacompétence. Cette capacité à sentir les choses, à s’ajuster, à intervenir, à laisser faire, à se taire, à provoquer, se révèle nécessaire autant à des enseignants, qu’à des travailleurs sociaux, qu’à des chargés de mission à la démocratie locale. Quelque soit le public auquel on fait face, on a besoin de ces compétences. Et il y a là typiquement un flou. L’animation pose problème, car il s’agit au sens strict de mettre en vie, de mettre en mouvement des situations et des gens, et que cette compétence s’avère nécessaire dans une multitude de champ professionnel, et même au-delà. Et il y a une part incompressible d’animation, quelque chose d’irréductible qu’aucun dispositif ne peut venir compenser. Et il se trouve que beaucoup de gens sont d’assez mauvais animateurs et que les bons animateurs ont souvent des difficultés à expliquer pourquoi ils réussissent les performances relationnelles dans lesquelles ils sont. » Jérôme Guillet a trouvé dans l’ethnométhodologie ou dans la microsociologie des ressources descriptives, mais au sein des institutions, quelle qu’elles soient, aussi grandes que petites et y compris dans le monde associatif et aussi là où on forme les gens, il a trouvé très peu de choses à cet endroit.
L’hypothèse avancée autour de l’animation peut paraitre large et partiellement étayée. Pour autant, l’absence de travail à cet endroit constitue un parent pauvre et un angle mort sur la participation. Et derrière la figure valorisée de celui qui a du charisme, on rate certainement quelque chose. Et c’est vrai des acteurs de la participation comme ailleurs : on l’a ou on l’a pas et ça ne s’apprend pas. L’hypothèse serait alors celle-ci : qu’une partie du flou entretenue le sera toujours, d’une manière ou d’une autre, si on n’arrive pas à devenir plus compétent à cet endroit. Et cette difficulté à nommer les choses renforcent encore plus la croyance en la magie des dispositifs.
Discussion avec la salle
Questions sur le parcours de l’intervenant et l’historique de la structure.
Au début, Matière Prise était une association sans activité professionnelle, qui intervenait sur des festivals. Lors d’une présentation à une conférence de consensus de la ville de Paris sur le travail de transformation sociale dans les centres d’animation jeunesse, l’adjointe à la jeunesse de la ville de Paris a souhaité sa collaboration, ce qui a provoqué une démultiplication, une sorte de « buzz » et ensuite, cela a pris beaucoup de temps avant de se défaire de l’idée de la magie du dispositif. Aujourd’hui, son activité se fait parfois avec des collectivités territoriales, et en partie avec des centres sociaux et des acteurs associatifs.
Questions sur la précision des commandes, des demandes de participation, qui semblent toujours floues.
Il y a trois dimensions qui peuvent s’avérer floues : politique, éthique ou technique. Or, si on interroge beaucoup les dimensions politique et éthique, la question des compétences relationnelle comprise dans la dimension « technique » de la participation est souvent tue. On n’en parle pas, comme si c’était mineur. On peut facilement lire des recherches et un véritable travail critique autour des intentions politiques, des contradictions, des instrumentalisation mais rarement des travaux à propos des « agir professionnels » en jeu dans la participation, ce qui semble en faire une sorte d’angle mort.
Question sur la nature des activités et compétences en jeu dans la participation
La présentation souligne les difficultés des travailleurs sociaux et remet en question la magie des dispositifs. Et elle présente comme une évidence le fait que la participation soit du travail social. Or, si on peut comprendre que dans les détournements que l’on fait de la participation, on est dans le travail social, tout le travail de recherche, et notamment celui développé dans ces séminaires, classe totalement l’activité de participation dans le champ politique et non dans le champ social. Pourquoi la participation serait une forme du travail social ?
Dans la pratique, il y a quelque chose de commun aux acteurs du travail social et aux interlocuteurs de Matière Prise, en situation de mettre en œuvre. Un chargé de mission « démocratie locale » a quelque chose de l’ordre de l’animation et d’une capacité relationnelle commune à la plupart des travailleurs sociaux : il doit s’agréger un certain nombre de gens, se créer des formes de solidarités et de sympathies et toujours négocier. Et ces compétences se révèlent déterminantes, même s’il ne s’agit peut-être pas, à proprement parler, de travail social.
On peut invoquer kairos, le dieu grec de l’opportunité, qui est utilisé pour distinguer le geste juste, le bon moment. Il y aurait quelque chose de cet ordre-là, même si les termes ne sont peut-être pas exactement ceux-là : s’agit-il de compétence relationnelle ? D’habilité relationnelle ? De travail social ? S’il y a bien des commandes politiques flous et des dispositifs ayant des effets pervers, il y a aussi un autre sujet, à la fois une évidence et un continent pas très bien délimité, dont on saisit la difficulté à nommer lorsqu’il s’agit, par exemple, de faire internaliser cette compétence. « Devient-on compétent de la relation ? ».
Gaël FOUSSADIER – Retours d’expériences. Ville de Blois
L’émergence du métier de concertant public a mis beaucoup de temps à émerger et chacun était très isolé. Et il y a dorénavant des rencontres nationales des professionnels de la démocratie participative1.
Blois est une ville de 50 000 habitants, suffisamment grande pour conduire des projets importants et encore suffisamment petite pour qu’il subsiste des entre-soi. Gaël Foussadier est arrivé à Blois en 2002, responsable d’un service « vie des quartiers », service qui a évolué en 2008, au changement de municipalité, en « démocratie locale, instances participatives », pour encore évoluer très récemment en une direction de la « cohésion sociale ». Il y a donc également eu une évolution des missions.
Le propos sera organisé autour de trois nœuds, trois points de tension.
1. Le premier nœud : le positionnement au sein de l’institution et de la fonction publique territoriale.
La nécessité d’un portage politique fort est souvent soulignée, mais il est moins souvent rappelé qu’un portage administratif, par les services, s’avère également indispensable. En 2002, les conseils de quartier sont créés, avec une volonté politique affichée mais sans réelle vision stratégique. Et Gaël Foussadier est recruté pour mettre en place le dispositif, jeune cadre A face à de vieux ingénieurs incrédules quant à l’utilité de ces nouvelles pratiques en matière d’urbanisme et d’habitat. Depuis est arrivé une nouvelle génération d’élus et de cadres dans l’institution. Mais cela pose bien la question du pouvoir de l’administration, qui peut largement freiner les volontés des élus. De 2002 à 2005, il fait essentiellement de l’animation de dispositif. Désormais, il fait plus de la régulation des dispositifs, le service assurant dorénavant davantage la coordination des actions en matière de participation des autres services et agents, dans un contexte de multiplication de dispositifs participatifs, mais pas toujours à bon escient. Il y a donc une évolution des missions attribuées au service « démocratie participative », qui est de plus en plus dans un rôle de coordination et de moins en moins dans un rôle de mise en œuvre. Les thématiques concernées s’élargissent également : on est passé de questions d’aménagement et d’urbanisme à des champs beaucoup plus large, à la culture, à l’évaluation de la vidéosurveillance, et, consécration, le service a été réquisitionné par la Direction Générale des Services pour contribuer à mettre en place les méthodologies de projets d’administration (ce qui ne relève alors plus de la participation citoyenne mais indique que les méthodes utilisées commencent à essaimer, à être intégré).
Cette évolution a été lente, avec des obstacles à surmonter. Tout d’abord, le statut de cadre dans la fonction publique présente des freins par rapport aux statuts de chargé de mission « démocratie locale », qui est un métier qui n’existe pas (les formations sont balbutiantes et approximative, à l’exception de quelques-unes dispensées par le CNFPT). Négocier ce genre d’innovation au sein d’une collectivité, face à des ingénieurs des Ponts et Chaussés, se fait plus facilement en tant que cadre A que si on est cadre B ou C. D’après son expérience, le meilleur dispositif pour se former aura été les « 40 jours » offerts aux jeunes attachés pour visiter d’autres collectivités lors de la première année de cadre (ce dispositifs est maintenant supprimé).
L’institution municipale en elle-même est également un frein. Les fiches de poste n’existent pas, il faut les écrire. Les horaires sont inadaptés et la gestion administrative classique entraîne également une lourde inertie (pour le moindre projet, rédiger une fiche de projet, un rapport d’activité, un bilan, une fiche d’évaluation… Une heure d’animation entraînant une heure de compte-rendu).
La pratique adoptée a été une pratique d’essaimage pour desserrer ce nœud autour de l’administration, pour convaincre que ce n’était pas au service de la démocratie locale de tout porter et que ce service avait davantage un rôle d’accompagnement, de coordination, de diffusion. C’est ce qui explique ce paradoxe qu’en 5 ans, le service soit passé du discours « il faut concerter, il faut faire participer » à la posture consistant à freiner parfois certaines démarches contre-productives (trop précoce ou trop peu préparées, ou présentant un risque de saturation d’un territoire par des interventions…). Actuellement, environ un tiers du temps de travail du service correspond à cette activité, un autre tiers est de l’animation et le dernier correspond à de la gestion administrative classique.
Cette stratégie d’essaimage s’est appuyée sur une méthode propre à la ville, qui a permis de mobiliser une quinzaine de cadre hors du service et d’adopter un langage commun. Cela a consisté en une simplification de l’échelle d’Arnstein, autour de trois degrés de concertation compréhensibles par tous, essentiellement autour des questions de cahiers des charges :
– L’effet de la concertation va-t-il toucher le cahier des charges ?
– Si oui, est-ce que ça le modifier dans sa structure interne ?
– Et si oui, est-ce que peut remettre l’objectif ou même le périmètre et l’objectif du cahier des charges ?
Cette méthode a permis de débloquer rapidement beaucoup de situations et à partir de 2011, le problème de la participation des collègues ne se pose plus à la ville de Blois. Ce nœud semble donc actuellement a peu près dénoué, même s’il faut continuer à le travailler (via des formations en interne, notamment).
2. Le gros nœud : le positionnement entre le marteau et l’enclume, entre l’élu et l’habitant.
Il y a deux conditions de base à réunir :
la question du portage politique, surtout lié à la personnalité du maire et des adjoints (peut-être davantage qu’à la couleur politique) : primo, quelle est la capacité de ces élus à accepter le risque ? Et secundo, la question de la proximité : face à des élus parachutés ou en déperdition de proximité (en voie de notabilisation par exemple), ça ne fonctionne pas. A Blois, l’opportunité de situation a été d’avoir un maire très proche de ses administrés, ce qui induit une absence de sollicitation pour, par exemple, être mis en scène dans les instances de participation, laissant ainsi une certaine liberté aux agents du service. Cela n’empêche pas la question de la confiance de l’élu vis-à-vis de son chargé de mission et de son équipe.
Au niveau des habitants, la question la plus délicate est celle de l’affectif (soit en positif, soit en négatif) qui entre en jeu à un moment donné et s’avère parfois délicate à gérer, nécessitant une prise de distance. A ce titre, le travail avec Jérôme Guillet sur les compétences et appétences, autant de la part des citoyens-habitants que de la part des équipes intervenantes, a été intéressant, en ce sens qu’il a permis de prendre le temps, de se dire qu’il faut moduler les offres et diversifier, qu’aucun public n’est homogène et qu’il n’y a pas d’habitant-type. Cela demande des compétences que l’on n’a pas forcément et qui relève souvent de l’éducation populaire, ce qui a conduit, au début, à externaliser. Mais le risque de l’externalisation, à terme, est de se déposséder soi-même de la mission première attribuée, de la part la plus noble du travail et de n’assurer alors que les tâches logistiques et de suivi administratif. Cette question de l’externalisation est fréquente, parfois même à la demande des élus (pour plus de sérieux, etc.).
Ce nœud peut parfois se resserrer, souvent pour les mêmes raisons, celle de la question du temps :
Du côté des élus, faire entendre qu’il faut anticiper les demandes de concertation reste un défi impossible. Les demandes sont fréquemment urgentes et souvent impossibles, justifiées par des fenêtres d’opportunité très réduites (pour lancer un projet).
A l’inverse, les habitants n’arrivent pas à comprendre ces questions de temps : ainsi, après un travail avec un groupe d’habitants sur des questions d’urbanisme très générales (ouverture du centre-ville sur la Loire), doublé d’un questionnaire avec une large diffusion, il y a une incompréhension quant aux délais d’intégration de ces réflexions (dans les travaux des urbanistes et des architectes pour concevoir les grands projets de la ville, puis de la mise en chantier par tranche, il y a un délai minimum de 5 à 7 années). Les temporalités des projets urbains demeurent toujours très difficiles à expliquer.
Ce nœud peut également se resserrer autour de la question de la capacité réelle de prise de décision par les élus, qui est une question réelle et centrale dans la vie municipale. Avant même de parler de participation, quel part du processus de décision est maîtrisé par les élus locaux. Cette question renvoie d’une part au pouvoir de l’administration, mentionné plus haut : à Blois, il y a cinq personnes (3,5 ETP) au service « démocratie locale » avec une certaine autonomie, bénéficiant parfois d’une marge de manœuvre pour proposer des stratégies qui peut s’avérer déconcertante. Cet exercice, qui peut être grisant au début, a ses limites et interroge sur la nature de l’action : s’agit-il de mettre en place ses propres idées ou celles de l’équipe municipale ?
D’autre part, dans la question de la prise de décision, il y a toujours la question de la marge réelle de négociation. Ce couple négociable / non négociable est au cœur de l’ingénierie de concertation : bien souvent, la difficulté est d’identifier le négociable, et on s’aperçoit que cette part est floue, évolutive. Et parfois, les élus se rendent bien compte qu’ils ont très peu de marges de manœuvre négociable, ce qui renvoie également aux questions d’intercommunalité, et de la liberté d’une commune dans une communauté urbaine2.
Pour l’agent, le métier a beaucoup évolué par rapport à ce nœud : de nouvelles missions s’ajoutent, et dans le meilleur des cas, il va s’agir d’accompagner les élus (on quitte l’aide à la décision pour aller vers de la stratégie), et dans des conditions moins favorables, il s’agira de développer des compétences en termes de communication, voire de faire avaler des couleuvres aux gens.
3. Le 3ème nœud : le rapport professionnel avec le monde militant et avec notre militance
Pour les militants de la démocratie locale purs et durs, un agent de la fonction publique territorial apparaît toujours suspect. Et vis-à-vis des prestataires, ce même agent est toujours incompétent, surtout s’il ne fait pas appel à leurs « savoir-faire » ! Ce positionnement a amené des collègues à demander aux organisateurs des Rencontres Nationales des Professionnels de la Démocratie Participative de ne pas faire intervenir, comme lors de la 1ère édition en 2011 à Créteil, un certain nombre d’universitaires et de prestataires, « qui venaient un peu nous expliquer notre boulot alors que nous étions dans une logique de créer, au sein de la fonction publique territoriale, une réflexion sur nos métiers ».
Un périmètre professionnel évolutif et élargi
Pour résumer, les tâches d’animateurs et de chargés de mission sont variées et se concurrencent : animation, définition, surcharge administrative, encadrement dans certains cas, accompagnement, formation des autres agents, aide à la décision… « Et à tout faire, on est forcément suspect de ne pas savoir bien faire quelque chose. » Le nombre d’agents présents dans ce service (cinq agents avec des profils et des compétences complémentaires) est assez exceptionnel pour la taille de la ville.
Sur le recours à des consultants, au fil des années, l’impression émerge que certains tirent des rentes de méthodes et d’acquis, sans ne plus réellement développer de pratiques innovantes. Deux illustrations de cette tendance sont avancées :
le fait que certaines structures s’approprient des méthodes développées dans d’autres domaines (comme le théâtre de rue par exemple)3 et en revendiquent l’exclusivité.
Le fait de livrer des prestations léchées et très normées, respectant une certaine orthodoxie en la matière, mais dont les résultats sont lisses et absolument inutilisables par la suite (sur la base de l’expérience de forums ouverts, réalisés soit en interne, soit externalisé).
Au final, les demandes d’interventions extérieures se font de moins en moins dans la logique de faire un « bon coup », et c’est davantage une sorte de compagnonnage qui s’instaure, avec un nombre très restreint d’intervenants, qui connaissent bien les services mais aussi et surtout le territoire.
Tout cela amène les fonctionnaires territoriaux à s’interroger sur leur propre militance. Malgré le flou, il y a des intérêts réels des postes, et l’engagement s’avère profond. « Si on reste là 10 ou 12 ans, c’est que l’on commence à être convaincu. (…) Donc, on devient militant, mais jusqu’à quel point ? A être trop militant dans une collectivité locale, on peut en être amené à manger son chapeau… »
Discussion avec la salle
Si la discussion suite à la première intervention portait sur le glissement de la participation vers le travail social, celle-ci montre bien à quel point, inversement, les agents en charge de la participation font de la politique.
Une question sur le rapport entre proximité et démocratie
L’idée est répandue que la proximité serait un vecteur ou un générateur naturel de la participation (cf. la loi de « démocratie de proximité » de 2002). Pour autant, les difficultés rencontrées par la participation ne sont-elles pas, au contraire, révélatrices d’un déficit de la proximité caractérisant la vie politique locale et finalement d’un certain décloisonnement entre les élus et leurs administrés ? Ce qui amène deux questions : on dit souvent que la participation est une fin et que la proximité serait un moyen de réaliser cette fin. Mais est-ce qu’aujourd’hui, les rôles ne seraient pas inversés, de sorte que certaines municipalités auraient tendance à essayer de promouvoir des politiques participatives pour établir une certaine proximité avec leurs administrés ? Et finalement, est-ce que le rôle premier des professionnels de la participation ne serait-il pas d’une part de révéler ou de susciter des vocations participatives ou citoyennes (cf. l’expérience de l’habitante de la ville de Vendôme) et plus encore, de rétablir le lien qui tend à se distendre entre les élus et une certaine partie des habitants de la collectivité ?
L’expérience au sein de la ville de Blois indiquerait plutôt un mouvement inverse : la loi de 2002 aurait été vu comme une occasion, à travers le prétexte de la démocratie locale, de réduire la distance entre les élus et les citoyens. D’autant plus qu’à Blois, un jeune maire de 35 ans succédait à Jack Lang à la mairie et a fait le choix de s’inscrire en contre-pied et de miser sur la proximité, notamment avec les conseils de quartiers. Il a alors été essentiellement question de réhabituer, réapprivoiser le citoyen vis-à-vis de l’institution municipale, de retisser des liens à chaque occasion. La situation actuelle montre une évolution avec de moins en moins d’enjeux autour de la personnalité des élus et une volonté de faire autrement, en se dotant de tous les outils favorisant la participation, qu’elle soit descendante ou ascendante. Alors, certes la proximité est toujours avancée, mais la proximité de l’institution, pas la proximité des politiques. La création d’une direction de « la cohésion sociale » acte de ces changements : en conjuguant les questions participatives avec les enjeux de gestion des centres sociaux, la recherche de complémentarités entre équipements publics, etc. notamment en lien avec les questions de comités d’usagers. « Comment on met de la démocratie dans une crèche, dans un centre social ? » Sur la base de cette expérience, il y aurait donc au contraire une montée en niveau de la question.
Sur cette question du lien, du rapprochement avec les institutions et le monde des élus, le seules expériences intéressantes se déroulent lorsqu’il y a une certaine prise de risque et qu’on accepte d’une certaine manière « d’ouvrir l’arrière boutique ». Ce fut le cas par exemple lorsqu’une réunion d’information fut organisée avec la police municipale pour expliquer de façon très simple l’activité concrète de ce service (équipe, horaires etc.) et que les habitants se montrèrent très intéressés. Il y a une petite prise de risque avec une autre manière de raconter ce qui se passe. Il en est de même lorsqu’un élu participe à des groupes mixtes et faire l’effort de raconter autrement ce qu’est la décision, ce qu’il ne comprend pas et ce qu’il ne peut pas faire.
Question sur la participation comme outil social ou activité politique
L’objectif de la participation est-il politique ou au contraire ne vise-t-il que la paix sociale ? Et si cet objectif se réduit à la recherche de la paix sociale, du consensus, de la tranquillité et du bien-vivre, est-ce que ce n’est pas un choix politique d’une part ? Et est-ce que c’est transpartisan d’autre part ? Est-ce que l’on peut faire quelque chose qui relève de la participation et qui ce soit hors parti ou trans-parti sans que ce soit quelque chose d’inscrit politiquement ?
Pour beaucoup d’exécutifs, municipaux ou autres, l’objectif premier, bien entendu, est qu’il n’y ait pas de vague. Mais les choses ne sont peut-être pas si simples que cela, tout d’abord pour les fonctionnaires qui, certes, obéissent à une commande politique et élaborent une offre de participation mais qui sont aussi à côté de cela des citoyens, des professionnels militants ; et également pour les élus locaux, dont le pouvoir reste relatif (et parfois, un directeur de cabinet, voire même un chef de service, a plus de poids sur la décision qu’un élu).
Pour le fonctionnaire, d’un point de vue militant, le véritable intérêt de proposer une offre de participation (c’est-à-dire d’intégrer des citoyens dans les dispositifs), c’est bien de leur ouvrir l’arrière-cuisine pour leur permettre d’avoir un regard plus éclairé, une critique plus constructive sur ce qui se passe. En participant au processus, est offert au citoyen la capacité de devenir garant citoyen sur d’autres processus ou d’autres débats publics.
Sur cette question « d’être à l’ombre », il y a pour les chargés de missions des logiques paradoxales entre créer du consensus ou faire ressortir les points saillants, de tension. De ce point de vue, la commande politique est toujours moins intéressante que ce qu’on va potentiellement pouvoir faire. Se crée une communauté avec des habitants, des chargés de missions d’autres services, des intervenants et c’est ensuite au fonctionnaire d’essayer de restituer ce qui a pu se créer, s’inventer au sein de cette « famille ».
Un témoignage complémentaire d’un autre fonctionnaire territorial
En poste depuis 2011 à la mairie de Tours, au départ pour mettre en place les conseils de la vie locale (conseils de quartiers de la ville de Tours), il témoigne au démarrage de ce dispositif d’un portage politique fort par le premier adjoint au maire : rattaché au service des relations publiques, au cabinet du maire, il travaille en prise directe avec le premier adjoint. Au fil des années, il ressent une certaine fatigue, lié à l’emploi, qui est avant tout de gérer des conflits, en étant parfois « mis été en première ligne par les élus ». Et contrairement à l’exemple blésois, il est seul à travailler sur ce sujet au sein de la ville de Tours (137 000 habitants), en portant et coordonnant l’ensemble des conseils de la vie locale, grâce notamment à un réseau relationnel au sein de la collectivité avec les directeurs de services et avec des référents techniques. Aujourd’hui, deux sortes de questionnement se posent selon lui : d’une part, comment introduire la participation dans les activités d’une communauté d’agglomération et comment articuler cette compétence avec les activités conduites au niveau communal ? Et d’autre part, comment gérer l’arrivée des nouveaux conseils citoyens (des conseils de quartiers sans la présence ni d’élus et ni des services), comment former les gens dans ces conseils et quelles relations instituer avec les conseils de quartiers ?
Question sur l’effet des changements de municipalités sur les pratiques des fonctionnaires territoriaux
Cet effet est évident et très important : une nouvelle municipalité, c’est l’occasion de négocier de nouvelles orientations. Ainsi à Blois, en 2008, en obtenant un droit à l’expérimentation (et donc à se tromper), l’intérêt pour le poste a été renouvelé. La personnalité du maire est déterminante dans l’offre de participation envisagée. « Mon vrai patron, c’est l’habitant, mais entre lui et moi, il y a le maire. »
A Tours, le portage politique initial été très fort, via un adjoint très impliqué. Le changement d’élu référent a conduit à tout autre chose. Et maintenant, avec le changement récent de municipalité, il a été décidé de continuer, mais avec la volonté de changer un certain nombre de chose, ce qui peut être une bonne chose. C’est une expérience à renouveler continuellement, sinon, la lassitude et l’épuisement peuvent surgir rapidement.
Christian CALENGE – Retours d’expériences. Commissaires enquêteurs
Le contexte d’expérience est tout à fait différent des précédents, les commissaires enquêteurs (CE) étant orphelins de tout portage politique, puisqu’ils ne dépendent théoriquement de personne et doivent préalablement à toute mission signer une déclaration de totale indépendance.
Tout d’abord, un rappel du contexte de l’enquête publique (EP) (créé par la loi Bouchardeau de 1982 et réformée en décembre 2011) : elle arrive en phase terminale des projets. Les CE ne sont pas désignés par une municipalité, des élus ou des acteurs institutionnels, mais par décision du tribunal administratif (dans 90 % des cas) ou par la préfecture (dans les 10 % de cas restants, pour les enquêtes de droit public). La difficulté est donc bien souvent d’expliquer au porteur de projet que « nous ne sommes pas l’Etat », ni pour représenter le ministère de la justice, bien que mandatés par le tribunal administratif. Cette position est compliquée à expliquer, aux jeunes CE parfois, aux élus très souvent et aussi auprès des populations pour qui le CE représente l’Etat ou le porteur du projet (alors que le CE prend le projet tel quel et en est totalement extérieur). Pour être CE, il faut en montrer l’envie et en avoir les compétences rédactionnelles (notamment en termes d’observance du droit). La liste des CE est établie par une commission et renouvelée tous les 4 ans.
L’EP est donc quelque chose d’un peu particulier. Deux choses sont demandées :
1. le CE doit vérifier que le projet est bien transmis, selon cette notion de « bonne information du public », qui est une notion très cadrée (et ce cadrage peut poser question en lui-même : n’est-ce pas un corset rigide qui fait obstacle à un certain nombre de choses ?).
2. le CE doit recueillir et prendre en compte la parole des gens (n’importe qui peut venir s’exprimer dans une enquête publique, même le porteur de projet). Le public doit pouvoir s’exprimer. La loi est à cet endroit assez ouverte, voire particulièrement permissive.
1. La bonne information du public, c’est vérifier que le projet est clair, que le rapport comprend toutes les pièces, que tout le monde peut le lire. Or, un PLU, un PDU, un SDAGE (sur 5 départements) ou un tracé TGV n’ont pas la même échelle, bien que les procédures soient les mêmes. Le CE doit donc expliquer le projet, ce qui pose la question de l’expertise : le CE doit-il être un expert ou juste un « honnête homme » (pour reprendre l’expression de la loi) ? La bonne information, c’est également de veiller à ce que la loi soit respectée, notamment les conditions précises d’information du public (affichage des avis d’enquêtes sur le territoire d’enquête, contenu explicite des avis d’enquêtes -date, lieu, objet, etc.). Le rapport ne doit pas être trop technique, pour être compréhensible par n’importe qui, mais il doit également être très argumenté, car il doit pouvoir servir de base argumentaire au tribunal administratif dans le cadre d’un jugement s’il y a contentieux.
Pour les enquêtes de droit (10 à 15 % des EP demandées pour des problèmes de cadastres, de voieries, etc.), la première tâche du CE est de vérifier que chacun des propriétaires a été prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception, et sinon, il doit se débrouiller pour entrer en contact avec le propriétaire (parfois à l’étranger etc.), ce qui est long. On ne peut pas commencer l’enquête AVANT d’avoir vérifié que TOUT le monde a été prévenu.
Il y a également une question de coût en ce qui concerne l’information du public, notamment pour les petites communes. Ainsi, par exemple, un CE propose une prolongation de 2 jours pour achever l’enquête dans les meilleures conditions, et le maire refuse pour des raisons économiques (180 euros de publication d’avis et 900 euros de publication dans la presse -somme exorbitante dont certains journaux locaux tire une espèce de rente, avec annuellement entre 80 et 150 EP en Indre-et-Loire). Les petites communes peuvent légitimement hésiter, entre la bonne information du public et leurs limites financières.
2. L’accueil du public et le recueil des avis : il faut accueillir le public, lui expliquer le projet s’il en fait la demande et prendre en compte absolument tout ce qui est dit et tout ce qui est écrit dans le registre (sur la dernière enquête publique sur un PLU, 17 contributions sur 4 permanences, dont seulement 6 écrites, dont le maire, les 11 autres étant des témoignages oraux recueilli par le CE). Le CE a également la possibilité d’organiser des réunions publiques (cela dépend également de l’échelle du projet). Le problème est bien souvent d’aller chercher le public, ainsi certains CE peuvent aller directement à la rencontre de gens identifiés comme particulièrement concernés par le projet. Le public est incroyablement varié et ne s’exprime pas vraiment sur l’objet de la concertation (le plus souvent, ce sont des problèmes personnels qui sont évoqués, et non un avis sur le projet en lui-même : la parcelle voisine sera-t-elle constructible ? Une route passera-t-elle là ? Ce carrefour est dangereux, etc.).
Et il y a parfois des situations paradoxales pour le CE : par exemple, sur une commune où le renouvellement du PLU est soumis à enquête, de l’avis du CE, un point intéressant dans cette commune est la procédure de déclassement, rare, d’un étang classé Espace Naturel Sensible par le Conseil Général. Mais ce point n’est pas abordé dans le PLU en révision, et aucun des déposants ne l’a mentionné, le CE ne peut donc pas se saisir de cet aspect et le mentionner.
Le CE doit recueillir l’avis du public, « la parole du public doit être utilisée pour dire s’il elle remet en cause l’utilité du projet ». Le CE doit émettre un avis strictement personnel, pour savoir s’il pense que le public a suffisamment d’arguments sérieux pour remettre en cause certains aspects du projet ou pas. C’est une tâche difficile, car le CE rencontre des gens énervés (parfois le maire refuse l’accès aux locaux de la mairie, parfois des associatifs prennent en otage un CE, etc.). Le public dispose d’une large palette d’interventions (dépôt de pétitions, envoi en ligne, etc.) et la déception des porteurs de projets est souvent forte quant à la faible participation du public (une commune ouvre un site internet et personne n’envoie de courriels…). L’ouverture au public est un aspect extrêmement important, et on peut s’interroger sur le fait de voir si peu de public.
Jean-Louis BERNARD
Il faut rappeler en préambule que tous les projets ne sont pas soumis à EP, soit par rapport à un certain seuil financier engagé par les projets et défini par la loi, soit par des Déclarations d’Utilité Publique. Pour ces projets non soumis à EP, il y a aussi de la concertation. Mais l’exploitation des résultats de cette concertation est nécessairement réalisée et guidée par le commanditaire du projet et la gestion des retours du public, même inconsciemment, est vue sous ce prisme-là.
Alors que dans le cadre de l’EP, le CE, dont le titre exact est « collaborateur occasionnel du service public », a pour référence le tribunal administratif, qui est le donneur d’ordre sur le plan institutionnel. Cette référence procure donc au CE une indépendance totale vis-à-vis du projet soumis à l’enquête. S’il respecte cette indépendance, il est garant de la véritable restitution du ressenti du public sur le projet. Mais le CE doit également donner un avis, donc s’engager, avec un prisme de « bon sens » sur le projet. De ce fait, la compagnie des CE est assez méfiante vis-à-vis de CE qui sont des experts sur certains dossiers, car alors, bien souvent, la critique du projet présenté à l’enquête ne va pas du tout dans le sens de la restitution de la participation du public (et ce sont souvent ce genre de rapports qui font contentieux auprès du tribunal administratif).
Trois grandes catégories de public reçu lors des EP peuvent être identifiées :
– Le public institutionnel, les personnes publiques associées au projet,
– Le public de type associatif, qui se regroupe en association sur des projets de types politiques ou environnementaux,
– Et puis l’individuel, le propriétaire terrien, le riverain, l’exploitant agricole, etc.
Au niveau de l’information de ces types de public, l’échelle est complètement différente :
Le public institutionnel (chambre d’agriculture, DREAL…), il intervient bien souvent dans la réalisation du projet. C’est donc une participation à la fois partisane mais aussi qui contribue à l’intérêt général. Pour eux, l’information est totale, puisqu’ils participent à l’élaboration du projet.
Le public associatif (France Nature Environnement, la SEPANT…), ce sont des associations extrêmement informées, qui possèdent parfois même plus d’informations sur un projet que le CE. Donc, là aussi, l’information n’est pas un souci.
Là où le CE rencontre un problème d’information, c’est avec le public individuel. 80 % des gens qui viennent à l’EP viennent pour se faire expliquer le dossier, dont ils n’ont pas pris connaissance auparavant. Là, le rôle du CE est d’expliquer le dossier. Et le porteur du projet doit faire un travail pour informer les gens, travail sur lequel le CE doit porter un avis. Bien souvent, le porteur de projet dit : « On a fait tout ce qu’il faut : le site internet de la ville, les lettres mensuelles, les réunions publiques, c’est passé à la radio etc. » Et malgré cela, on s’aperçoit que si les gens ne sont pas directement concernés par l’enquête, ils ne sont pas intéressés et n’ont pas conscience de la portée d’un certain nombre d’enquêtes.
Il cite un exemple : en 1998, il y a eu une enquête sur l’agrandissement d’un dépôt de munition sur la commune de Cigogné (pour passer la capacité de stockage de ce dépôt de 9 à 50 tonnes). Personne ne dit rien lors de cette EP. Après les incidents de Toulouse et l’usine AZF, il y a eu toute une politique de mise en place des Plans de Préventions des Risques Technologiques. Ce fameux dépôt de munitions, dont personne n’avait remis en cause la multiplication du tonnage, a fait l’objet d’un PPRT et là, tous les gens concernés par les implications du PPRI (se trouvant dans la surface du périmètre d’inconstructibilité et devant mettre en place des mesures de renforcement des habitations) se sont sentis concernés. Mais il était trop tard. C’est la même chose lors d’EP portant sur la loi sur l’eau ou sur des inondations. C’est très classique, les gens ne viennent pas et pourtant ils sont informés. Des efforts louables sont faits par les porteurs du projet en termes d’information, et souvent, on peut se dire : « qu’est-ce qu’on peut faire de plus ? ». Mais on se trouve confronté à un problème : le public, l’individu, s’il n’est pas directement concerné par un projet, il est difficilement mobilisable sur ce projet.
Au niveau de l’avis rendu, le CE doit s’exprimer et rendre un avis personnel, donc s’engager. Lors d’EP où personne n’est venu, le CE doit tout de même donner un avis, parfois avec des acrobaties en termes d’écriture. L’avis du CE n’est que consultatif, mais si le préfet ou le commanditaire passe outre l’avis du CE, il doit motiver ce non-respect. Et en cas de réserve forte émise par un CE, si la réserve n’est pas levée, l’avis est défavorable. Les CE doivent donc être assez prudents avant d’émettre des réserves sur un projet, car il faut que cet réserve soit levable.
Depuis la réforme de 2011, 90 % des contentieux sont sur la motivation de la conclusion du CE. Un certain nombre de cabinets d’avocats se sont spécialisés dans le contentieux d’EP, et l’avis motivé du CE est de plus en plus passé à la loupe. Le TA ou le commanditaire ont d’ailleurs la possibilité de demander au CE de modifier sa conclusion, si on estime que l’avis n’est pas suffisamment motivé. Ce qui peut parfois poser quelques soucis, notamment lorsque le rapport est rendu public, et qu’il est alors délicat de modifier des éléments de conclusion.
Discussion avec la salle
Question sur les profils des commissaires enquêteurs
A quelques de très rares exceptions, ce sont des personnes à la retraite. Et ceci pour deux raisons : l’une sociologique, le CE est quelqu’un qui n’a pas tout à fait envie d’arrêter, l’autre est pratique, un CE doit savoir taper un rapport, avoir un téléphone, une voiture, et surtout être disponible. Une EP, c’est long (de 15 jours à plus d’un mois). Le CE doit s’emparer du dossier, faire la publicité au moins 15 jours avant, aller voir le porteur du projet avant, faire l’EP proprement dite puis envoyer un rapport succinct au porteur du projet et enfin, rédiger son rapport dans le mois suivant l’enquête. Il y a parfois des CE encore actifs (il n’y en a pas au niveau de l’Indre-et-Loire), mais ce sont alors des professions qui ont été jugées compatibles par le TA avec l’indépendance exigée du CE.
A peu près 80 % des CE viennent de la fonction publique (territoriale, municipale, armé, éducation nationale) et il y a également des chefs d’entreprises, des médecins, etc. Ce sont souvent des profils avec des responsabilités de cadre. Et il y a très peu de femmes (4 femmes sur 53 CE en Indre-et-Loire, et 12 sur 140 au niveau régional).
Question sur la professionnalisation du CE
L’EP apparaît comme le niveau zéro de la participation, avec une procédure extrêmement normaliste, qui démotive et décourage le public, car elle apparaît trop en aval dans le processus décisionnel, à un moment où tout est joué. Et il est bienheureux que l’avis du CE soit personnel et motivé et ne soit pas que la seule synthèse des avis formulés par le public, car sinon le danger serait alors de produire des avis dénaturés, quand bien souvent seuls les opposants au projet se déplacent pour déposer. A propos de l’avis défavorable qui peut être délivré par le CE, celui-ci peut-il conduire des porteurs de projet à revenir sur des caractéristiques fondamentales du projet ?
Et sur la question de la réforme du statut du CE, de nombreux juristes plaidaient dans les années 1990 pour une véritable professionnalisation du CE, avec notamment la création d’un corps des CE, avec recrutement par voie de concours comme dans la fonction publique classique. Une telle réforme pourrait-elle être une bonne chose ?
Par rapport à l’argument de l’inutilité de l’EP, notamment par le caractère très aval de l’EP, la réponse est simple : quand doit-on arrêter le projet ? Il faut nécessairement l’arrêter avant de le mettre en consultation, et si on l’arrête alors qu’il n’est pas définitif, on dirait que l’EP arrive trop tôt. Le projet demeure néanmoins perfectible, et l’EP pourrait y contribuer, via la bonne prise en compte de l’avis délivré. Mais cela du ressort de la préfecture ou du porteur de projet et dépasse le rôle du CE, dont le rôle est de transmettre les observations. En cas d’avis défavorable, le CE espère que celui-ci va interpeller le décideur. Mais le dernier recours, c’est le préfet. S’il signe avec un avis défavorable, il aura une procédure de contentieux au tribunal administratif, et si l’avis du CE est débouté, il n’aura pas de problème, et si ce n’est pas le cas, la décision préfectorale sera annulée (ce qui arrive souvent), car l’avis du CE n’a pas été pris en compte.
Sur la question du statut du CE, faire du CE un expert, comme un expert géomètre ou un expert judiciaire reviendrait à imposer des personnes qui soient d’une compétence irréprochable dans le domaine de l’enquête propre. Or un CE peut passer d’une aliénation de chemin communal à une enquête sur la loi sur l’eau, à une enquête sur des dépôts de munition, sur des éoliennes, sur des déclarations d’intérêt général sur une rivière, sur des installations photovoltaïques, des enquêtes de carrières… Ce n’est donc pas possible d’être compétent dans toutes ces matières. Le CE est inscrit sur une liste d’aptitude départemental et le tribunal administratif a ainsi un panel de choix, non sur la connaissance d’un dossier par personne, mais sur sa capacité d’analyse, de synthèse, de jugement, sur son intelligence.
Le CE est confronté à une complexité croissante des dossiers soumis, notamment en matière d’environnement ou de respect de normes environnementales. Et dans ces cas-là, les avis des Personnes Publiques Associées peuvent être extrêmement divergents, parfois même opposés les uns aux autres (les PPA n’étant pas que des collectivités ou des administrations, mais aussi des privés comme le CRPF ou la chambre d’agriculture…). La complexité croissante des dossiers pourrait pousser à une spécialisation des enquêteurs, et la réponse du tribunal administratif, lorsqu’il établit la liste des CE, est de recruter des CE qui ne soient pas multi-compétences mais qui aient malgré tout des domaines de compétences.
Question sur la rémunération des CE et la possibilité d’en vivre en tant qu’activité rémunératrice
Le CE est indemnisé en vacations selon le temps passé et les frais engagés. De façon à garantir son indépendance, les porteurs de projet versent les indemnisations à la Caisse des Dépôts, qui les reverse aux CE, via un fond spécifique. Concrètement, les rémunérations dépendent de l’ampleur des projets soumis à enquête. Une enquête de PLU s’étire sur trois mois et demi (prise de connaissance du dossier, prise de contact avec le porteur, EP -3 fois 3h- sur une période de 30 jours minimum, et rédaction de l’avis). Le CE doit donc être disponible sur cette période et il est indemnisé entre 1200 et 1500 euros pour une EP de ce type. Pour une enquête plus conséquente, sur un plus grand périmètre, nécessitant plus de réunions et de permanences, la période de disponibilité est la même mais le temps de travail est plus important. L’indemnisation du CE pour ce type d’EP varie alors entre 2 500 et 3 000 euros. Ces indemnités, en tant que « collaborateurs occasionnels du service publics », sont soumises à impôt. Il apparaît donc difficile d’en vivre, car le CE est saisi seulement s’il y a un projet. S’il n’y a pas de projets, le CE n’est pas saisi…
Question sur la proximité entre les fonctions du CE et celle de « tiers garant » dans les démarches de concertation ?
On observe actuellement dans le champ professionnel de la participation l’émergence de la figure du garant (qui assure la neutralité et le respect des bonnes règles de la concertation). En termes de positionnement et de fonction, cette figure est comparable au profil des CE.
Les démarches actuelles de simplification des procédures publiques pourraient déboucher sur des formes de participation du public par des voies différentes de l’EP. Il y a plusieurs années, la compagnie nationale des CE s’est demandée si le CE pouvait être désigné comme garant sur un certain nombre de projet, en dehors des EP. Après réflexions, la compagnie ne s’est pas prononcée, et si le domaine d’action du CE venait à se réduire, il est envisageable qu’il puisse assurer des fonctions de garant dans les grands projets (mais ça ne serait pas un professionnel !).
Question sur l’absence de public et son interprétation
L’absence de participants n’est pas propre à l’EP et se retrouve partout ailleurs dans le domaine de la participation (conseils de quartiers, etc.). C’est une question récurrente. Alors que moult efforts sont déployés, « les gens ne veulent pas participer ! », comme si personne n’était concerné. Et du côté des potentiels participants, le ressenti est unanime : « ça ne sert à rien » de m’investir (pour plein de raisons, maîtrise de la langue, technicité, projet déjà décidé, etc.) Il y a donc une construction politico-institutionnelle de l’inutilité de la participation qui vient légitimer la positon des décideurs, qui eux font tout bien en termes de procédures (publicise, informe, accueille…) et ce sont les gens qui, pour des raisons diverses, ne veulent pas participer.
Pourquoi les gens ne voudraient pas participer ? Or, dés qu’on commence à déconstruire les pratiques, on voit plein de raisons objectives qui font qu’il n’y a pas de participation. Ces raisons peuvent être très schématiquement résumées par l’absence de partage de la décision. Si pour une raison ou pour une autre, différente selon les contextes, tout est décidé ailleurs, il n’y a pas de participation. On revient alors la question : qu’est-ce que la participation ? La recherche d’un consensus (logique d’amont) ou encore la recherche de recenser toutes les plaintes possibles (plutôt la logique de l’EP). La participation consisterait alors à regarder tout ce qui peut dépasser de la ligne de consensus et essayer de ramener tout au moins de conflit possible. Si la participation, c’est ça, et la logique des dispositifs va dans le sens de faire penser que c’est ça, on est très loin du discours porté actuellement sur le devant de la scène qui est : « il y a un rapport entre la participation et la démocratie participative, et ce rapport, c’est une remise en question de la démocratie représentative ». Et la pratique de la participation que l’on observe à travers la professionnalisation semble être une pratique essentielle de lissage.
Alice MAZEAUD – La professionnalisation de la participation : une standardisation des pratiques ?
Le compte-rendu qui suit est issu d’une recherche en cours, c’est un document de travail diffusé pour information mais qui ne doit pas faire l’objet de citations.
L’exposé propose une focale très large sur ce qu’est la professionnalisation de la participation aujourd’hui. L’objectif du travail présenté est de cartographier et d’analyser la nébuleuse participative. Le point de départ est une volonté de changer d’angle d’analyse par rapport aux analyses classiques sur la participation. En général, la participation est travaillée à partir des dispositifs et des pratiques de la participation. Or, le choix ici est de s’intéresser aux professionnels de la participation, c’est-à-dire à tous ceux qui font vivre ces dispositifs et qui vivent de cette activité liée à la participation. Volontairement, il n’y a pas de définition arrêtée a priori de ce qu’est la participation et de qui sont les professionnels de la participation. Cette posture doit permettre d’observer tous ceux qui peuvent être repérés comme étant des professionnels de la participation :
Soit en objectivant qui sont ces professionnels : dès lors qu’un acteur développe une pratique professionnelle qui prétend à faire de la participation, peu importe sur quelle thématique ou avec quel public, on considère qu’il fait de la participation. Cette posture permet de se tenir à l’écart des luttes de définition.
Soit car les acteurs se revendiquent eux-mêmes comme étant des professionnels de la participation.
En prenant cet ensemble d’acteurs, on a bien une nébuleuse participative, avec des acteurs associatifs, des acteurs académiques, des acteurs privés (agences de conseils etc.), des acteurs publics (fonctionnaires d’Etat…). Il y a bien des acteurs avec des statuts très variés, intervenant dans des secteurs d’activités très variés (développement durable, habitat, éducation populaire, etc.).
Analyser l’institutionnalisation de la norme participative à travers les dynamiques de professionnalisation
Pourquoi déplacer la focale des dispositifs aux acteurs de la participation ? L’objectif est d’analyser l’institutionnalisation de la norme participative, à travers le prisme des dynamiques de professionnalisation, pour comprendre comment, depuis une trentaine d’années, une norme participative, un impératif participatif s’est déployé, dans l’action publique essentiellement, au point de devenir une sorte de passage obligé. Il s’agit de comprendre les modalités de cette diffusion, de cette consolidation, de cette mise en pratique de la norme participative, et ce à partir de l’analyse des dynamiques de professionnalisation.
Cette approche permet d’avoir une vue d’ensemble sur la participation, différente de celle centrées sur les dispositifs qui, inévitablement, conduisent soit à des approches sectorielles (dans le domaine de la politique de la ville, de l’aménagement urbain, etc.) soit à des approches territoriales (dispositifs mis en œuvre par tels types de collectivités, etc.), et donc à des analyses très fragmentées. L’intérêt de la démarche présentée ici est d’avoir une vue d’ensemble de cette institutionnalisation de la norme participative. Et pour avoir cette vue d’ensemble, il est proposé d’avoir à la fois une analyse diachronique et synchronique :
Une analyse diachronique en essayant de penser les dynamiques d’institutionnalisation sur le temps long, en montrant des histoires parallèles de la participation (celle liée à la démocratie locale, celle liée aux conflits environnementaux, celle plus ancrée dans les luttes urbaines et l’aménagement urbain, etc.). Ce qui fait la norme participative aujourd’hui, c’est que ces histoires de la participation ont fini par converger et s’homogénéiser depuis le milieu des années 1990. Pour étudier la construction et la diffusion de la norme participative, il faut également prêter attention au facteur juridique (injonction législative et réglementaire) mais aussi aux facteurs politiques et sociaux, et aussi très largement aux facteurs académiques et professionnels. Ce point ne sera pas développé aujourd’hui, mais il permet de mettre à jour comment cette institutionnalisation va de pair avec la professionnalisation de la participation : depuis les années 1970, on est bien passé des militants aux professionnels. Et c’est bien la professionnalisation réussie des militants qui permet aujourd’hui la professionnalisation et l’institutionnalisation de la participation. « C’est parce que les militants d’hier ont réussi à se professionnaliser, c’est-à-dire ont réussi à développer des savoir-faire spécifiques, à les faire reconnaître, à en faire un métier, qu’aujourd’hui on a professionnalisation et institutionnalisation de la participation. » Le temps long permet ainsi de ne pas considérer des univers militants qui s’opposeraient à des univers professionnels, mais bien au contraire des formes d’hybridation très fortes, liées à ces dynamiques d’institutionnalisation.
Une analyse synchronique pour rendre compte des fragmentations de l’univers participatif. L’idée de « norme participative » pourrait suggérer une norme homogène, s’imposant dans tous les espaces d’activités de la même manière et selon les mêmes modalités. Or, en réalité, l’analyse par la professionnalisation permet d’observer un univers participatif extrêmement fragmenté du point de vue des acteurs, des pratiques, des secteurs d’activités, etc. Et cette fragmentation ne s’observe pas selon une dichotomie publique/privée comme on a l’habitude de la mettre en scène. Il n’y a pas d’un côté l’offre publique de participation et les agents publics de la participation et de l’autre, des professionnels prestataires. On a au contraire des porosités très fortes entre ces univers-là, des pratiques qui circulent, des acteurs qui circulent, ce qui, au final, invite à repenser ce qu’est l’action publique. Enfin, il est intéressant de comprendre comment l’offre de participation est co-construite par des professionnels prestataires et des agents publics.
Cartographier la nébuleuse participative : un défi méthodologique
Quelle méthodologie mobiliser pour cartographier cet univers nébuleux ? Cette recherche est menée à deux depuis trois ans, et elle fait suite à deux thèses en science politique :
Celle de Magali Nonjon sur l’émergence des professionnels de la démocratie locale (soutenue en 2006), qui a travaillé l’histoire des années 1970 aux années 2000.
Et celle d’Alice Mazeaud, sur le conseil régional de Poitou-Charentes et les usages de la démocratie participative par Ségolène Royal dans le contexte de l’alternance de 2004.
Le croisement de ces deux regards, à partir de deux angles différents, a apporté une sensibilité aux effets de focal et à la manière dont le regard que l’on porte sur la participation donne à voir une certaine réalité de la participation et tend à invisibiliser le reste.
Cette recherche sur la nébuleuse participative a été réalisée en multipliant les méthodes d’enquêtes et les matériaux :
Un travail d’analyse de trajectoires biographiques, sur la base de suivi d’acteurs. Qui sont les acteurs de la participation aujourd’hui ? Quelles sont leur formation ? Comment ont-ils circulé d’un espace à l’autre ?
Du matériel ethnographique, lié à l’observation d’espaces de socialisation et de professionnalisation (participation à certaines rencontres professionnels, séances de formations, etc.).
Un suivi des marchés publics. Aujourd’hui, la participation est un marché, au sens économique du terme, avec une commande publique de participation et une offre de la part des prestataires. D’un point vue méthodologique, malgré les règles de publicité, l’accès aux avis d’attribution est compliqué (et ne donne pas accès aux cahiers des charges) et cela invisibilise tous les marchés inférieurs au seuil de publicité, ainsi que les marchés par des maîtres d’ouvrage privés (comme RFF ou EDF…). Pour contourner ce biais, des discussions avec un prestataire reconnu et établi sur ce marché ont permis de récupérer tous les marchés repérés comme relevant de la participation (850 marchés publics archivés depuis 2008), et ainsi conduire une analyse des segments, des prix et des types de prestations demandées.
Dernier matériau, une analyse documentaire, sur la base de cahiers de références des prestataires, des offres d’emploi (Gazette des communes…), des guides méthodologiques (Qui écrit ? Qui les produit ? Quels types de pratiques sont labélisés ?).
La nébuleuse participative : un univers mouvant aux contours non définis
Pour rappel, le point de départ est de ne pas donner de définition à la participation, terme pour lequel des luttes définitionnelles existent. L’intérêt de cette recherche est alors de voir la diversité de pratiques et d’acteurs qui se positionnent derrière ce terme-là. Les caractéristiques de la nébuleuse participative qui ressortent de l’analyse :
un univers mouvant dans le temps (des acteurs différents qui se positionnent dans le temps),
un univers aux contours non définis (avec des définitions concurrentes de la participation, entre la concertation, la démocratie participative, l’empowerment et le pouvoir d’agir, situé dans l’univers environnemental, dans l’espace urbain, etc.).
Une collusion et une interpénétration des univers administratif, politique, académique, associatif et marchand, avec des circulations individuelles1. Il y a des circulations très fortes, avec de nombreux acteurs à la frontière des univers2. Il y a donc une hybridation, une porosité très forte entre ces univers.
Une indétermination de la norme participative et une diffusion des compétences participatives : l’institutionnalisation de la norme participative va de pair avec la diffusion de l’activité et des compétences participatives à des acteurs dont ce n’est pas le cœur de métiers, dans des segments assez éloignés de ce qu’était le cœur initial. Et donc, plus la norme participative s’institutionnalise, plus elle se diffuse, plus on est face à un univers nébuleux.
La nébuleuse participative du côté des acteurs privés : une diversité d’acteurs privés
Des profils et des structures hétérogènes
Qui sont les acteurs privés sur la participation ? Plusieurs centaines de cabinets, d’agences ou de structures revendiquant vivre, au moins pour partie, de la participation ont été repérées. On retrouve aussi bien des bureaux d’architecture, des agences de communication, des acteurs issus du design industriel, des gros cabinets de conseils en management, des structures de soutien aux projets territoriaux, des structures liées au développement durable. En termes de forme, on retrouve des structures sous forme associative, sous forme de SCOP, sous forme d’entreprise. Sur cet ensemble, on va de gros bureaux d’engineering qui assurent de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre sur des grands travaux et qui intègre une composante activité participative « concertation et acceptabilité sociale », de grosses agences de communication, et à côté, on retrouve également tout une diversité d’acteurs et de travailleurs indépendants qui n’interviennent que sur des marchés locaux. On est donc dans l’impossibilité de définir le profil type du prestataire privé en matière de participation aujourd’hui
Un marché segmenté
Ce marché de la participation est extrêmement segmenté (sur la base de l’analyse des 800 marchés, avec un codage de la thématique et du secteur sur lequel se déploie la commande de participation) : un quart du marché est lié à l’environnement et au développement durable, un autre petit quart est lié à l’aménagement et l’urbanisme, un autre quart correspond aux politiques de démocratie participative3. Derrière ces trois gros segments, on a des sous-segments spécifiques : marchés liés aux grands projets d’aménagement (très spécifique, lié à la Commission Nationale du Débat Public), marchés liés aux politique de la ville et au renouvellement urbain, marchés liés au projet de territoire et à la prospective. Si on rentre par les marchés, on voit bien une forme de diffusion, mais celle-ci est assez inégale, et le secteur social, qui est un des poids lourds des compétences locales, apparaît quasiment invisibilisé dans ces marchés-là (ce qui veut dire en partie qu’il n’y a pas de participation, et en partie que c’est aussi largement internalisé).
Une diversité de prestations et de pratiques
On a bien des marchés et des prestations qui correspondent à toute la chaîne de production de l’activité participative, très en amont de l’étude de contexte, de l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur du conseil stratégique, jusqu’en aval sur de l’évaluation, et entre les deux, des prestations logistiques, de la rédaction, de l’animation de réunion, du travail de synthèse… Il y a également une diversité de pratiques, chaque prestataire développant sa niche, son outil et essayant de le vendre, de le diffuser4.
Il y a donc des profils extrêmement hétérogènes du côté des acteurs privés. Des années 1970 aux années 1990, des acteurs associatifs militants se sont professionnalisés, en développant des savoir faire et en les faisant reconnaître. A partir des années 1990, d’autres profils arrivent (issus des secteurs de l’urbanisme et de l’architecture, qui ont trouvé là un moyen de se reconvertir et de se relégitimer à un moment où ils pouvaient être en difficulté). Et depuis les années 2000, il y a une entrée massive des agences de communication, des cabinets de design industriel, des agences de conseil en management, des grands bureaux d’engineering, donc finalement des acteurs très éloignés de cet univers politique initial. Et c’est bien le travail de professionnalisation de ces militants qui a permis l’arrivée de ces acteurs, qui aujourd’hui, n’ont rien à voir avec ce qu’était la participation à l’origine.
La nébuleuse participative, du côté des acteurs publics
Des mises en administration de la participation par sédimentation successive
Du côté des acteurs publics, depuis le début des années 2000, l’institutionnalisation de la participation se traduit par une mise en administration de la participation, ce qui d’un point de vue politique peut paraitre tout à fait antinomique avec les origines de la participation. Et en même temps, le signe le plus tangible de l’institutionnalisation de cette norme participative, c’est bien le développement de ces administrations de la participation. Cette mise en administration de la participation s’est opérée par sédimentation successive : les premiers professionnels de la participation en tant qu’agent public sont bien les professionnels de la politique de la ville qui ont, les premiers, développé au sein des administrations une offre de participation. Et ce n’est ensuite qu’au début des années 2000, qu’ont eu lieu des recrutements beaucoup plus massifs de professionnels de la participation dans les agences, notamment avec, au milieu des années 2000, le développement et la consolidation de véritables services dédiés à la participation. Mais, même avec l’existence de ces services dédiés, on continue à avoir une logique de sédimentation.
Ce graphique est issu d’un travail sur les offres d’emploi de la Gazette des Communes (250 offres traitées depuis 2001, contenant le terme participation, concertation, démocratie participative, démocratie locale). On voit une fluctuation dans le temps mais on voit également que la labellisation des postes varie (codification opérée à partir des directions de rattachement, des secteurs d’activité et du type de poste offert). On voit bien sur la 1ère période (2001-2006) qu’il y a énormément de recrutements qui s’opèrent sur la thématique des « quartiers » (époque des conseils de quartiers), sur la thématique de la « proximité », sur la thématique de la « démocratie locale ». Mais il y a également encore, en 2001, des recrutements au titre de la « politique de la ville », qui vont quasiment disparaître par la suite. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a plus d’acteurs de la politique de la ville et qu’il n’y a plus de participation dans la politique de la ville, mais cela indique que ce profil de recrutements qui était dominant avant les années 2000 va se réduire à la portion congrue. En parallèle, on voit apparaître à partir de 2005-2006 des recrutements très marqués par le développement durable et les Agendas 21, et notamment sur les années 2007-2009, qui constituent la grande période de labellisation et de reconnaissance des Agendas 21 par l’Etat. On voit également apparaître sur la même période (2007-2008) des recrutements explicitement marqués « démocratie participative », alors qu’ils n’apparaissaient pas sur les années précédentes. Il y a donc un jeu de labellisation (entre la « démocratie participative », le « développement durable », la « proximité » et les « quartiers », la « démocratie locale »). Et on voit également des recrutements de professionnels de la participation dans des services dédiés mais aussi à côté de ces services dédiées. Finalement, l’apparition de ces services ne met pas un terme au recrutement d’acteurs formés à la participation dans d’autres secteurs et dans d’autres administrations.
Quelle intégration organisationnelle ?
A propos des services dédiés à la participation, on constate qu’il n’y a pas un modèle type de service de « démocratie locale » ou « démocratie participative » dans les collectivités locales. Il y a en fait plusieurs modes d’intégration institutionnelle :
Le rattachement explicitement politique. Jusqu’en 2005, les premiers services ou agents « démocratie locale » étaient souvent rattachés au cabinet, ce qui n’est quasiment plus le cas aujourd’hui (sauf dans de petites communes et à Paris). Néanmoins, très souvent, les agents de la participation sont assimilés à un espèce de cabinet invisible, de cabinet élargi, du fait de leur proximité aux politiques –ils sont souvent perçus comme cela en interne.
Le positionnement transversal : il y a de plus en plus fréquemment (environ un tiers des collectivités observées) la mise en place d’un pôle « concertation / démocratie participative » comme mission transversale rattachée au DGS (comme le développement durable ou l’évaluation). Ce pôle se positionne en diffusion à l’égard des services. Ce positionnement en mission transversale reflète une double mission à la fois opérationnelle et didactique de ces services de la participation.
Le positionnement dans une administration sectorielle : le service « démocratie locale » est alors rattaché aux services « citoyenneté », « vie associative », « cohésion sociale » suivant les organigrammes. Le service « démocratie locale » prend sa place dans une administration sectorielle dont l’activité est liée à des fonctions d’animation du territoire. Dans cette situation, la « démocratie locale » se positionne come un secteur administratif spécifique, ce qui est bien différent du positionnement en transversalité rattaché au DGS.
Une administration liée à des formes de territorialisation (surtout dans des communes) : des administrations où la prise en charge de l’activité « démocratie locale / conseils de quartier » va s’articuler à une politique de territorialisation des services (création de pôle de services publics ancrés dans les quartiers, avec un transfert au niveau des quartiers de l’activité de démocratie locale).
En termes d’intégration organisationnelle, on a des formats extrêmement différents, avec des histoires spécifiques à chaque collectivité, où des proximités plus ou moins fortes peuvent s’être établies avec tel ou tel secteur d’action de la collectivité. Les agents de la participation ont donc des positions tellement différentes que leurs rapports aux politiques et à l’administration vont être extrêmement variables.
L’évolution du positionnement des services dédiés au sein de l’espace administratif
Une analyse chronologique indique trois grands temps :
Jusqu’au milieu des années 2000 : les administrations de la participation sont des administrations de combat, car il faut convaincre de la nécessité de la participation, il faut conquérir sa position vis-à-vis des autres administrations, et il y a un registre militant qui est central dans les discours et dans les actions. L’objectif est de créer l’espace de la participation dans des administrations qui ont tendance à y faire obstacle.
A partir du milieu des années 2000, avec le développement de services dédiés à la participation, il s’opère une forme de rationalisation de l’activité administrative. Ces services sont alors moins dans une posture de conviction que dans une posture d’acculturation, de formation en interne, avec des chartes de la participation, des guides méthodologiques internes les premières formations internes…. On change de registre, en étant moins sur le registre militant et plus sur le registre de l’expertise. On est dans la grande majorité des situations encore à cette étape.
Dans les collectivités les plus anciennement positionnées sur le sujet5, une dernière étape apparaît, celle du nouveau management des compétences participatives. La logique est complètement différente : c’est une optique de management des ressources humaines, qui vise à faire reconnaître des compétences participatives, à les intégrer dans les fiches de postes et les référentiels métiers, et à comptabiliser le temps consacré à la participation, non seulement pour les agents qui font de la participation leur activité principale mais aussi pour tous les agents qui, du fait de la diffusion de la culture participative, sont amenés à mettre en œuvre des politiques participatives et des dispositifs participatifs et qui, de fait, deviennent ou sont amenés à se professionnaliser. C’est notamment ce que l’on observe au sein de l’agglomération lyonnaise ou à Nantes, avec des politiques de ressources humaines consistant à repérer qui fait de la participation, combien de temps etc. On est bien dans une optique managériale, qui vise à faire en sorte que la compétence participative soit reconnue dans les référentiels. Du reste, si on regarde le référentiel du CNFPT sur la fonction publique territoriale, la compétence participative a fait son apparition dans la dernière édition en tant que compétence et pas en tant que métier. Le métier chargé de mission « concertation / démocratie locale » n’existe pas pour le CNFPT. En revanche, on a une compétence participative comme étant une compétence transversale.
Une institutionnalisation administrative fragile ?
Des administrations faiblement reconnues et sans monopole sur l’activité participative
Il y a un paradoxe : la mise en administration est le reflet de l’institutionnalisation de la norme participative mais aussi le reflet de sa fragilité. Ces administrations sont faiblement reconnues et sans monopole sur leurs activités. Ces services dédiés à la participation ont à la fois une fonction didactique (mise en œuvre, conception, évaluation des dispositifs) et opérationnelle (diffusion, formation à la culture participative). Et ils se retrouvent en permanence en contrainte dans cette activité :
Il faut sans cesse faire reconnaître leur expertise et la nécessité de la participation. Et pour asseoir leur compétence en interne, une des techniques mobilisées est bien l’innovation qui devient une routine de ces fonctionnaires participatifs, pour montrer en permanence que la participation apporte une plus-value.
Mais ces administrations n’ont jamais le monopole de cette activité. Même les services dédiés ne sont jamais en mesure de savoir tout ce qui est mis en œuvre sous le couvert de la participation au sein de leur collectivité. On a un service d’experts en participation qui n’est jamais en monopole de son activité au sein de l’administration, ce qui informe sur des modes d’institutionnalisation assez précaires.
Une dépendance élevée à la contrainte électorale
Ces administrations ont une dépendance élevée à la contrainte électorale, même si l’institutionnalisation et le recrutement de fonctionnaires génèrent des effets de cliquets (face à un service dédié à la participation, l’élu doit bien leur faire faire quelque chose). La contrainte électorale reste forte, puisqu’à chaque nouvelle élection, l’existence même du service est remise en question. Cela reste un signe de fragilité de cette institutionnalisation.
Des métiers flous à fort turnover : « mili-techni »
Ce sont des métiers flous et à fort turn-over. La figure du « mili-techni » est un peu la figure centrale de l’agent de la participation, telle qu’elle avait été élaborée par les acteurs eux-mêmes, lors des rencontres professionnelles du Val de Marne. Pourquoi « mili-techni » ? Car il s’agit de tenir en équilibre entre une posture militante (avec cette idée très largement partagée par les acteurs qu’on ne peut pas faire de la participation au sein d’une collectivité si on n’est pas militant) et technique, car sur ces aspects, il faut être en capacité d’animer la réunion, de s’occuper des aspects logistiques, de discuter avec le maire, de faire les compte-rendu et donc d’être en capacité de couvrir tous les espaces de la chaîne de production de la participation.
Autre point de fragilité de l’institutionnalisation administrative : l’internalisation de compétences ne se traduit pas par l’arrêt du recours à des compétences externes. Au contraire, l’internalisation de compétences se traduit par un déplacement des types de marché : plus on a de compétences en interne, moins on va être à la recherche du conseil stratégique, mais plutôt de l’innovation, et donc de la labellisation, ou alors de l’indépendance et de l’animation neutre. A l’inverse, si on a des faibles compétences internes, on ira plutôt chercher du conseil stratégique. Donc, l’internalisation de compétences participatives n’a pas du tout sapé le marché de la participation, bien au contraire, cela a très largement consolidé le marché de la prestation privée dans le secteur de la participation, notamment par l’alimentation de dynamiques concurrentielles.
La professionnalisation : une standardisation des pratiques ?
La construction et la reconnaissance d’un groupe professionnel
Entre acteurs privés et acteurs publics, il y a bien des circulations très fortes, c’est un univers très poreux. On observe ainsi des dynamiques de construction et de reconnaissance d’un groupe professionnelle, qui serait les professionnels de la participation :
avec la légitimation croisée d’une expertise académique et professionnelle. Aujourd’hui, personne ne conteste que faire de la participation suppose des procédures, des savoir faire, des savoir être, que finalement la participation est bien un métier, au sens d’un ensemble de compétences spécifiques. Ce n’est plus contesté alors que jusqu’au début des années 2000, parler des professionnels de la participation était une figure repoussoir, dont il fallait à tout prix se démarquer.
Par la catégorie professionnelle de la participation, qui n’est pas le simple reflet d’une évolution sociale. Les professionnels eux-mêmes ont participé à créer et démontrer l’existence d’un métier (par les rencontres professionnels, les guides méthodologiques, la mise en place de formation), et donc à légitimer cette figure professionnelle.
Mais s’il y a légitimation, reconnaissance de la figure du professionnel, il n’y a pas pour autant accord sur ce que seraient les limites et les frontières de cette profession. Il y a bien une professionnalisation, mais sans délimitation claire d’une profession (avec une activité de contrôle et de régulation de l’entrée sur cette profession). Au contraire, il y a plutôt des formes d’homogénéisation qui s’opèrent par le flou, avec l’indétermination de la norme participative (se reconnaissent dans la figure du professionnel de la participation des acteurs qui n’ont pas les mêmes pratiques, les mêmes revenus, les mêmes conceptions de la participation, etc.). C’est à partir du flou que se construit cette catégorie professionnelle.
Les dynamiques de standardisation
Pour autant, il y a bien, à travers la reconnaissance de ce groupe professionnel, des dynamiques de standardisation, d’homogénéisation. Les formations, les guides méthodologiques participent de la codification des bonnes pratiques. Et les échanges lors des rencontres professionnelles portent sur l’échange de bonnes pratiques, et produisent de la standardisation par la diffusion et la reproduction des bonnes recettes.
Cette standardisation s’opère aussi par la rationalisation de l’activité individuelle : c’est l’idée de mettre de l’ordre au sein de chaque structure, d’élaborer des guides pratiques, etc. Cette dynamique est commune à toutes les structures (cabinets, collectivités, …) par souci de cohérence, d’économie, d’efficacité et au final, cela produit une logique de standardisation beaucoup plus globale.
La professionnalisation : une standardisation en trompe l’œil
Mais cette standardisation est très largement en trompe l’œil. S’il y a bien des bonnes pratiques et des modalités communes, cet univers reste très segmenté et très hiérarchisé. Des dispositifs et des bonnes pratiques circulent, mais tout ne circule pas partout et de la même manière.
La fragmentation
Il y a un jeu concurrentiel, des dynamiques de compétitivité à la fois entre collectivités (il faut toujours être le 1er, il faut toujours être innovant, etc.) mais également entre prestataires privés, pour se démarquer, se positionner en proposant un dispositif spécifique (avec des effets de mode très forts). Ces marchés restent très segmentées (développement durable, urbanisme, politique de la ville, etc.) et très peu de professionnels peuvent intervenir sur ces différents segments (seulement une petite dizaine de professionnel repérés comme ayant cette capacité). Ces marchés sont également très segmentés du point de vue territorial. Il y a très peu de professionnels en capacité d’intervenir sur tout le territoire national, et il y a beaucoup de marchés locaux, avec des acteurs n’intervenant que sur leurs territoires de prédilection.
La hiérarchisation
Cet univers demeure très hiérarchisé, entre des petits marchés (à quelques milliers d’euros, de l’animation, des tableaux d’information sur un PLU) et des très gros marchés (par exemple, ceux du CNDP qui monte à plus d’un million d’euros). Ce ne sont pas les mêmes prestataires, les mêmes compétences, etc. Et entre ces deux bornes, il y a toute une gamme de marchés qui peuvent se déployer. Et la situation est bien différente entre un prestataire en capacité d’assurer pour 6 mois ou un an l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la conduite de concertation sur tout un débat public et un prestataire de taille plus réduite qui a besoin de multiplier les marchés pour assurer sa survie. Si on regarde les prestataires, très peu peuvent vivre à 100 % de la participation aujourd’hui (une petite dizaine). Pour la plupart, ils doivent se diversifier et faire également de la formation à la participation, du conseil en communication, de l’étude urbaine, en bref rester également sur leur cœur de métier d’origine. Il y a donc une hiérarchisation entre ceux qui peuvent vivre de la participation et ceux qui sont encore en permanence contraint à faire autre chose pour assurer leur survie.
Même s’il y a valorisation d’un métier, celui par exemple d’agent public de la participation, on a en fait un univers avec une hiérarchie très forte, par exemple entre un acteur en capacité de produire du design, de l’innovation et donc de participer à structurer ce que c’est que de le participation aujourd’hui, et un agent de catégorie C en situation d’animation d’un conseil de quartier. Les rapports à l’expertise sont tout à fait différents.
N’est-ce pas une profession mort-née ?
La participation : métier ou compétence ?
Si on prend la question de la participation en tant que compétence interne, c’est aujourd’hui un métier (avec des agents et des services dédiés), mais il y a aussi une logique de diffusion, de contamination, d’acculturation de ces compétences participatives au sein de l’administration. Il y a donc aujourd’hui clairement une double activité : entre des acteurs qui font cela à 100 % et d’autres agents qui font autre chose, et mobilise de la compétence participative au service d’un autre métier. En termes d’évolution, on observe un pic dans le recrutement d’agents dédiés à la participation, et actuellement, la tendance est davantage à la dissémination. Le développement de compétences participatives ne va-t-il pas alors très rapidement mettre un terme à l’existence de ce métier, celui d’agent de la participation ? Et la manière dont est intégrée cette question dans le référentiel de la fonction publique territorial (CNFPT) semble révélatrice de cette entrée par la compétence et non pas par le métier. Ce point interroge et semble être un signe de cette institutionnalisation fragile, qui s’opère bien par diffusion plutôt que par spécialisation.
Et du côté des prestataires privés, il s’observe la même chose. Très peu ne font que de la participation. En revanche, il y a de plus en plus d’autres prestataires, dont le métier est tout autre chose (management, communication, assistance à maîtrise d’œuvre, etc.) et qui ont intégré dans leurs compétences de la compétence participative. La prestation participative devient une prestation de complément, car elle devient obligatoire, et aussi car faire valoir une capacité en matière participative apparaît comme un moyen de conquérir d’autres marchés6. A voir la vitesse à laquelle ces compétences et ces prestations participatives se diffusent, ces évolutions sont très rapides. Et après un pic de spécialisation au milieu des années 2000, on serait déjà dans une forme de déspécialisation. Est-ce que finalement, cette profession ne serait pas alors mort-né ? En suivant les acteurs, on peut comprendre comment se met en place, comment s’institutionnalise cette participation. Et là où en regardant les dispositifs, on a l’impression d’une consolidation de la norme participative, l’approche retenue ici montre plutôt une tendance à voir une norme extrêmement fragile et précaire, ce qui interroge sur le sens de cette institutionnalisation.
Discussion avec la salle
Questions sur le choix de ne pas définir la participation a priori
Finalement, le propos interroge sans cesse sur la définition de la participation. Avec cette institutionnalisation, on perdrait le sens initial de ce que c’est que la participation.
Le terme participation est à la fois mis sur des pratiques plutôt lié à des formes de médiation, de concertation, liée à l’acceptabilité sociale, au pouvoir d’agir etc. Le problème de mettre une définition a priori à la participation, est d’une part, de dénouer les luttes de définitions, et d’autre part, qu’on ne regarde qu’une activité. En observant ce que les gens mettent derrière, cela permet de voir que tous les acteurs ne mettent pas la même chose derrière, selon notamment les secteurs d’activités concernés. Ainsi, dans le secteur de l’environnement et des grands projets d’aménagement, c’est plutôt une logique d’acceptabilité sociale ; alors que parler d’acceptabilité sociale sur des activités liées à la politique de la ville ne s’entend pas pareil.
Question sur la césure entre militants et professionnels, qui ne serait plus opérante
Le propos soutient que c’est la « Professionnalisation des militants qui fait l’institutionnalisation de la participation », et donc que l’opposition entre militants et professionnels n’est plus vraiment d’actualité. Tout d’abord, il faut rappeler qu’il y a d’autres éléments qui font cette institutionnalisation. Et ensuite, cette opposition entre militants et professionnels demeure encore centrale, en tout cas sur le secteur de l’habitat participatif. Des gens revendiquent la position de militants, gagnent en compétence, se forment et sont de plus en plus efficaces (et donc quelque part, se professionnalisent), mais en revendiquant des postures militantes, bénévoles, citoyennes… Si on observe ce qui se passe en Allemagne, où la professionnalisation est beaucoup plus avancée dans ce domaine, on retrouve toujours des gens qui restent dans une démarche citoyenne.
Sur l’opposition entre professionnel et militant, si elle n’a pas disparu, elle est moins structurante qu’elle ne pouvait l’être jusqu’au début 2000. Les militants revendiquent des compétences professionnelles et ne s’opposent plus par rapport à la logique de professionnalisation. Les militants d’aujourd’hui revendiquent un investissement militant mais revendiquent également des compétences professionnelles. La ligne d’opposition s’est déplacée sur le sens politique de l’engagement, entre celui qui revendique un investissement militant et politique et celui qui, à l’inverse, est complètement désinvesti et a une posture plus cynique (être au service des citoyens versus le citoyen alibi pour faire autre chose).
Remarque sur la profession « mort-née »
Un agent territorial est à la fois praticien de la participation et agents territorial. Il n’y a donc pas vraiment de logique de profession, puisque la filière administrative est la même pour tous, et pour évoluer en termes de carrière, l’agent doit passer par un certain nombre de postes. Souvent, le service démocratie locale (comme d’autres secteurs de l’administration territoriale) était vu comme une sorte d’impasse. Il y a donc une sorte de grand écart qui est demandé entre la carrière et l’engagement dans ces activités participatives.
Remarque sur la standardisation des pratiques
Elle vient en partie des agents, mais aussi des élus et des citoyens. De temps en temps, les habitants demandent une Charte de participation. Et certains citoyens sont sur-consommateurs de participation et vont tirer de la satisfaction de participer à tel ou tel dispositif vanté comme étant innovant. Le côté label rassure les élus, les habitants, les techniciens. Et en allant plus loin, dans une logique de marketing territorial, certains élus sont friands de pouvoir afficher l’intervention de prestataires reconnus pour leur processus de concertation. C’est la question de l’affichage de la participation dans le marketing territorial qui se pose, de l’affichage du caractère innovant et exemplaire de la politique de participation. Une Charte est un support idéal pour communiquer et avoir des articles de presse, à l’inverse d’une opération de participation à petite échelle, avec des publics éloignés, sur une période étirée.
La dizaine de cabinets très réputés participent très largement à cette labellisation de l’innovation locale, avec parfois un jeu de réciprocité et de légitimation croisée entre le prestataire (parfois également chercheur) et la collectivité pour que chacun mette en lumière l’autre (le chercheur fera un article sur le dispositif mis en place par son cabinet, ce qui fera en retour un agrément d’innovation pour l’expérience de la collectivité, etc.). Il y a également des effets de mimétisme entre élus qui échangent entre eux sur tel ou tel dispositif qui serait particulièrement performant et en passe ensuite la commande.
Remarque sur la mise en contexte des données présentées
Ce segment d’organisation du travail est présenté, en faisant l’économie de l’évolution et de l’état actuel du marché du travail et de l’accès à ce marché par les personnes diplômées, éléments qui jouent très fortement sur ce marché. Une autre logique qui n’est pas évoquée ici et a son importance, est la logique de rationalisation et d’évaluation des politiques publiques (sur les compétences, les référentiels métiers etc.). Enfin, une structuration professionnelle très similaire est celle de la « lutte contre les discriminations ». C’est un marché qui fonctionne tout à fait en parallèle, avec les mêmes préoccupations, la même dimension militante et les mêmes dynamiques d’institutionnalisation, etc. Il y a un ensemble de réalités externes au champ de la participation dont on ne peut pas faire l’économie pour comprendre ce qu’il se passe dans la participation…
Si l’analyse se centre sur la participation, elle n’affirme pas pour autant que les dynamiques observées seraient spécifiques à la participation. Il y a des logiques tout à fait comparables, notamment avec l’évaluation des politiques publiques. Sur le temps long, il y a des logiques de cycle : une période de politisation (les années 1970), puis une certaine dépolitisation et à nouveau repolitisation (dans les années 2000) et au final, aujourd’hui, le jeu de concurrence politique participe de dépolitisation globale (car tout les élus essayent de se démarquer de la même manière).
Sur la professionnalisation des diplômés et l’accès à l’emploi, d’après un suivi des diplômés de Master spécialisé dans la concertation, il apparaît que même ceux formés à la concertation deviennent pour un tiers des professionnels de la participation, pour un autre tiers, des agents dont l’activité principale n’est pas la participation mais qui en font un peu, et pour le dernier tires, des gens qui font tout à fait autre chose.
Question sur la place du militantisme aujourd’hui dans cette nébuleuse
On voit bien comment on passe d’une logique de militant qui devient professionnel. Mais au-delà de cette évolution générale, n’y-t-il pas des sous évolution à repérer ? Avec dans certains cas, un affaiblissement de la posture militante (par exemple, certaines associations comme l’ADELS, où des gens, se disant militants, se retrouvent en concurrence avec des professionnels et ont difficulté à imposer une spécificité qui s’estompe) et dans d’autres cas, l’émergence de nouveaux acteurs qui réaffirment cette posture militante (par exemple, la Scop le Pavé ou l’Engrenage à Tours, qui ont un discours militant, avec un projet politique autour de l’émancipation, et où la participation est vue comme un moyen).
Il serait intéressant d’aller interroger ces acteurs-là, et aussi d’aller un peu au-delà du cas français et aller voir comment se pose ce lien entre posture militante et professionnelle dans d’autres contextes, où il peut y avoir des liens avec les mouvements sociaux beaucoup plus forts (par exemple, en Espagne, où les diplômés de Master sur la participation vont reconvertir ce qu’ils ont appris dans les mouvements sociaux, du type les Indignés, peut-être aussi car le marché du travail est complètement bouché…).
Proposer une vue d’ensemble, dans une approche plus globale, conduit à effectuer un retrait sur cette posture militante. Alors que, dans certains segments, elle peut rester importante voire reprendre de la place, en opposition de cette dynamique de dépolitisation. Globalement, le poids relatif des militants est aujourd’hui beaucoup moins important qu’il y a 10 ou 15 ans. Mais dans le secteur de la politique de la ville et de l’aménagement urbain, on a un retour en force de structures qui revendiquent expressément un positionnement militant.
Il n’est pas si évident en fait que les acteurs militants n’interviennent que sur les secteurs de la politique de la ville. Il y a en fait une foultitude de secteurs où la logique participative est intégrée (jusqu’à l’émergence récente de supermarchés d’alimentation participatifs !). Cette idée de participation n’apparaît alors pas cantonnée à certains secteurs. Mais on change le concept qui est derrière la participation, quand on dit « habitat participatif » ou « supermarché participatif », on retourne vers la citoyenneté, et quand on dit « professionnels de la participation », on retourne au contraire vers le « travail social ».
Effectivement, il y a un effet de terrain : le fait de se centrer sur l’offre publique de participation, en entrant par la logique de professionnalisation de la participation a conduit, conduit nécessairement à ne pas voir un certain nombre d’autres initiatives. Cela ne veut pas dire qu’il n’y en a pas d’activité participative chez d’autres acteurs et dans d’autres secteurs et sous d’autres formes.
Question sur les sensibilités militantes des professionnels
Du militant au professionnel, c’est une évolution historique. Après, du professionnel au militant, on a des acteurs qui revendiquent leur professionnalisme et leur militantisme. Sont-ils professionnels avant d’être militants ou l’inverse, c’est difficile à dire. Mais il y a l’idée que revendiquer son militantisme, y compris dans la fonction publique, ce n’est pas le faire au détriment d’une revendication de son professionnalisme. Ce point est extrêmement structurant, car il revient fréquemment dans les débats entre praticiens.
Question sur l’absence des centres sociaux de la nébuleuse des professionnels de la participation
Les centres sociaux existent depuis longtemps et la participation est consubstantielle de ces structures, elle existe en leur sein depuis leur création. Ces structures sont très nombreuses (2 200, en forte progression)et présentes sur tous les quartiers « politique de la ville ». Il existe aujourd’hui un observatoire des centres sociaux à l’échelle nationale, avec la fédération nationale des centres sociaux, où on voit que la participation dans les centres sociaux est très forte. On le voit notamment par le portage juridique, puisque 85 % de ces centres sont des grosses associations. Il y a cette compétence, au sein des centres sociaux, et on ne la retrouve pas dans l’analyse
Le fait de travailler sur les marchés et les agents les a invisibilisés de l’analyse, ce qui tendrait également à montrer la segmentation de ce secteur. Les centres sociaux sont dans une posture politique d’éducation populaire, et l’analyse présentée ici est sur la « professionnalisation » de la participation, donc sur du travail social et la recherche de consensus. Ce sont deux formes différentes. En maintenant la place des habitants et en revendiquant une posture de non-professionnels, en tant que relais, la posture des centres sociaux apparaît originale. Ils sont dans une posture d’éducation populaire et de critique politique, qui n’est pas l’objet ici.
Cette distinction est centrale, mais il ne faudrait pas homogénéiser parmi les professionnels étudiés, car il y en a qui revendiquent une posture militante d’éducation, et d’autres non, et assume de ne faire que de l’acceptabilité. L’analyse s’est centrée sur l’offre publique, et celle-ci n’épuise pas la participation. Mais l’analyse selon laquelle la ligne de fracture passerait entre militants et professionnels n’est pas partagée. C’est le rapport aux institutions qui est différent. L’institutionnalisation de la participation est passée d’une logique de lutte et bottom-up à une approche top-down d’institutionnalisation de la participation. Et on a arrêté de regarder à un moment donné toutes les formes de participation qui pouvaient exister à côté. Le déploiement de cette offre publique de participation a pu avoir un effet non pas d’épuisement mais d’invisibilisation de la participation.
On pourrait retrouver ce même clivage, par exemple, entre un habitat autogéré, un squatt et un projet d’habitat participatif porté par une collectivité. La différence tient alors moins à la profession qu’au processus d’institutionnalisation.
Une question sur l’approche diachronique et les interactions entre l’évolution du cadre juridique et les pratiques sociales
Cette dynamique d’institutionnalisation est rythmé par des évolutions juridiques (2002, les conseils de quartiers ; 2006-2007, la labellisation des Agendas 21 ; les SRADDT dont l’élaboration a mobilisé des panels citoyens).
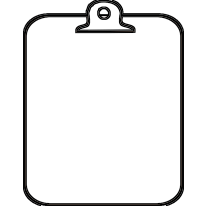
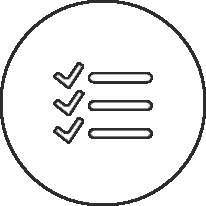
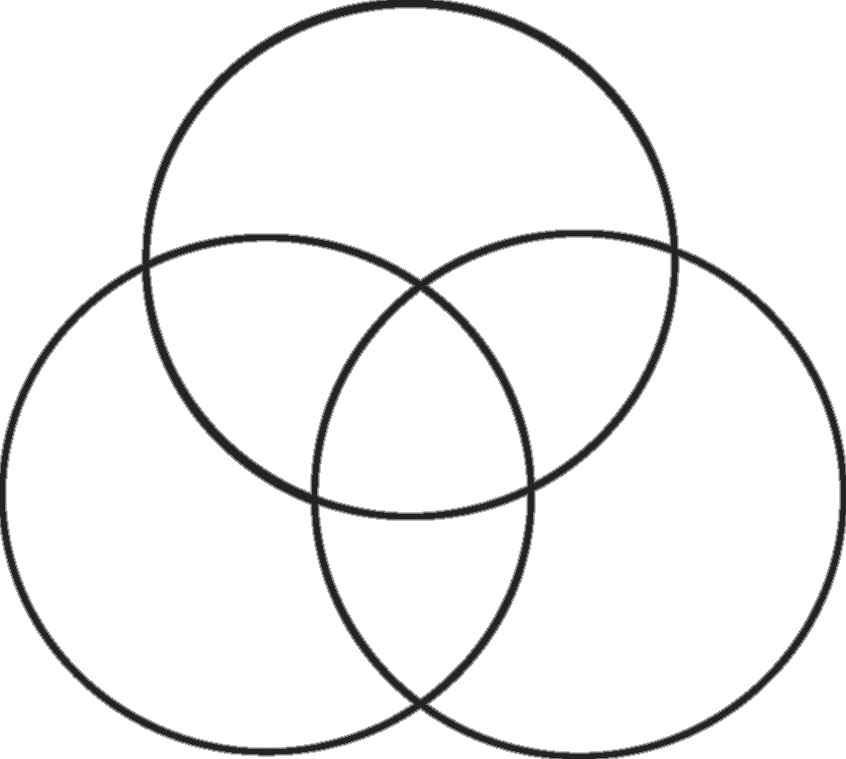
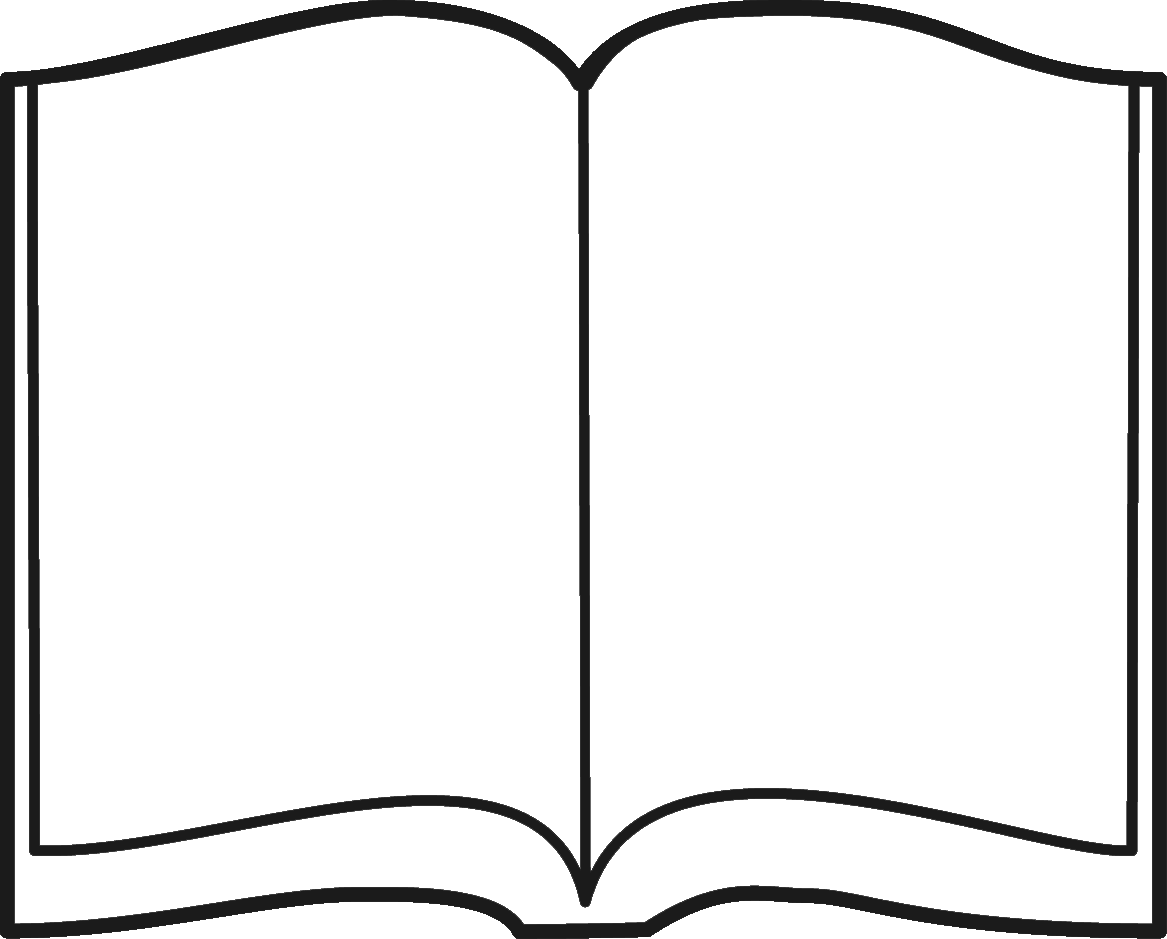



 Sabrina BRESSON
Sabrina BRESSON
 Jérôme GUILLET
Jérôme GUILLET
 Gaël Foussadier
Gaël Foussadier
 Christian Calenge
Christian Calenge
 Alice Mazeaud & Magali Nonjon
Alice Mazeaud & Magali Nonjon
 Séminaire précédent
Séminaire précédent Accueil
Accueil